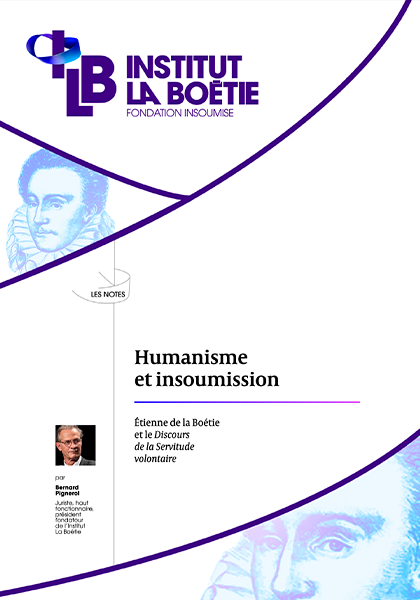Humanisme et insoumission
Introduction
« Comme si le monde par-dessus les siècles ressassait
Car enfin, n’est-ce pas, ça y ressemble fort
Le XVIe siècle et le nôtre »
Jean Rouaud, Juge de Montaigne (2022)
« Le Discours force le mur du temps », a écrit le philosophe Claude Lefort[1]. C’est vrai, et c’est bien pourquoi ce texte vieux de bientôt cinq siècles nous parle encore. Mais, pour goûter pleinement le Discours de la servitude volontaire, pour en prendre la vraie mesure, en apprécier la force, il faut le replacer dans son époque et dans son milieu culturel. Cette époque, cette culture, appelons-les par leurs noms usuels : Renaissance, humanisme.
Une révolution des esprits : l’humanisme
Changements de perspective
Quand La Boétie vient au monde, en 1530, cela fait plus d’un siècle que l’humanisme transforme les esprits – si radicalement que certains historiens n’ont pas hésité à parler d’une « révolution culturelle ». Cette mutation séculaire, lente mais profonde, procède d’un double élargissement des perspectives – et il faudrait presque entendre ici « élargissement » dans son sens juridique de « libération d’un prisonnier ».
Élargissement dans le temps d’abord. Décidés à rompre avec la « barbarie gothique » du Moyen Âge, les lettrés redécouvrent l’Antiquité. Ils apprennent le latin classique, mais aussi le grec, et pour les plus audacieux l’hébreu ou l’arabe. Lancés dans une véritable « chasse aux manuscrits », ils s’efforcent de retrouver les textes des Anciens, oubliés, décriés ou corrompus par la tradition chrétienne ; ils travaillent à en donner des versions fiables, qui pourront circuler ensuite dans toute l’Europe. Cette redécouverte, facilitée par l’arrivée en Occident de savants et de manuscrits byzantins après la chute de Constantinople (1453), mobilise les meilleurs esprits d’Europe.
Élargissement dans l’espace, ensuite. À des fins commerciales, diplomatiques ou militaires, ou simplement pour voir du pays, on voyage. Il n’est pas nécessaire d’aller très loin pour rencontrer la nouveauté. Il peut suffire de passer les monts : les interminables guerres d’Italie, qui conduisent la noblesse française dans la péninsule, lui font découvrir une haute civilisation qui la fascine et la marque durablement. Mais on explore aussi des contrées lointaines et inconnues, des routes jamais frayées. Tout au long du XVe siècle, les Portugais suivent les côtes occidentales de l’Afrique ; ils passent le cap de Bonne-Espérance, atteignent l’océan Indien. Des rapports s’établissent avec l’Inde et les îles à épices. En 1492, un capitaine génois gorgé de lectures, de rêveries et d’ambitions, Christophe Colomb, débarque aux Antilles, ouvrant ainsi la voie à l’exploration, à la colonisation (et au pillage) de l’Amérique. À peine trente ans plus tard, les vaisseaux de Magellan bouclent le premier tour du monde. Encore une décennie et Jacques Cartier ira explorer le Canada pour le compte du roi François Ier. Ces « grandes découvertes » s’opèrent lentement, non sans tâtonnements, et la connaissance des terres nouvelles ne progresse qu’à petite vitesse. Néanmoins, les cartes géographiques s’enrichissent et se précisent. Les récits de navigation et les témoignages des voyageurs font savoir que d’autres mondes existent.
Ce double élargissement bouleverse les perspectives. La Renaissance, résume Claude Lévi-Strauss, a découvert « le moyen de mettre sa propre culture en perspective » en se confrontant à « d’autres temps et d’autres lieux »[2]. La redécouverte et la valorisation de l’Antiquité offre aux élites d’autres points de référence que ceux de la civilisation chrétienne : des écrivains païens, qui peuvent être matérialistes, ou républicains. La rencontre des mondes africains, asiatiques, américains, avec leurs normes et leurs mœurs propres, vient ébranler la primauté de l’Europe, dont la culture perd sa valeur absolue. Dans le temps et dans l’espace, voilà que surgissent des Autres qui obligent à penser différemment. L’ébranlement des certitudes attise l’esprit critique, aiguise la pensée, favorise la recherche et la novation.
Le surmultiplicateur
La diffusion de cet esprit nouveau est encouragée par des échanges accrus (épistolaires ou directs) entre les intellectuels, mais aussi et surtout par un fait technique de grande importance : l’invention de l’imprimerie, au milieu du XVe siècle. En créant les caractères typographiques métalliques mobiles, en mettant au point sa presse et en privilégiant finalement le papier (au détriment du traditionnel vélin, plus rare et plus cher), Gutenberg ne modifie pas seulement la forme du livre. Il crée la possibilité de produire des ouvrages en « grand » nombre ; il invente ainsi ce que l’historien Pierre Chaunu a appelé le « surmultiplicateur »[3], le moyen de diffuser les textes et les idées dans des proportions jamais entrevues. D’autant que les ateliers d’imprimeurs se multiplient rapidement, dans la vallée du Rhin d’abord, puis dans toute l’Europe. En 1480, on compte déjà des presses dans plus de cent villes européennes. Dans les plus importantes s’établissent des ateliers fameux, et souvent des dynasties d’imprimeurs : Alde Manuce à Venise, Frobenius à Bâle, Josse Bade, Jean Petit et Estienne à Paris, Sébastien Gryphe à Lyon… Rien qu’entre 1450 et 1500, les historiens comptent 30 000 éditions environ, soit 15 000 textes différents imprimés, et peut-être 20 millions d’exemplaires diffusés. Au siècle suivant, la production ne fera qu’augmenter. Ainsi, une dynamique intellectuelle rencontre des conditions matérielles nouvelles, et favorables. Certes, tous les livres imprimés ne diffusent pas les idées humanistes – loin s’en faut. Mais le livre n’en est pas moins un « ferment » de l’esprit nouveau. Des presses sortent « des pamphlets aigus comme des flèches qui [vont] frapper au loin l’ignorance, la moinerie et le fanatisme »[4]. Autour du « petit monde du livre »[5], des imprimeries, mais aussi de certaines cours ou institutions d’enseignement, des réseaux humanistes s’établissent, de petits foyers intellectuels se constituent. La République des lettres, lentement, prend corps. Et peu à peu, les idées nouvelles se répandent.
Nouveau regard, nouvelles idées
Quelles idées ? Le phénomène humaniste est complexe, ramifié, plein de nuances et de contradictions. Il y a, si l’on veut, autant d’humanismes que d’humanistes. Pour autant, il n’est pas impossible d’isoler quelques traits principaux.
Dignité de l’Homme
Dans le grand chamboulement intellectuel de la Renaissance, l’ici-bas, tant décrié par l’Église, est réhabilité. Sans renier Dieu, on apprend à reconnaître et à revendiquer la grandeur de l’homme – et même, quelquefois, la « noblesse et préexcellence » de la femme[6]. Au milieu des années 1480, Pic de la Mirandole rédige un texte dont le titre dit tout : Discours de la dignité de l’homme. Il y réaffirme, en même temps que la « noble condition » de l’homme, sa faculté (auto)créatrice. Chez Pic de la Mirandole, Dieu, « le parfait ouvrier », s’adresse à l’homme en ces termes : « Si nous ne t’avons donné, Adam, ni une place déterminée, ni un aspect qui te soit propre, ni aucun don particulier, c’est afin que la place, l’aspect, les dons que toi-même tu aurais souhaités, tu les aies et les possèdes selon ton vœu, à ton idée. Pour les autres créatures, leur nature définie est tenue en bride par des lois que nous leur avons prescrites ; toi, aucune restriction ne te bride, c’est ton propre jugement, auquel je t’ai confié, qui te permettra de définir ta nature ». « Doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de [se] modeler et de [se] façonner [lui]-même »[7], l’homme peut se donner la forme à laquelle il aspire.
L’homme – il faut comprendre l’être humain – des humanistes est donc capable de faire son histoire, et même de faire l’Histoire. Il est faber fortunae, l’artisan de son destin[8]. Cette idée éclate, par exemple, dans Le Prince, le chef-d’œuvre de Machiavel, qui proclame la capacité du grand homme à forger son destin, malgré les incertitudes et les revers de la Fortune. La Providence chrétienne, sans être explicitement congédiée, est réduite à la portion congrue. Elle est, explique le Florentin, comme un fleuve, avec lequel il faut compter, mais que l’homme avisé et résolu peut endiguer, voire détourner à son profit. Même si les circonstances semblent difficiles, et l’avenir bouché, l’homme machiavélien doit continuer « à espérer, à se battre, à rêver, à dessiner des utopies »[9].
Interroger le monde, questionner les autorités
Comme la Fortune, la Nature peut être domptée, maîtrisée – à condition d’être connue. Cette certitude anime les hommes de la Renaissance, qui vont accorder aux réalités physiques et au monde sensible une attention sans précédent. Si la science moderne tarde à naître, la curiosité, l’expérimentation et l’invention technique sont partout : des artistes s’attachent à restituer au plus juste les paysages qu’ils ont sous les yeux ; des architectes transforment les villes et les règles de la construction ; des ingénieurs imaginent des appareils et des dispositifs nouveaux. Avec une passion ardente, parfois brouillonne, on cherche à connaître les choses, à en forcer les mystères.
Cet esprit questionneur, forcément désacralisant, s’exerce aux dépens des autorités traditionnelles. Premières cibles : l’Église et le dogme. La philologie ne s’applique pas qu’aux textes profanes de l’Antiquité. Certains humanistes examinent aussi, d’un œil critique, les textes sacrés. Lorenzo Valla prouve que la « donation de Constantin », censée fonder le pouvoir temporel du Pape, est un faux tardif ; Érasme se permet de modifier la Vulgate, et notamment le Pater noster, dont le latin lui paraît fautif ; bientôt, de grandes traductions en langue vulgaire permettront aux laïcs de prendre connaissance de la Bible sans passer par la médiation du clergé. Mais plus que les Écritures, c’est l’institution religieuse, l’Église réellement existante, qui fait l’objet de critiques. Érasme – un religieux pourtant, qui restera jusqu’au bout fidèle à Rome, et qui se verra même proposer la barrette de cardinal – n’épargne pas le clergé. Dans son Éloge de la folie, petit texte plein de sel qui est comme le bréviaire de l’esprit humaniste, il se moque tout à la fois des dévots, de la superstition, des sermons pendant lesquels « tout le monde dort, baille, s’ennuie », des théologiens qui passent leur temps à « pétrir et repétrir les saintes écritures comme une cire molle » et voient des hérétiques partout, des prélats fastueux, des mauvais prêtres qui « ont de bons yeux pour découvrir dans de vieux manuscrits de quoi terrifier le petit peuple, et le convaincre qu’il leur doit plus que la dîme »[10]. Selon certains critiques, Érasme s’en serait même pris au souverain pontife, en stigmatisant, dans un pamphlet intitulé Julius exclusus (Jules, privé de paradis !) l’immoralité et la corruption du pape Jules II. Chez Rabelais, la charge contre l’Église est plus forte, plus violente, plus bouffonne encore : toute son œuvre d’écrivain est une entreprise libératrice, qui pourfend la bigoterie, le fanatisme, le puritanisme, la superstition, les moines dépravés et les censeurs de la Sorbonne. Il n’est guère question d’athéisme, ni encore de laïcité, bien sûr. Mais déjà, les abus et l’emprise de l’Église sont mis en question.
Autre cible des humanistes : le mauvais souverain, le tyran – celui qui opprime son peuple, pille et ravage le pays, sert ses intérêts sans souci du bien public. Érasme, encore lui, dénonce « ce Prince comme on en voit tant : un homme qui ignore les lois, presque un ennemi du bien public, et qui ne cherche que le sien propre, adonné aux plaisirs, haïssant le savoir, haïssant la liberté et la vérité, se moquant éperdument du salut de la République, mais mesurant tout à sa passion et à ses intérêts »[11]. Pour le premier des humanistes, un prince ne doit « pas dominer ses sujets autrement qu’en essayant d’être le meilleur et le plus utile à tous », il ne doit s’estimer « heureux que s’il rend ses sujets heureux ». Rabelais ne dit pas autre chose, quand, dans ses romans, il oppose au tyran Picrochole ses bons géants Gargantua et Pantagruel, modèles de souverains éclairés.
Cosmopolitique du genre humain
En même temps que les mauvais Princes, les humanistes condamnent leurs politiques aventureuses, et leur passion de la guerre. Habité par un idéal de concorde, Érasme voit dans la paix « la source de toutes les félicités ici-bas ». Il s’étonne que l’homme, qui a « la faculté de raisonner » et « le don de la parole, qui est la grande conciliatrice de l’amitié », ait malgré tout « cette rage insatiable de la guerre »[12].
Rien d’étonnant à ce que les tyrans veuillent la guerre, ni à ce que de mauvais prélats leur fournissent une justification « théologique ». Mais Érasme perçoit que le mal est plus profond. Il est dans le peuple même : « l’Anglais hait le Français uniquement parce qu’il est Français, le Breton hait l’Écossais seulement parce qu’il est Écossais ; l’Allemand ne s’entend pas avec le Français ; l’Espagnol est en désaccord avec l’Allemand et le Français. Cruelle perversité humaine ! La diversité des noms qu’ils portent suffit à elle seule à les diviser à ce point »[13]. Pour Érasme, enfant bâtard et nomade impénitent, qui passa sa vie à sillonner l’Europe, le cosmopolitisme s’impose.
D’autres, plus tard, iront plus loin encore, et affirmeront que la fraternité humaine ne s’arrête pas aux frontières de la chrétienté. Confrontés aux indigènes du Nouveau Monde, quelques esprits d’élite sauront reconnaître en eux, non des « bêtes » ou des « sauvages », mais, malgré la différence culturelle, des semblables, porteurs de droits et dignes de respect. C’est le cas, par exemple, du dominicain Las Casas, qui, des deux côtés de l’Atlantique, passera la plus grande partie de sa vie à défendre les Indiens contre ceux qui voient en eux des êtres vils, voués à l’esclavage. « Ces peuples des Indes », affirme Las Casas, « égalent et même surpassent beaucoup de nations du monde, réputées policées et raisonnables »[14] ; « ils ont l’entendement clair, sain et vif »[15] ; « ce sont des êtres libres (…). Quant à leur état d’esclave par nature, il est aussi éloigné de la vérité que les cieux le sont de la terre »[16]. Montaigne, lui, saluera la découverte d’un Nouveau monde « non moins grand, plein et membru » que l’Ancien. Il balayera, surtout, les préjugés du temps en avançant qu’« il n’y a rien de barbare ou de sauvage » chez les indigènes des Amériques, « sinon que chacun appelle barbarie ce qui n’est pas de son usage »[17]. Pratiquant le renversement de perspective dont parlait Lévi-Strauss, Montaigne se sert de l’Autre d’outre-Atlantique, l’Indien, pour mettre en question sa propre civilisation et son penchant pour la violence : « nous les pouvons bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais pas eu égard à nous, qui les surpassons en toute sorte de barbarie »[18]. Ce qui point ainsi chez Las Casas, chez Montaigne, chez quelques autres à la même époque, c’est le sentiment de l’unité indissoluble du genre humain, qui est un des acquis les plus puissants et les plus révolutionnaires de l’humanisme renaissant.
Réformer la société pour réformer l’Homme
Critique de l’Église et des mauvais Princes, idéal de concorde, cosmopolitisme : cela, sans doute, ne suffit pas à composer un programme. Il n’y a pas, à strictement parler, un projet politique de la Renaissance. Mais il y a bien, diffus, implicite ou manifeste, un désir de réforme, de l’être humain et des institutions. Ou mieux : de l’être humain par les institutions. Car les humanistes ont compris que l’humanité n’est pas un donné, mais une construction, une conquête. « On ne naît pas homme, on le devient », résume Érasme. Et il faut des institutions justes et vertueuses pour humaniser l’être humain, pour produire le vir humanus. Dans cette perspective, la première institution, la plus décisive, c’est l’enseignement ; de là l’intérêt que les plus grands (Érasme, Juan Luis Vives, Rabelais, Montaigne…) ont accordé aux questions de pédagogie.
Hors de la sphère éducative, ce sont les institutions politiques qui retiennent l’attention des humanistes. Il existe, en Italie notamment, tout un courant d’« humanisme civique » qui insiste sur la nécessité de « restreindre par la loi la discrétion laissée au souverain »[19], et de donner au peuple sa juste place dans la conduite des affaires publiques. Puisant dans la tradition républicaine antique, cet humanisme civique fait de la « liberté » son point cardinal. Pour lui, la fonction des institutions politiques n’est pas seulement d’assurer l’ordre et la sécurité, mais aussi et surtout d’offrir et de cultiver cette liberté. Or, être libre, et pleinement humain, c’est être en mesure de « prendre une part active dans la gestion de la communauté »[20], c’est pouvoir « s’engager activement et en toute égalité dans les affaires de l’État »[21]. « La corruption des formes politiques naît de l’exclusion du peuple d’un rôle suffisamment actif dans les affaires du gouvernement »[22]. Dans cette perspective, le régime légitime et vertueux est celui qui permet et garantit la participation de tous à la conduite de la cité.
La projection réformatrice s’étend parfois au-delà de ces considérations politiques générales. Il arrive qu’elle embrasse l’ensemble des réalités sociales. Dans son Utopie, Thomas More, scandalisé par le vice, les inégalités et la misère qui grevaient la société anglaise, en imagine ainsi une refonte radicale : chez les Utopiens, la propriété privée est abolie ; l’oisif n’a pas sa place ; les hommes sont également appelés à travailler, pour une durée limitée ; les ressources sont réparties de manière rationnelle et équitable ; les villes sont vastes et propres, mais le luxe est banni (l’or ne servant qu’à confectionner des urinoirs) ; un Sénat élu règle la marche ordinaire de l’île, tandis que la population tout entière est appelée à trancher pour les grandes décisions ; on valorise les « plaisirs bons et honnêtes », l’entraide ; on se défie du fanatisme religieux, de la guerre et de la gloire militaire, etc. On peut, naturellement, gloser sur les limites et les naïvetés du modèle utopien, ou s’interroger sur les convictions profondes de l’homme Thomas More. Mais on ne peut qu’être saisi, à la lecture d’un texte comme L’Utopie, par la vigueur critique, la capacité d’invention et la puissance civilisatrice de la pensée humaniste.
Crépuscule
Dans les premières années du XVIe siècle, l’humaniste Ulrich von Hutten peut encore s’exclamer : « Ô siècle, ô sciences ! C’est joie de vivre ! Les études fleurissent, les esprits s’éveillent. Ô Barbarie, prépare-toi au bannissement ! ». Mais le rêve humaniste va rapidement s’assombrir, à cause des dissensions religieuses. La critique de l’Église et l’idéal de réforme étaient, on l’a vu, choses anciennes, largement partagées par les humanistes, et présentes jusque dans l’entourage des puissants. Mais après les schismes luthérien et anglican, puis la multiplication des Églises réformées, la modération n’est plus de mise : il faut désormais choisir son camp. La République des Lettres, autrefois unie, se fracture. En France, à partir du milieu des années 1530, et plus encore dans la décennie 1540, François Ier, jusque-là plutôt libéral, entreprend de lutter contre l’hérésie. Les tribunaux condamnent, la Sorbonne censure. En 1546, Étienne Dolet, humaniste et imprimeur (de Rabelais, entre autres), accusé de déviance religieuse, est brûlé place Maubert, avec ses livres. Au mitan du siècle, les guerres de Religion commencent à déchirer le pays. Qu’il soit catholique ou protestant, le fanatisme religieux – souvent mêlé de calculs politiques – va meurtrir la France et l’Europe pendant de longues décennies.
La Boétie dans son temps
« Il l’escrivit en sa première jeunesse, à l’honneur de la liberté… »
C’est à la charnière de ces deux époques, entre âge d’or de l’humanisme et conflits de religion, que s’inscrit la courte vie d’Étienne de La Boétie. Il naît à Sarlat, dans une famille de petite noblesse appartenant au milieu consulaire. La cité périgourdine, qui compte alors quelque 3 000 habitants, une cathédrale, une abbaye, n’est pas à l’écart de la floraison de la Renaissance, puisqu’elle accueille au début des années 1540 un évêque venu de Florence, Niccolo Gaddi, qui arrive sur les bords de la Dordogne avec son cortège de lettrés et, dans ses bagages, de précieux ouvrages. On suppose, mais sans assurance, que le jeune Étienne a d’abord fréquenté un collège parisien. On sait, en revanche, qu’il rejoint finalement l’Université des lois d’Orléans, pour y faire son droit. L’université, l’une des plus fameuses du royaume, est un foyer humaniste : l’enseignement tranche avec les routines de la scolastique, et l’on peut y entendre des maîtres éminents, dont le protestant Anne du Bourg, qui sera pendu en 1559 pour avoir osé s’élever, devant le roi, contre les persécutions infligées aux réformés. La Boétie y parfait sa formation et obtient son grade de licencié en 1553.
C’est, semble-t-il, au cours de la décennie 1540 qu’il écrit le Discours de la servitude volontaire, cette philippique contre la tyrannie qui lui vaudra de passer à la postérité. Sur la date de composition du texte, pas de certitude : Montaigne dira qu’il fut écrit à 18 ans, avant de se corriger et de proposer 16 ans ; un autre auteur, l’historien De Thou, parle de 19 ans. Pas de certitude non plus sur les circonstances qui l’ont inspiré, mais De Thou évoque la révolte populaire contre la Gabelle, qui a secoué l’Angoumois, la Saintonge, et finalement la Guyenne et le Périgord en 1548. L’agitation fut spectaculaire, et la répression royale terrible (la ville de Bordeaux fut occupée par les troupes, son Parlement suspendu). Il se peut que ce soulèvement du peuple contre un ordre écrasant ait nourri les réflexions du jeune La Boétie, mais son texte n’y fait aucune référence explicite. Quoiqu’il en soit, le Discours ne circule, à ce stade, que sous forme manuscrite. Passant « ès mains des gens d’entendement » (comme l’écrira Montaigne), il contribue à la renommée intellectuelle de La Boétie au sein d’un petit milieu de lettrés.
Diplômé, La Boétie rejoint son sud-ouest natal : il rachète une charge de conseiller et, dès 1554, il se fait recevoir (avant l’âge légal) au Parlement de Bordeaux. Le voilà désormais introduit dans le patriciat, parmi les meilleures familles de la ville. Il fait un beau mariage. Quand sa charge et ses obligations sociales lui en laissent le temps, il se livre à des jeux, se consacre à la traduction des auteurs grecs ou à la composition de poèmes (latins et français).
« Parce que c’était lui, parce que c’était moi »
Vers la fin des années 1550, vraisemblablement en 1557, La Boétie fait la rencontre d’un autre conseiller, tout nouvellement rattaché au Parlement de Bordeaux : Montaigne. Ce dernier, de deux ans son cadet, sera comme on le sait son « frère d’alliance ». La Boétie évoque cette relation dans un poème latin dédié à son ami : « Une bonne partie des sages se méfiant de la foule/ Ne croit pas en l’amitié, sauf quand le temps l’a mise à l’épreuve/ Et qu’elle a lutté contre les divers assauts du malheur./ Or un amour d’un peu plus d’un an nous unit/ Sans rien envier à l’amour le plus fort. […] À toi Montaigne au milieu de tous les hasards/ La souveraine nature et la précieuse vigueur séductrice de l’amour/ M’ont uni »[23].
Quant à l’auteur des Essais, il consacrera à cette amitié des pages inoubliables[24] :
Il y a au-delà de tout mon discours, et de ce que j’en puis dire particulièrement, je ne sais quelle force inexplicable et fatale, médiatrice de cette union. Nous nous cherchions avant que de nous être vus, et par des rapports que nous oyions l’un de l’autre, qui faisaient en notre affection plus d’effort que ne porte la raison des rapports, je crois par quelque ordonnance du ciel ; nous nous embrassions par nos noms. Et à notre première rencontre, qui fut par hasard en une grande fête et compagnie de ville, nous nous trouvâmes si pris, si connus, si obligés entre nous, que rien dès lors ne nous fut si proche, que l’un à l’autre. Il écrivit une Satire Latine excellente, qui est publiée, par laquelle il excuse et explique la précipitation de notre intelligence, si promptement parvenue à sa perfection. Ayant si peu à durer, et ayant si tard commencé (car nous étions tous deux hommes faits, et lui plus de quelques années) elle n’avait point à perdre de temps et à se régler au patron des amitiés molles et régulières, auxquelles il faut tant de précautions de longue et préalable conversation. Celle-ci n’a point d’autre idée que d’elle-même, et ne se peut rapporter qu’à soi. Ce n’est pas une spéciale considération, ni deux, ni trois, ni quatre, ni mille : c’est je ne sais quelle quintessence de tout ce mélange, qui ayant saisi toute ma volonté, l’amena se plonger et se perdre dans la sienne ; qui, ayant saisi toute sa volonté, l’amena se plonger et se perdre en la mienne, d’une faim, d’une concurrence pareille. Je dis perdre, à la vérité, ne nous réservant rien qui nous fût propre, ni qui fût ou sien, ou mien.
Au service de l’État royal
Au début de l’année 1661, envoyé auprès de la cour avec d’autres représentants du Parlement de Bordeaux, La Boétie rencontre Michel de l’Hospital, grand humaniste et chancelier de France. Quelques mois plus tard, alors que les troubles de religion s’intensifient, il est choisi pour participer à une mission de pacification en Agenais. On est encore, alors, à une période où la monarchie, sous l’influence de l’Hospital, cherche une voie moyenne qui permettrait la cohabitation pacifique des différentes communautés religieuses. Il s’agit moins, pour les agents du roi, de réprimer l’hérésie que d’assurer l’ordre civil. Les consignes du pouvoir royal sont claires sur ce point : « vous ferez bien entendre […] que vous ne venez point là pour les châtier pour le fait de la religion qu’ils tiennent, que vous n’êtes envoyé et n’avez commission de moi que de punir ceux qui abusent du nom de la religion à une infinité de scandales, violences, meurtres et séditions ». En Agenais, La Boétie s’acquitte de sa mission, en mettant au point, avec son chef Burie, une « résolution » qui fixe les règles de coexistence à respecter pour toutes les religions et toutes les couches sociales : préservation de l’ordre public, refus des provocations, partage équitable des lieux de culte, silence imposé sur les maux passés.
On situe généralement à la même époque (entre la fin de 1561 et l’été 1562) la rédaction par La Boétie d’une autre œuvre, à laquelle Montaigne fait allusion à deux reprises : le Sarladais serait l’auteur de Quelques Mémoires de nos troubles sur l’Edict de janvier 1562[25]. On a longtemps pensé ce texte perdu. Mais, au début des années 1920, un érudit a cru le découvrir dans une liasse de manuscrits conservés à la bibliothèque Méjanes d’Aix-en-Provence. La publication de cet écrit, désormais intitulé Mémoire sur la pacification des troubles ou Mémoire touchant l’édit de janvier 1562, a donné lieu à de vives controverses entre chercheurs. Car le contenu du texte semble contraster avec le ton et l’esprit frondeur du Discours de la servitude volontaire : l’auteur y apparaît comme un loyaliste, soucieux d’ordre, qui juge que « tout le mal » et les troubles que connaît alors le royaume tiennent à « la diversité de religion », et qui invite par conséquent le pouvoir à maintenir une unique religion (catholique) plutôt qu’à en tolérer deux. Pour beaucoup de spécialistes qui se sont penchés sur la question, l’attribution de ce Mémoire à la Boétie est tout simplement erronée. Mais, quand bien même on accepterait de voir en La Boétie l’auteur véridique du texte, le problème n’est pas si grand. Il n’y a pas lieu, en effet, d’opposer trop strictement le La Boétie du Discours, apôtre véhément de la liberté, et l’auteur « intolérant » du Mémoire. Ce dernier, en effet, ne condamne pas la religion réformée pour des raisons théologiques, mais parce qu’elle introduit au sein du royaume une dissension, établit en France « deux diverses républiques opposées de front l’une à l’autre », et, ce faisant, prépare la guerre civile. Il reconnaît d’ailleurs la pertinence de certaines critiques portées par les Réformateurs, regrette les « vices manifestes du clergé, la mauvaise vie, la vilenie, avarice » des ecclésiastiques. Ce qu’il envisage, c’est une réforme interne à l’Église catholique, qui, en mettant un terme aux abus et en proposant des accommodements sur certains points disputés, satisferait et ramènerait dans son giron « le grand nombre » des protestants. L’objectif, ici, n’est pas de préserver à tout prix une catholicité rigide, mais bien de défendre l’ordre et la paix civile, à la fois en restaurant l’autorité d’une monarchie arbitrale et en rassemblant les fidèles séparés. C’est, en somme, la ligne que suivent, à cette époque, les autorités, et en premier lieu Michel de l’Hospital. On n’est alors en France qu’à l’orée des guerres de Religion, et l’hypothèse d’un grand concile permettant de réconcilier catholiques et « mal-sentants de la foi » n’est pas encore écartée. La grande radicalisation et la polarisation du royaume en deux camps irréductibles ne viendront qu’ensuite.
À partir de 1562, la situation se tend dans le royaume, et notamment dans le Bordelais. À Bordeaux même, les modérés sont mis en difficulté par le parti catholique intransigeant. On sait relativement peu de choses sur l’activité de La Boétie durant ces temps troublés. Seules quelques traces archivistiques subsistent, qui permettent de supposer qu’il continue à jouer un rôle significatif dans l’élite de la ville, s’acquitte de sa tâche de parlementaire, et se range parmi les parlementaires fidèles au pouvoir royal.
Mort de La Boétie, survie du Discours
À l’été 1563, au retour d’une mission en Périgord et en Agenais, La Boétie est saisi par la maladie et doit s’aliter. Il ne lui reste que quelques jours à vivre. Tout au long de son agonie, il a à ses côtés le fidèle Montaigne, qui nous a laissé un témoignage précis et poignant dans une lettre à son père. La Boétie, sachant sa fin proche, met ses affaires en ordre, s’entretient avec son ami :
Mon frère, que j’aime si chèrement et que j’avais choisi parmi tant d’hommes, pour renouveler avec vous cette vertueuse et sincère amitié, de laquelle l’usage est par les vices dès si longtemps éloigné d’entre nous qu’il n’en reste que quelques vieilles traces en la mémoire de l’antiquité, je vous supplie pour signal de mon affection envers vous, vouloir être successeur de ma bibliothèque et de mes livres que je vous donne : présent bien petit, mais qui part de bon cœur, et qui vous est concevable pour l’affection que vous avez aux Lettres. Ce vous sera μνημοσυνον tui sodalis [en souvenir de ton ami].
Peu à peu, son état empire. Enfin, note Montaigne, « tirant à soi un grand soupir, il rendit l’âme, sur les trois heures du mercredi matin dix-huitième d’août, l’an mil cinq cent soixante-trois après avoir vécu 32 ans, sept mois et dix-sept jours »[26].
Mort jeune, avant d’avoir pu donner sa pleine mesure politique et philosophique, en tout cas avant d’avoir pu confier ses œuvres à l’impression, La Boétie risquait fort de sombrer dans l’oubli. Sans surprise, c’est Montaigne qui sera le gardien et le promoteur de sa mémoire. Sept ans après la disparition de La Boétie, il fait publier les traductions et les poésies de son ami, en veillant à dédier chacun de ces ouvrages à des personnages célèbres, qui pourront assurer leur diffusion posthume (notamment L’Hospital et Henri de Mesmes, c’est-à-dire des serviteurs du pouvoir royal, d’esprit plutôt modéré). En outre, il trace le portrait du disparu, et avec quelle ferveur, dans son propre livre, les Essais – dont on a pu dire qu’ils étaient conçus comme un écrin, un « tombeau » dédié à l’ami défunt. La Boétie y est dépeint comme un « esprit moulé au patron d’autres siècles que ceux-ci »[27], comme « une âme à la vieille marque, et qui eût produit de grands effets si la fortune l’eût voulu »[28], comme un républicain égaré dans une France monarchique (« Et sais davantage que, s’il eût eu à choisir, il eût mieux aimé être né à Venise qu’à Sarlat ; et avec raison »[29]).
« Une si mal plaisante saison »
Mais surtout, Montaigne envisage d’insérer l’œuvre maîtresse de La Boétie, le sulfureux Discours de la servitude volontaire, au cœur même de son propre livre. Pourtant, quand paraît la première édition des Essais, en 1580, le Discours n’y figure pas. Au centre du monument de papier, l’écrivain a préféré faire figurer les sonnets de son ami, bien tournés, mais de moindre importance… Dans son chapitre « De l’amitié », Montaigne explique son choix : les temps ont changé ; le Discours, rédigé dans la paix des années 1540, prendrait un tout autre sens dans la France des années 1580, déchirée par la lutte fratricide entre communautés religieuses. Montaigne ne veut pas « abandonner » le texte de La Boétie « au grossier et pesant air d’une si mal plaisante saison »[30], ni contribuer au malentendu entretenu, autour du Discours, par ceux qui s’en servent pour « troubler et changer l’état de notre police ». L’allusion, obscure pour le lecteur d’aujourd’hui, est claire pour celui du XVIe siècle : Montaigne veut se démarquer des publicistes protestants qui ont enrôlé le texte de La Boétie dans leur lutte à mort contre la monarchie française. Ce sont les réformés, en effet, qui ont procuré dans les années 1570 les premières éditions imprimées du texte, en le détournant, voire en le tronquant, et en l’affublant de titres de leur invention. Dès 1574, le Discours était ainsi inséré dans le Réveille-matin des François, pamphlet dirigé contre les Valois, dépeints en tyrans sanguinaires. Trois ans plus tard, un éditeur protestant le baptise Contr’un ; un autre l’intitule Vive description de la Tyrannie et des Tyrans, avec les moyens de se garantir de leur joug.
Les leçons du Discours
Un cri contre la tyrannie, donc ? Sans doute. La Boétie s’étonne que l’être humain, né pour la liberté et pour la raison, soit, comme l’écrira plus tard Rousseau, « partout dans les fers ». Que le peuple, qui a le nombre et la force pour lui, se soumette aux volontés d’un seul, qui le maltraite. C’est bien ainsi – comme une charge éloquente contre le tyran, comme un appel à la désobéissance et à la révolte – que le Discours a été lu. C’est comme tel qu’il a été mobilisé, tout au long de l’histoire, par les rebelles à l’ordre établi, depuis les adversaires de la monarchie absolue jusqu’aux résistants antifascistes, en passant par les contestataires du XIXe siècle[31].
Mais si La Boétie s’en était tenu à une noble déclamation contre le mauvais prince, son Discours n’aurait pas la même force, ni la même importance pour nous. En vérité, son propos va plus loin.
C’est qu’il ne suffit pas d’un tyran pour faire une tyrannie. Le tyran n’est pas capable, seul, d’imposer sa loi à tous. Considéré objectivement et isolément, il n’est qu’un petit homme, un « hommeau », aussi faible qu’un autre. Si le peuple n’était pas, pour une part au moins, disposé à servir, le pouvoir du monarque serait nul.
Et voilà précisément ce qui intéresse la Boétie : saisir ce qui permet au tyran et à son régime inique de « tenir » ; comprendre ce qui assure la consistance de l’ordre tyrannique, la pérennité de la domination, la stabilité d’un système social et politique que tous, ou presque, devraient refuser et mettre à bas. Sur quoi repose le pouvoir du tyran ? Pour que son ordre inique tienne, il faut que les sujets se tiennent tranquilles, passifs. Il faut, en un mot, qu’ils consentent.
Pour obtenir passivité et consentement, une première arme est la contrainte physique : il faut l’armée, la police, les gens d’armes. Mais la coercition physique se voit ; un régime d’oppression militaire est vite haï. Et puis, la force est faible : une autre force peut la briser. Bref, ce ne sont pas tant « les hallebardes, les gardes et le guet qui garantissent le tyran ». Il y a d’autres mécanismes, d’autres vecteurs, non moins efficaces, qui permettent d’obtenir le consentement du peuple. Dans son Discours, qu’on peut lire comme un traité de sociologie politique avant l’heure, La Boétie analyse et dénonce ces autres moyens, qui permettent d’installer l’amour de l’ordre établi jusqu’au cœur des sujets.
- Le Prince doit d’abord, en abusant du langage, dissimuler ses vrais motifs et travestir le sens de ses actes. Il ne fait jamais le mal « sans l’orner de quelque joli propos du Bien public et soulagement commun ». Cette pratique récurrente du mensonge, cette manière de mésuser des mots produisent une confusion des esprits, dont le tyran sait tirer profit.
- Le pouvoir doit aussi impressionner les sujets, pour mieux s’établir au-dessus d’eux. Tout l’apparat de l’ancienne monarchie – les « fleurs de lys, l’ampoule et l’oriflamme » – vient sacraliser le souverain, lui confère un halo mystique et une autorité paternelle. Chacun est appelé à s’en remettre au monarque, être supérieur, à la fois élu de Dieu et père de ses sujets, qui guide et qui protège.
- Autre ressort : l’intérêt personnel. Le pouvoir doit savoir distribuer les ressources à ses affidés, dans les hautes sphères ; mais il doit aussi abandonner des miettes à une partie au moins de la population. Pour se l’attacher, « les tyrans f[on]t largesse » (d’un peu de blé, de vin, d’une pièce) au menu peuple. Ceux sur qui ruisselle cette maigre manne se sentent ainsi solidaires du monde tel qu’il est ; tous ont à perdre (ou plutôt, croient avoir à perdre) à un changement de régime.
- Le pouvoir du tyran repose également sur l’oubli et l’ignorance organisés. Il s’agit d’effacer de la mémoire humaine le souvenir de leur liberté native, et tous les exemples anciens d’émancipation : en somme, faire croire que rien d’autre que l’ordre établi, rien de différent, rien de noble, rien de juste n’est possible. Il faut accoutumer les hommes au servage, afin que, « sans regarder plus avant, [ils] se contentent de vivre comme ils sont nés, et ne pensent point avoir autre bien ni autre droit que ce qu’ils ont trouvé » et « prennent pour leur naturel l’état de leur naissance ».
- Dernière recette pour faire un peuple consentant : l’avilissement par le divertissement. La Boétie pointe « cette ruse des tyrans d’abêtir leurs sujets » : en donnant au peuple « des bordels, tavernes et jeux publics », en l’étourdissant avec « les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes étranges, les médailles, les tableaux et autres drogueries », on capte et détourne l’attention du peuple, on le dissuade de penser ; on lui fait désirer des choses sans importance ; on mobilise ses instincts les plus bas et on le convainc qu’il n’est bon à rien d’autre qu’à courir d’un spectacle à l’autre, d’une jouissance à l’autre.
Voilà ce qui fait la force et l’inaltérable modernité de La Boétie : il a compris qu’il ne suffit pas de commander aux sujets ; il faut qu’ils soient « enchantés et charmés » par le pouvoir. Il faut créer et entretenir en eux une « opiniâtre volonté de servir ». Il faut des institutions et des pratiques qui non seulement rendent la tyrannie acceptable, mais installent le consentement, l’amour de l’ordre tyrannique, au cœur même du sujet. Ce sont ces institutions, ces pratiques que La Boétie nous invite à analyser pour mieux combattre leurs effets, en nous et dans la société.
Et maintenant, comme disait Montaigne, « oyons un peu parler ce garçon de dix-huit ans »…
Discours de la servitude volontaire[32]
Homère raconte qu’un jour, parlant en public, Ulysse dit aux Grecs :
« Il n’est pas bon d’avoir plusieurs maîtres ; n’en ayons qu’un seul. »
S’il eût seulement dit : il n’est pas bon d’avoir plusieurs maîtres, c’eût été si bien, que rien de mieux ; mais, tandis qu’avec plus de raison, il aurait dû dire que la domination de plusieurs ne pouvait être bonne, puisque la puissance d’un seul, dès qu’il prend ce titre de maître, est dure et révoltante ; il vient ajouter au contraire : n’ayons qu’un seul maître.
Toutefois il faut bien excuser Ulysse d’avoir tenu ce langage qui lui servit alors pour apaiser la révolte de l’armée, adaptant, je pense, son discours plus à la circonstance qu’à la vérité. Mais en conscience n’est-ce pas un extrême malheur que d’être assujetti à un maître de la bonté duquel on ne peut jamais être assuré et qui a toujours le pouvoir d’être méchant quand il le voudra ? Et obéir à plusieurs maîtres, n’est-ce pas être autant de fois extrêmement malheureux ? Je n’aborderai pas ici cette question tant de fois agitée ! « Si la république est ou non préférable à la monarchie ». Si j’avais à la débattre, avant même de rechercher quel rang la monarchie doit occuper parmi les divers modes de gouverner la chose publique, je voudrais savoir si l’on doit même lui en accorder un, attendu qu’il est bien difficile de croire qu’il n’y ait vraiment rien de public dans cette espèce de gouvernement où tout est à un seul. Mais réservons pour un autre temps cette question, qui mériterait bien son traité à part et amènerait d’elle-même toutes les disputes politiques.
Pour le moment, je désirerais seulement qu’on me fit comprendre comment il se peut que tant d’hommes, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois tout d’un Tyran seul, qui n’a de puissance que celle qu’on lui donne, qui n’a de pouvoir de leur nuire, qu’autant qu’ils veulent bien l’endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal, s’ils n’aimaient mieux tout souffrir de lui, que de le contredire. Chose vraiment surprenante (et pourtant si commune, qu’il faut plutôt en gémir que s’en étonner), c’est de voir des millions de millions d’hommes, misérablement asservis, et soumis tête baissée, à un joug déplorable, non qu’ils y soient contraints par une force majeure, mais parce qu’ils sont fascinés et, pour ainsi dire, ensorcelés par le seul nom d’un qu’ils ne devraient redouter, puisqu’il est seul, ni chérir puisqu’il est, envers eux tous, inhumain et cruel. Telle est pourtant la faiblesse des hommes ! Contraints à l’obéissance, obligés de temporiser, divisés entre eux, ils ne peuvent pas toujours être les plus forts. Si donc une nation, enchaînée par la force des armes, est soumise au pouvoir d’un seul (comme la cité d’Athènes le fut à la domination des trente tyrans[33]), il ne faut pas s’étonner qu’elle serve, mais bien déplorer sa servitude, ou plutôt ne s’en étonner, ni s’en plaindre ; supporter le malheur avec résignation et se réserver pour une meilleure occasion à venir.
Nous sommes ainsi faits que les communs devoirs de l’amitié absorbent une bonne part de notre vie. Aimer la vertu, estimer les belles actions, être reconnaissant des bienfaits reçus, et souvent même réduire notre propre bien-être pour accroître l’honneur et l’avantage de ceux que nous aimons et qui méritent d’être aimés : tout cela est très naturel. Si donc les habitants d’un pays trouvent, parmi eux, un de ces hommes rares qui leur ait donné des preuves réitérées d’une grande prévoyance pour les garantir, d’une grande hardiesse pour les défendre, d’une grande prudence pour les gouverner ; s’ils s’habituent insensiblement à lui obéir ; si même ils se confient à lui jusqu’à lui accorder une certaine suprématie, je ne sais si c’est agir avec sagesse que de l’ôter de là où il faisait bien, pour le placer où il pourra mal faire, cependant il semble très naturel et très raisonnable d’avoir de la bonté pour celui qui nous a procuré tant de biens et de ne pas craindre que le mal nous vienne de lui.
Mais ô grand Dieu ! Qu’est donc cela ? Comment appellerons-nous ce vice, cet horrible vice ? N’est-ce pas honteux, de voir un nombre infini d’hommes, non seulement obéir, mais ramper, non pas être gouvernés, mais tyrannisés, n’ayant ni biens, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soient à eux ? Souffrir les rapines, les brigandages, les cruautés, non d’une armée, non d’une horde de barbares, contre lesquels chacun devrait défendre sa vie au prix de tout son sang, mais d’un seul ; mais d’un hommeau, souvent le plus lâche, le plus vil et le plus efféminé de la nation, qui n’a jamais flairé la poudre des batailles, mais à peine foulé le sable des tournois ; qui est inhabile, non seulement à commander aux hommes, mais aussi à satisfaire la moindre femmelette ! Nommerons-nous cela lâcheté ? Appellerons-nous vils et couards les hommes soumis à un tel joug ? Si deux, si trois, si quatre cèdent à un seul ; c’est étrange, mais toutefois possible ; peut-être avec raison, pourrait-on dire : c’est faute de cœur. Mais si cent, si mille se laissent opprimer par un seul, dira-t-on encore que c’est de la couardise, qu’ils n’osent se prendre à lui, ou plutôt que, par mépris et dédain, ils ne veulent lui résister ? Enfin, si l’on voit non pas cent, non pas mille, mais cent pays, mille villes, un million d’hommes ne pas assaillir, ne pas écraser celui qui, sans ménagement aucun, les traite tous comme autant de serfs et d’esclaves : comment qualifierons-nous cela ? Est-ce lâcheté ? Mais pour tous les vices, il est des bornes qu’ils ne peuvent dépasser. Deux hommes et même dix peuvent bien en craindre un, mais que mille, un million, mille villes ne se défendent pas contre un seul homme ! Oh ! Ce n’est pas seulement couardise, elle ne va pas jusque-là ; de même que la vaillance n’exige pas qu’un seul homme escalade une forteresse, attaque une armée, conquière un royaume ! Quel monstrueux vice est donc celui-là que le mot de couardise ne peut rendre, pour lequel toute expression manque, que la nature désavoue et la langue refuse de nommer ?…
Qu’on mette, de part et d’autre, cinquante mille hommes en armes ; qu’on les range en bataille ; qu’ils en viennent aux mains ; les uns libres, combattant pour leur liberté, les autres pour la leur ravir : auxquels croyez-vous que restera la victoire ? Lesquels iront plus courageusement au combat, de ceux dont la récompense doit être le maintien de leur liberté, ou de ceux qui n’attendent pour salaire des coups qu’ils donnent ou reçoivent que la servitude d’autrui ? Les uns ont toujours devant leurs yeux le bonheur de leur vie passée et l’attente d’un pareil aise pour l’avenir. Ils pensent moins aux peines, aux souffrances momentanées de la bataille qu’aux tourments que, vaincus, ils devront endurer à jamais, eux, leurs enfants, et toute leur prospérité. Les autres n’ont pour tout aiguillon qu’une petite pointe de convoitise qui s’émousse soudain contre le danger et dont l’ardeur factice s’éteint presque aussitôt dans le sang de leur première blessure. Aux batailles si renommées de Miltiade, de Léonidas, de Thémistocle[34], qui datent de deux mille ans et vivent encore aujourd’hui, aussi fraîches dans les livres et la mémoire des hommes que si elles venaient d’être livrées récemment en Grèce, pour le bien de la Grèce et pour l’exemple du monde entier, qu’est-ce qui donna à un si petit nombre de Grecs, non le pouvoir, mais le courage de repousser ces flottes formidables dont la mer pouvait à peine supporter le poids, de combattre et de vaincre tant et de si nombreuses nations que tous les soldats grecs ensemble n’auraient point élevé en nombre les capitaines des armées ennemies ? Mais aussi, dans ces glorieuses journées, c’était moins la bataille des Grecs contre les Perses, que la victoire de la liberté sur la domination, de l’affranchissement sur l’esclavage.
Ils sont vraiment miraculeux les récits de la vaillance que la liberté met dans le cœur de ceux qui la défendent ! Mais ce qui advient, partout et tous les jours, qu’un homme seul opprime cent mille et les prive de leur liberté : qui pourrait le croire, si cela n’était qu’un ouï-dire et n’arrivait pas à chaque instant et sous nos propres yeux ? Encore, si ce fait se passait dans des pays lointains et qu’on vint nous le raconter, qui de nous ne le croirait controuvé et inventé à plaisir ? Et pourtant ce tyran, seul, il n’est pas besoin de le combattre, ni même de s’en défendre ; il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à la servitude. Il ne s’agit pas de lui rien arracher, mais seulement de ne lui rien donner. Qu’une nation ne fasse aucun effort, si elle veut, pour son bonheur, mais qu’elle ne travaille pas elle-même à sa ruine. Ce sont donc les peuples qui se laissent, ou plutôt se font garrotter, puisqu’en refusant seulement de servir, ils briseraient leurs liens. C’est le peuple qui s’assujettit et se coupe la gorge : qui, pouvant choisir d’être sujet ou d’être libre, repousse la liberté et prend le joug, qui consent, qui consent à son mal ou plutôt le pourchasse. S’il lui coûtait quelque chose pour recouvrer sa liberté je ne l’en presserais point : bien que rentrer dans ses droits naturels et, pour ainsi dire, de bête de redevenir homme, soit vraiment ce qu’il doive avoir le plus à cœur. Et pourtant je n’exige pas de lui une si grande hardiesse : je ne veux pas même qu’il ambitionne une je ne sais quelle assurance de vivre plus à son aise. Mais quoi ! Si pour avoir la liberté, il ne faut que la désirer ; s’il ne suffit pour cela que du vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qui croie la payer trop cher en l’acquérant par un simple souhait ? Et qui regrette volonté à recouvrer un bien qu’on devrait racheter au prix du sang, et dont la seule perte rend à tout homme d’honneur la vie amère et la mort bienfaisante ? Certes, ainsi que le feu d’une étincelle devient grand et toujours se renforce, et plus il trouve de bois à brûler, plus il en dévore, mais se consume et finit par s’éteindre de lui-même quand on cesse de l’alimenter : pareillement plus les tyrans pillent, plus ils exigent ; plus ils ruinent et détruisent, plus on leur fournit, plus on les gorge ; ils se fortifient d’autant et sont toujours mieux disposés à anéantir et à détruire tout ; mais si on ne leur donne rien, si on ne leur obéit point ; sans les combattre, sans les frapper, ils demeurent nus et défaits : semblables à cet arbre qui ne recevant plus de suc et d’aliment à sa racine, n’est bientôt qu’une branche sèche et morte.
Pour acquérir le bien qu’il souhaite, l’homme entreprenant ne redoute aucun danger, le travailleur n’est rebuté par aucune peine. Les lâches seuls, et les engourdis, ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien qu’ils se bornent à convoiter. L’énergie d’y prétendre leur est ravie par leur propre lâcheté ; il ne leur reste que le désir naturel de le posséder. Ce désir, cette volonté innée, commune aux sages et aux fous, aux courageux et aux couards, leur fait souhaiter toutes choses dont la possession les rendrait heureux et contents. Il en est une seule que les hommes, je ne sais pourquoi, n’ont pas même la force de désirer. C’est la liberté : bien si grand et si doux ! que dès qu’elle est perdue, tous les maux s’ensuivent, et que, sans elle, tous les autres biens, corrompus par la servitude, perdent entièrement leur goût et leur saveur. La seule liberté, les hommes la dédaignent, uniquement, ce me semble, parce que s’ils la désiraient, ils l’auraient : comme s’ils se refusaient à faire cette précieuse conquête, parce qu’elle est trop aisée.
Pauvres gens et misérables, peuples insensés, nations opiniâtres en votre mal et aveugles en votre bien, vous vous laissez enlever, sous vos propres yeux, le plus beau et le plus clair de votre revenu, piller vos champs, dévaster vos maisons et les dépouiller des vieux meubles de vos ancêtres ! Vous vivez de telle sorte que rien n’est plus à vous. Il semble que vous regarderiez désormais comme un grand bonheur qu’on vous laissât seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. Et tout ce dégât, ces malheurs, cette ruine enfin, vous viennent, non pas des ennemis, mais bien certes de l’ennemi et de celui-là même que vous avez fait ce qu’il est, pour qui vous allez si courageusement à la guerre et pour la vanité duquel vos personnes y bravent à chaque instant la mort. Ce maître n’a pourtant que deux yeux, deux mains, un corps et rien de plus que n’a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu’il a de plus que vous, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. D’où tire-t-il les innombrables argus[35] qui vous épient, si ce n’est de vos rangs ? Comment a-t-il tant de mains pour vous frapper, s’il ne les emprunte de vous ? Les pieds dont il foule vos cités, ne sont-ils pas aussi les vôtres ? A-t-il pouvoir sur vous, que par vous-mêmes ? Comment oserait-il vous courir sus, s’il n’était d’intelligence avec vous ? Quel mal pourrait-il vous faire si vous n’étiez receleur du larron qui vous pille, complice du meurtrier qui vous tue, et traîtres de vous-mêmes ? Vous semez vos champs, pour qu’il les dévaste ; vous meublez et remplissez vos maisons afin qu’il puisse assouvir sa luxure ; vous nourrissez vos enfants, pour qu’il en fasse des soldats (trop heureux sont-ils encore !) pour qu’il les mène à la boucherie, qu’il les rende ministres de ses convoitises, les exécuteurs de ses vengeances. Vous vous usez à la peine, afin qu’il puisse se mignarder en ses délices et se vautrer dans ses sales plaisirs. Vous vous affaiblissez, afin qu’il soit plus fort, plus dur et qu’il vous tienne la bride plus courte : et de tant d’indignités, que les bêtes elles-mêmes ne sentiraient point ou n’endureraient pas, vous pourriez vous en délivrer, sans même tenter de le faire, mais seulement en essayant de le vouloir. Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres. Je ne veux pas que vous le heurtiez, ni que vous l’ébranliez, mais seulement ne le souteniez plus, et vous le verrez, comme un grand colosse dont on dérobe la base, tomber de son propre poids et se briser.
Les médecins disent qu’il est inutile de chercher à guérir les plaies incurables, et peut-être, ai-je tort de vouloir donner ces conseils au peuple, qui, depuis longtemps, semble avoir perdu tout sentiment du mal qui l’afflige, ce qui montre assez que sa maladie est mortelle. Cherchons cependant à découvrir, s’il est possible, comment s’est enracinée si profondément cette opiniâtre volonté de servir qui ferait croire qu’en effet l’amour même de la liberté n’est pas si naturel.
Premièrement, il est, je crois, hors de doute que si nous vivions avec les droits que nous tenons de la nature et d’après les préceptes qu’elle enseigne, nous serions naturellement soumis à nos parents, sujets de la raison, mais non esclaves de personne. Certes, chacun de nous ressent en soi, dans son propre cœur, l’impulsion toute instinctive de l’obéissance envers ses père et mère. Quant à savoir si la raison est en nous innée ou non (question débattue à fond dans les académies et longuement agitée dans les écoles de philosophes), je ne pense pas errer en croyant qu’il est en notre âme un germe de raison, qui, réchauffé par les bons conseils et les bons exemples, produit en nous la vertu ; tandis qu’au contraire, étouffé par les vices qui trop souvent surviennent, ce même germe avorte. Mais ce qu’il y a de clair et d’évident pour tous, et que personne ne saurait nier, c’est que la nature, premier agent de Dieu, bienfaitrice des hommes, nous a tous créés de même et coulés, en quelque sorte, au même moule, pour nous montrer que nous sommes tous égaux, ou plutôt tous frères. Et si, dans le partage qu’elle nous a fait de ses dons, elle a prodigué quelques avantages de corps ou d’esprit, aux uns plus qu’aux autres, toutefois elle n’a jamais pu vouloir nous mettre en ce monde comme en un champ clos, et n’a pas envoyé ici-bas les plus forts et les plus adroits comme des brigands armés dans une forêt pour y traquer les plus faibles. Il faut croire plutôt, que faisant ainsi les parts, aux uns plus grandes, aux autres plus petites, elle a voulu faire naître en eux l’affection fraternelle et les mettre à même de la pratiquer ; les uns ayant puissance de porter des secours et les autres besoin d’en recevoir : ainsi donc, puisque cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeure, nous a tous logés sous le même grand toit, et nous a tous pétris de même pâte, afin que, comme en un miroir, chacun put se reconnaître dans son voisin ; si elle nous a fait, à tous, ce beau présent de la voix et de la parole pour nous aborder et fraterniser ensemble, et par la communication et l’échange de nos pensées nous ramener à la communauté d’idées et de volontés ; si elle a cherché, par toutes sortes de moyens à former et resserrer le nœud de notre alliance, les liens de notre société ; si enfin, elle a montré en toutes choses le désir que nous fussions, non seulement unis, mais qu’ensemble nous ne fissions, pour ainsi dire, qu’un seul être, dès lors, peut-on mettre un seul instant en doute que nous avons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous égaux, et peut-il entrer dans l’esprit de personne que nous ayant mis tous en même compagnie, elle ait voulu que quelques-uns y fussent en esclavage.
Mais en vérité est-ce bien la peine de discuter pour savoir si la liberté est naturelle, puisque nul être, sans qu’il en ressente un tort grave, ne peut être retenu en servitude et que rien au monde n’est plus contraire à la nature (pleine de raison) que l’injustice. Que dire encore ? Que la liberté est naturelle, et, qu’à mon avis, non seulement nous naissons avec notre liberté, mais aussi avec la volonté de la défendre. Et s’il s’en trouve par hasard qui en doute encore et soient tellement abâtardis qu’ils méconnaissent les biens et les affections innées qui leur sont propres, il faut que je leur fasse l’honneur qu’ils méritent et que je hisse, pour ainsi dire, les bêtes brutes en chaire pour leur enseigner et leur nature et leur condition. Les bêtes (Dieu me soit en aide !) si les hommes veulent les comprendre, leur crient : Vive la liberté ! Plusieurs d’entre elles meurent sitôt qu’elles sont prises. Telles que le poisson qui perd la vie dès qu’on le retire de l’eau, elles se laissent mourir pour ne point survivre à leur liberté naturelle. (Si les animaux avaient entre eux des rangs et des prééminences, ils feraient, à mon avis, de la liberté leur noblesse.) D’autres, des plus grandes jusqu’aux plus petites, lorsqu’on les prend, font une si grande résistance des ongles, des cornes, des pieds et du bec qu’elles démontrent assez, par-là, quel prix elles attachent au bien qu’on leur ravit. Puis, une fois prises, elles donnent tant de signes apparents du sentiment de leur malheur, qu’il est beau de les voir, dès lors, languir plutôt que vivre, ne pouvant jamais se plaire dans la servitude et gémissant continuellement de la privatisation de leur liberté. Que signifie, en effet, l’action de l’éléphant, qui, s’étant défendu jusqu’à la dernière extrémité, n’ayant plus d’espoir, sur le point d’être pris, heurte sa mâchoire et casse ses dents contre les arbres, sinon qu’inspiré par le grand désir de rester libre, comme il l’est par nature, il conçoit l’idée de marchander avec les chasseurs, de voir si, pour le prix de ses dents, il pourra se délivrer, et si, son ivoire, laissé pour rançon, rachètera sa liberté. Et le cheval ! Dès qu’il est né, nous le dressons à l’obéissance ; et cependant, nos soins et nos caresses n’empêchent pas que, lorsqu’on veut le dompter, il ne morde son frein, qu’il ne rue quand on l’éperonne ; voulant naturellement indiquer par-là (ce me semble) que s’il sert, ce n’est pas de bon gré, mais bien par contrainte.
Que dirons-nous encore ?… Les bœufs eux-mêmes gémissent sous le joug, les oiseaux pleurent en cage. Comme je l’ai dit autrefois en rimant, dans mes instants de loisir.
Ainsi donc[36], puisque tout être, qui a le sentiment de son existence, sent le malheur de la sujétion et recherche la liberté : puisque les bêtes, celles-là même créées pour le service de l’homme, ne peuvent s’y soumettre qu’après avoir protesté d’un désir contraire ; quel malheureux vice a donc pu tellement dénaturer l’homme, seul vraiment né pour vivre libre, jusqu’à lui faire perdre la souvenance de son premier état et le désir même de le reprendre ?
Il y a trois sortes de tyrans. Je parle des mauvais Princes. Les uns possèdent le Royaume par l’élection du peuple, les autres par la force des armes, et les autres par succession de race. Ceux qui l’ont acquis par le droit de la guerre, s’y comportent, on le sait trop bien et on le dit avec raison, comme en pays conquis. Ceux qui naissent rois, ne sont pas ordinairement meilleurs ; nés et nourris au sein de la tyrannie, ils sucent avec le lait naturel du tyran, ils regardent les peuples qui leur sont soumis comme leurs serfs héréditaires ; et, selon le penchant auquel ils sont le plus enclins, avares ou prodigues, ils usent du Royaume comme de leur propre héritage. Quant à celui qui tient son pouvoir du peuple, il semble qu’il devrait être plus supportable, et il le serait, je crois, si dès qu’il se voit élevé en si haut lieu, au-dessus de tous les autres, flatté par je ne sais quoi, qu’on appelle grandeur, il ne prenait la ferme résolution de n’en plus descendre. Il considère presque toujours la puissance qui lui a été confiée par le peuple comme devant être transmise à ses enfants. Or, dès qu’eux et lui ont conçu cette funeste idée, il est vraiment étrange de voir de combien ils surpassent en toutes sortes de vices, et même en cruautés, tous les autres tyrans. Ils ne trouvent pas de meilleur moyen pour consolider leur nouvelle tyrannie que d’accroître la servitude et d’écarter tellement les idées de liberté de l’esprit de leurs sujets, que, pour si récent qu’en soit le souvenir, bientôt il s’efface entièrement de leur mémoire. Ainsi, pour dire vrai, je vois bien entre ces tyrans quelque différence, mais pas un choix à faire : car s’ils arrivent au trône par des routes diverses, leur manière de régner est toujours à peu près la même. Les élus du peuple le traitent comme un taureau à dompter ; les conquérants, comme une proie sur laquelle ils ont tous les droits ; les successeurs, comme tout naturellement.
À ce propos, je demanderai : si le hasard voulait qu’il naquît aujourd’hui quelques gens tout à fait neufs, n’étant ni accoutumés à la sujétion, ni affriandés à la liberté, ignorant jusqu’aux noms de l’une et de l’autre, et qu’on leur offrit l’option d’être sujets ou de vivre libre ; quel serait leur choix ? Nul doute qu’ils n’aimassent beaucoup mieux obéir à leur seule raison que de servir un homme, à moins qu’ils ne fussent comme ces juifs d’Israël, qui, sans motifs, ni contrainte aucune, se donnèrent un tyran, et, desquels, je ne lis jamais l’histoire sans éprouver un extrême dépit qui me porterait presque à être inhumain envers eux, jusqu’à me réjouir de tous les maux qui, par la suite, leur advinrent. Car pour que les hommes, tant qu’il reste en eux vestige d’homme, se laissent assujettir, il faut de deux choses l’une : ou qu’ils soient contraints, ou qu’ils soient abusés : contraints, soit par les armes étrangères, comme Sparte et Athènes le furent par Alexandre ; soit par les factions, comme lorsque, bien avant ce temps, le gouvernement d’Athènes tomba aux mains de Pisistrate[37]. Abusés, ils perdent aussi leur liberté ; mais c’est alors moins souvent par la séduction d’autrui que par leur propre aveuglement. Ainsi, le peuple de Syracuse (jadis capitale de la Sicile), assailli de tous côtés par des ennemis, ne songeant qu’au danger du moment, et sans prévoyance de l’avenir, élut Denys Ier, et lui donna le commandement général de l’armée. Ce peuple ne s’aperçût qu’il l’avait fait aussi puissant que lorsque ce fourbe adroit, rentrant victorieux dans la ville, comme s’il eût vaincu ses concitoyens plutôt que leurs ennemis, se fit d’abord capitaine roi et ensuite roi tyran. On ne saurait s’imaginer jusqu’à quel point un peuple, ainsi assujetti par la fourberie d’une traître, tombe dans l’avilissement, et même dans un tel profond oubli de tous ses droits, qu’il est presque impossible de le réveiller de sa torpeur pour les reconquérir, servant si bien et si volontiers qu’on dirait, à la voir, qu’il n’a pas perdu seulement sa liberté, mais encore sa propre servitude, pour s’engourdir dans le plus abrutissant esclavage[38]. Il est vrai de dire qu’au commencement, c’est bien malgré soi et par force que l’on sert ; mais ensuite on s’y fait et ceux qui viennent après, n’ayant jamais connu la liberté, ne sachant pas même ce que c’est, servent sans regret et font volontairement ce que leurs pères n’avaient fait que par la contrainte. Ainsi les hommes qui naissent sous le joug, nourris et élevés dans le servage sans regarder plus avant, se contentent de vivre comme ils sont nés, et ne pensant point avoir d’autres droits, ni d’autres biens que ceux qu’ils ont trouvés à leur entrée dans la vie, ils prennent pour leur état de nature, l’état même de leur naissance. Toutefois il n’est pas d’héritier, pour si prodigue ou nonchalant qu’il soit, qui ne porte un jour les yeux sur ses registres pour voir s’il jouit de tous les droits de sa succession, et vérifier si l’on n’a pas empiété sur les siens ou sur ceux de son prédécesseur. Cependant l’habitude qui, en toutes choses, exerce un si grand empire sur toutes nos actions, a surtout le pouvoir de nous apprendre à servir : c’est elle qui à la longue (comme on nous le raconte de Mithridate qui finit par s’habituer au poison) parvient à nous faire avaler, sans répugnance, l’amer venin de la servitude. Nul doute que ce ne soit la nature qui nous dirige d’abord suivant les penchants bons ou mauvais qu’elle nous a donnés ; mais aussi faut-il convenir qu’elle a encore moins de pouvoir sur nous que l’habitude ; car, pour si bon que soit le naturel, il se perd s’il n’est entretenu ; tandis que l’habitude nous façonne toujours à sa manière en dépit de nos penchants naturels. Les semences de bien que la nature met en nous sont si frêles et si minces, qu’elles ne peuvent résister au moindre choc des passions ni à l’influence d’une éducation qui les contrarie. Elles ne se conservent pas mieux, s’abâtardissent aussi facilement et même dégénèrent ; comme il arrive à ces arbres fruitiers qui ayant tous leur propre, la conservent tant qu’on les laisse venir naturellement ; mais la perdent, pour porter des fruits tout à fait différents, dès qu’on les a greffés. Les herbes ont aussi chacune leur propriété, leur naturel, leur singularité : mais cependant, le froid, le temps, le terrain ou la main du jardinier, détériorent ou améliorent toujours leur qualité ; la plante qu’on a vue dans un pays n’est souvent plus reconnaissable dans un autre. Celui qui verrait chez eux les Vénitiens, poignée de gens qui vivent si librement que le plus malheureux d’entre eux ne voudrait pas être roi et qui, tous aussi nés et nourris, ne connaissent d’autre ambition que celle d’aviser pour le mieux au maintien de leur liberté ; ainsi appris et formés dès le berceau, qu’ils n’échangeraient pas un brin de leur liberté pour toutes les autres félicités humaines : qui verrait, dis-je, ces hommes, et s’en irait ensuite, en les quittant, dans les domaines de celui que nous appelons le grand-seigneur, trouvant là des gens qui ne sont nés que pour le servir et qui dévouent leur vie entière au maintien de sa puissance, penserait-il que ces deux peuples sont de même nature ? Ou plutôt ne croirait-il pas qu’une sortant d’une cité d’hommes, il est entré dans un parc de bêtes ? On raconte que Lycurgue, législateur de Sparte, avait nourri deux chiens, tous deux frères, tous deux allaités du même lait[39], et les avait habitués, l’un au foyer domestique et l’autre à courir les champs, au son de la trompe et du cornet. Voulant montrer aux Lacédémoniens l’influence de l’éducation sur le naturel, il exposa les deux chiens sur la place publique et mit entre eux une soupe et un lièvre : l’un courut au plat et l’autre au lièvre. Voyez, dit-il, et pourtant, ils sont frères ! Ce législateur sut donner une si bonne éducation aux Lacédémoniens que chacun d’eux eut préféré souffrir mille morts plutôt que de se soumettre à un maître ou de reconnaître d’autres institutions que celles de Sparte.
J’éprouve un certain plaisir à rappeler ici un mot des favoris de Xercès, le grand roi de Perse, au sujet des Spartiates : lorsque Xercès faisait ses préparatifs de guerre pour soumettre la Grèce entière, il envoya, dans plusieurs villes de ce pays, ses ambassadeurs pour demander de l’eau et de la terre (formule symbolique qu’employaient les Perses pour sommer les villes de se rendre), mais il se garda bien d’en envoyer, ni à Sparte, ni à Athènes, parce que les Spartiates et les Athéniens, auxquels son père Darius en avait envoyés auparavant pour faire semblable demande, les avaient jetés, les uns dans les fossés, les autres dans un puits, en leur disant : « Prenez hardiment, là, de l’eau et de la terre, et portez-les à votre prince ». En effet, ces fiers républicains ne pouvaient souffrir que, même par la moindre parole, on attentât à leur liberté. Cependant, pour avoir agi de la sorte, les Spartiates reconnurent qu’ils avaient offensé leurs dieux et surtout Talthybie, dieu des héraults. Ils résolurent donc, pour les apaiser, d’envoyer à Xercès deux de leurs concitoyens pour que, disposant d’eux à son gré, il pût se venger sur leurs personnes du meurtre des ambassadeurs de son père. Deux Spartiates, l’un nommé Sperthiès et l’autre Bulis, s’offrirent pour victimes volontaires. Ils partirent. Arrivés au palais d’un Perse, nommé Hydarnes, lieutenant du roi pour toutes les villes qui étaient sur les côtes de la mer, celui-ci les accueillit fort honorablement et après divers autres discours leur demanda pourquoi ils rejetaient si fièrement l’amitié du grand roi[40] ? « Voyez par mon exemple, leur ajouta-t-il, comment le Roi sait récompenser ceux qui méritent de l’être et croyez que si vous étiez à son service et qu’il vous eût connus, vous seriez tous deux gouverneurs de quelque ville grecque ». « En ceci, Hydarnes, tu ne pourrais nous donner un bon conseil, répondirent les Lacédémoniens ; car si tu as goûté le bonheur que tu nous promets, tu ignores entièrement celui dont nous jouissons. Tu as éprouvé la faveur d’un roi, mais tu ne sais pas combien est douce la liberté, tu ne connais rien de la félicité qu’elle procure. Oh ! Si tu en avais seulement une idée, tu nous conseillerais de la défendre, non seulement avec la lance et le bouclier, mais avec les ongles et les dents ». Les Spartiates seuls disaient vrai ; mais chacun parlait ici selon l’éducation qu’il avait reçue. Car il était impossible au Persan de regretter la liberté dont il n’avait jamais joui ; et les Lacédémoniens au contraire, ayant savouré cette douce liberté, ne concevaient même pas qu’on pût vivre dans l’esclavage.
Caton d’Utique, encore enfant et sous la férule du maître, allait souvent voir Sylla le dictateur, chez lequel il avait ses entrées libres, tant à cause du rang de sa famille que des liens de parenté qui les unissaient. Dans ces visites, il était toujours accompagné de son précepteur, comme c’était l’usage à Rome pour les enfants des nobles de ce temps-là. Un jour, il vit que, dans l’hôtel même de Sylla, en sa présence, ou par son commandement, on emprisonnait les uns, on condamnait les autres ; l’un était banni, l’autre étranglé ; l’un proposait la confiscation des biens d’un citoyen, l’autre demandait sa tête. En somme, tout s’y passait, non comme chez un magistrat de la ville, mais comme chez un tyran du peuple ; et c’était bien moins le sanctuaire de la justice qu’une caverne de tyrannie. Ce noble enfant dit à son percepteur : « Que ne me donnez-vous un poignard ? Je le cacherai sous ma robe. J’entre souvent dans la chambre de Sylla avant qu’il soit levé… j’ai le bras assez fort pour en délivrer la république ». Voilà vraiment la pensée d’un Caton ; c’est bien là le début d’une vie si digne de sa mort. Et néanmoins, taisez le nom et le pays, racontez seulement le fait tel qu’il est ; il parle de lui-même : ne dira-t-on pas aussitôt que cet enfant était Romain et né lorsqu’elle était libre. Pourquoi dis-je ceci ? Je ne prétends certes pas que le pays et le sol y changent quelque chose, car partout et en tous lieux l’esclavage est odieux aux hommes et la liberté leur est chère ; mais par ce qu’il me semble que l’on doit compatir à ceux qui, en naissant, se trouvent déjà sous le joug ; qu’on doit les excuser ou leur pardonner, si, n’ayant pas encore vu l’ombre même de la liberté, et n’en ayant jamais entendu parler, ils ne ressentent pas le malheur d’être esclave. Si en effet (comme le dit Homère des Cimmériens), il est des pays où le Soleil se montre tout différemment qu’à nous et qu’après les avoir éclairés pendant six mois consécutifs, il les laisse dans l’obscurité durant les autres six mois, serait-il étonnant que ceux qui naîtraient pendant cette longue nuit, s’ils n’avaient point ouï parler de la clarté, ni jamais vu le jour, s’accoutumassent aux ténèbres dans lesquelles ils sont nés et ne désirassent point la lumière ? On ne regrette jamais ce qu’on n’a jamais eu ; le chagrin ne vient qu’après le plaisir et toujours, à la connaissance du bien, se joint le souvenir de quelque joie passée. Il est dans la nature de l’homme d’être libre et de vouloir l’être ; mais il prend très facilement un autre pli, lorsque l’éducation le lui donne.
Disons donc que, si toutes les choses auxquelles l’homme se fait et se façonne lui deviennent naturelles, cependant celui-là seul reste dans sa nature qui ne s’habitue qu’aux choses simples et non altérées : ainsi la première raison de la servitude volontaire, c’est l’habitude ; comme il arrive aux plus braves courtauds[41] qui d’abord mordent leur frein et puis après s’en jouent ; qui, regimbant naguère sous la selle, se présentent maintenant d’eux-mêmes, sous le brillant harnais, et, tout fiers, se rengorgent et se pavanent sous l’armure qui les couvre. Ils disent qu’ils ont toujours été sujets, que leurs pères ont ainsi vécu. Ils pensent qu’ils sont tenus d’endurer le mors, s’en persuadent par des exemples et consolident eux-mêmes, par la durée, la possession de ceux qui les tyrannisent. Mais les années donnent-elles le droit de mal faire ? Et l’injure prolongée n’est-elle pas une plus grande injure ? Toujours en est-il certains qui, plus fiers et mieux inspirés que les autres, sentent le poids du joug et ne peuvent s’empêcher de le secouer ; que ne se soumettent jamais à la sujétion et qui, toujours et sans cesse (ainsi qu’Ulysse cherchant, par terre et par mer, à revoir la fumée de sa maison), n’ont garde d’oublier leurs droits naturels et s’empressent de les revendiquer en toute occasion. Ceux-là ayant l’entendement net et l’esprit clairvoyant, ne se contentent pas, comme les ignorants encroûtés, de voir ce qui est à leurs pieds, sans regarder ni derrière, ni devant ; ils rappellent au contraire les choses passées pour juger plus sainement le présent et prévoir l’avenir. Ce sont ceux qui, ayant d’eux-mêmes l’esprit droit, l’ont encore rectifié par l’étude et le savoir. Ceux-là, quand la liberté serait entièrement perdue et bannie de ce monde, l’y ramèneraient ; car la sentant vivement, l’ayant savourée et conservant son germe en leur esprit, la servitude ne pourrait jamais les séduire, pour si bien qu’on l’accoutrât.
Le grand Turc s’est bien aperçu que les livres et la saine doctrine inspirent plus que tout autre chose, aux hommes, le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie. Aussi, ai-je lu que, dans le pays qu’il gouverne, il n’est guère plus de savants qu’il n’en veut. Et partout ailleurs, pour si grand que soit le nombre des fidèles à la liberté, leur zèle et l’affection qu’ils lui portent restent sans effet, parce qu’ils ne savent s’entendre. Les tyrans leur enlèvent toute liberté de faire, de parler et quasi de penser, et ils demeurent totalement isolés dans leur volonté pour le bien : c’est donc avec raison que Momus[42] trouvait à redire à l’homme forgé par Vulcain de ce qu’il n’avait pas une petite fenêtre au cœur par où l’on pût voir ses plus secrètes pensées. On a rapporté que, lors de leur entreprise pour la délivrance de Rome, ou plutôt du monde entier, Brutus et Cassius ne voulurent point que Cicéron, ce grand et beau diseur si jamais il en fut, y participât, jugeant son cœur trop faible pour un si haut fait. Ils croyaient bien à son bon vouloir, mais non à son courage. Et toutefois, qui voudra se rappeler les temps passés et compulser les anciennes annales, se convaincra que presque tous ceux qui, voyant leur pays malmené et en mauvaises mains, formèrent le dessein de le délivrer, en vinrent facilement à bout, et que, pour son propre compte, la liberté vient toujours à leur aide ; ainsi Harmodius et Dion[43], qui conçurent un si vertueux projet, l’exécutèrent heureusement. Pour de tels exploits, presque toujours le ferme vouloir garantit le succès. Cassius et Marcus Brutus réussirent en frappant César pour délivrer leur pays de la servitude ; ce fut lorsqu’ils tentèrent d’y ramener la liberté qu’ils périrent, il est vrai ; mais glorieusement, car, qui oserait trouver rien de blâmable, ni en leur vie, ni en leur mort ? Celle-ci fut au contraire un grand malheur et causa l’entière ruine de la république, qui, ce me semble, fut enterrée avec eux. Les autres tentatives essayées depuis contre les empereurs romains ne furent que des conjurations de quelques ambitieux dont l’irréussite et la mauvaise fin ne sont pas à regretter, étant évident qu’ils désiraient, non renverser le trône, mais avilir seulement la couronne ne visant qu’à chasser le tyran et à retenir la tyrannie. Quant à ceux-là, je serais bien fâché qu’ils eussent réussi et je suis content qu’ils aient montré par leur exemple qu’il ne faut pas abuser du saint nom de la liberté pour accomplir un mauvais dessein.
Mais, revenant à mon sujet, que j’avais quasi perdu de vue, la première raison pour laquelle les hommes servent volontairement, c’est qu’ils naissent serfs et qu’ils sont élevés dans la servitude. De celle-là découle naturellement cette autre : que, sous les tyrans, les hommes deviennent nécessairement lâches et efféminés, ainsi que l’a fort judicieusement, à mon avis, fait remarquer le grand Hippocrate, le père de la médecine, dans l’un de ses livres intitulé Des maladies[44]. Ce digne homme avait certes le cœur bon et le montra bien lorsque le roi de Perse voulut l’attirer près de lui à force d’offres et de grands présents ; car il lui répondit franchement qu’il se ferait un cas de conscience de s’occuper à guérir les Barbares qui voulaient détruire les Grecs et de faire rien qui pût être utile à celui qui écrivit à ce sujet, se trouve parmi les autres œuvres, et témoignera toujours de son bon cœur et de son beau caractère. Il est donc certain qu’avec la liberté, on perd aussitôt la vaillance : les esclaves n’ont ni ardeur, ni constance dans le combat. Ils n’y vont que comme contraints, pour ainsi dire engourdis, et s’acquittant avec peine d’un devoir : ils ne sentent pas brûler dans leur cour le feu sacré de la liberté qui fait affronter tous les périls et désirer une belle et glorieuse mort qui nous honore à jamais auprès de nos semblables. Parmi les hommes libres, au contraire, c’est à l’envi, à qui mieux mieux, tous pour chacun et chacun pour tous : ils savent qu’ils recueilleront une égale part au malheur de la défaite ou au bonheur de la victoire ; mais les esclaves, entièrement dépourvus de courage et de vivacité, ont le cœur bas et mou et sont incapables de toute grande action. Les tyrans le savent bien : aussi font-ils tous leurs efforts pour les rendre toujours plus faibles et plus lâches.
L’historien Xénophon, l’un des plus dignes et des plus estimés parmi les Grecs, a fait un livre peu volumineux, dans lequel se trouve un dialogue entre Simonide et Hiéron, roi de Syracuse, sur les misères du tyran. Ce livre est plein de bonnes et graves remontrances, qui, selon moi, ont aussi une grâce infinie. Plût à Dieu que tous les tyrans qui aient jamais été l’eussent placé devant eux en guise de miroir. Ils y auraient certainement reconnu leurs propres vices et en auraient rougi de honte. Ce traité parle de la peine qu’éprouvent les tyrans, qui, nuisant à tous, sont obligés de craindre tout le monde. Il dit, entre autres choses, que les mauvais rois prennent à leur service des troupes étrangères, n’osant plus mettre les armes aux mains de leurs sujets qu’ils ont maltraités de mille manières. Quelques rois, en France même (plus encore autrefois qu’aujourd’hui), ont eu à leur solde des troupes étrangères, mais c’était plutôt pour épargner leurs propres sujets, ne regardant point, pour atteindre ce but, à la dépense que cet entretien nécessitait. Aussi, était-ce l’opinion de Scipion (du grand Africain, je pense) qui aimait mieux, disait-il, avoir sauvé la vie à un citoyen que d’avoir défait cent ennemis. Mais ce qu’il y a de bien positif, c’est que le tyran ne croit jamais sa puissance assurée, s’il n’est parvenu à ce point de n’avoir pour sujets que des hommes, sans valeur aucune. On pourrait lui dire à juste titre ce que, d’après Térence, Thrason disait au maître des éléphants : « Vous vous croyez brave, parce que vous avez dompté des bêtes ? ».
Mais cette ruse des tyrans d’abêtir leurs sujets, n’a jamais été plus évidente que dans la conduite de Cyrus envers les Lydiens, après qu’il se fut emparé de Sardes, capitale de Lydie et qu’il eût pris et emmené captif Crésus, ce tant riche roi, qui s’était rendu et remis à sa discrétion. On lui apporta la nouvelle que les habitants de Sardes s’étaient révoltés. Il les eût bientôt réduits à l’obéissance. Mais ne voulant ni saccager une aussi belle ville, ni être toujours obligé d’y tenir une armée pour la maîtriser, il s’avisa d’un expédient extraordinaire pour s’en assurer la possession : il établit des maisons de débauches et de prostitution, des tavernes et des jeux publics et rendit une ordonnance qui engageait les citoyens à se livrer à tous ces vices. Il se trouva si bien de cette espèce de garnison, que, par la suite, il ne fût plus dans le cas de tirer l’épée contre les Lydiens. Ces misérables gens s’amusèrent à inventer toutes sortes de jeux, si bien que de leur nom même les Latins formèrent le mot par lequel ils désignaient ce que nous appelons passe-temps, qu’ils nommaient, eux, Lundi, par corruption de Lydie. Tous les tyrans n’ont pas déclaré aussi expressément qu’ils voulussent efféminer leurs sujets ; mais de fait, ce que celui-là ordonna si formellement, la plupart d’entre eux l’ont fait occultement. À vrai dire, c’est assez le penchant naturel de la portion ignorante du peuple qui, d’ordinaire, est plus nombreuse dans les villes. Elle est soupçonneuse envers celui qui l’aime et se dévoue pour elle, tandis qu’elle est confiante envers celui qui la trompe et la trahit. Ne croyez pas qu’il y ait nul oiseau qui se prenne mieux à la pipée, ni aucun poisson qui, pour la friandise, morde plus tôt et s’accroche plus vite à l’hameçon, que tous ces peuples qui se laissent promptement allécher et conduire à la servitude, pour la moindre douceur qu’on leur débite ou qu’on leur fasse goûter. C’est vraiment chose merveilleuse qu’ils se laissent aller si promptement, pour peu qu’on les chatouille. Les théâtres, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, la compensation de leur liberté ravie, les instruments de la tyrannie. Ce système, cette pratique, ces allèchements étaient les moyens qu’employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets dans la servitude. Ainsi, les peuples abrutis, trouvant beaux tous ces passe-temps, amusés d’un vain plaisir qui les éblouissait, s’habituaient à servir aussi niaisement mais plus mal encore que les petits enfants n’apprennent à lire avec des images enluminées. Les tyrans romains renchérirent encore sur ces moyens, en festoyant souvent les hommes des décuries, en gorgeant ces gens abrutis et les flattant par où ils étaient plus faciles à prendre : le plaisir de la bouche. Aussi le plus instruit d’entre eux n’eût pas quitté son écuelle de soupe pour recouvrer la liberté de la République de Platon. Les tyrans faisaient ample largesse du quart de blé, du septier de vin, du sesterce ; et alors c’était vraiment pitié d’entendre crier vive le roi ! Les lourdauds ne s’apercevaient pas qu’en recevant toutes ces choses, ils ne faisaient que recouvrer une part de leur propre bien ; et que cette portion même qu’ils en recouvraient, le tyran n’aurait pu la leur donner, si, auparavant, il ne l’eût enlevée à eux-mêmes. Tel ramassait aujourd’hui le sesterce, tel se gorgeait, au festin public, en bénissant et Tibère et Néron de leur libéralité qui, le lendemain, était contraint d’abandonner ses biens à l’avarice, ses enfants à la luxure, son rang même à la cruauté de ces magnifiques empereurs, ne disait mot, pas plus qu’une pierre et ne se remuait pas plus qu’une souche. Le peuple ignorant et abruti a toujours été de même. Il est, au plaisir qu’il ne peut honnêtement recevoir, tout ouvert et dissolu ; au tort et à la douleur qu’il ne peut raisonnablement supporter, tout à fait insensible. Je ne vois personne maintenant qui, entendant parler seulement de Néron, ne tremble au seul nom de cet exécrable monstre, de cette vilaine et sale bête féroce, et cependant, il faut le dire, après sa mort, aussi dégoûtante que sa vie, ce fameux peuple romain en éprouva tant de déplaisir (se rappelant ses jeux et ses festins) qu’il fut sur le point d’en porter le deuil. Ainsi du moins nous l’assure Cornélius Tacite, excellent auteur, historien des plus véridiques et qui mérite toute croyance[45]. Et l’on ne trouvera point cela étrange, si l’on considère ce que ce même peuple avait fait à la mort de Jules César, qui foula aux pieds toutes les lois et asservit la liberté romaine. Ce qu’on exaltait surtout (ce me semble) dans ce personnage, c’était son humanité, qui, quoiqu’on l’ait tant prônée, fut plus funeste à son pays que la plus grande cruauté du plus sauvage tyran qui ait jamais vécu ; parce qu’en effet ce fut cette fausse bonté, cette douceur empoisonnée qui emmiella le breuvage de la servitude pour le peuple romain. Aussi après sa mort ce peuple-là, qui avait encore en la bouche le goût de ses banquets et à l’esprit la souvenance de ses prodigalités, amoncela[46] les bancs de la place publique pour lui en faire honorablement un grand bûcher et réduire son corps en cendres ; puis il lui éleva une colonne comme Père de la patrie (ainsi portait le chapiteau), et enfin il lui rendit plus d’honneur, tout mort qu’il était, qu’il n’en aurait dû rendre à homme du monde, si ce n’est à ceux qui l’avaient tué. Les empereurs romains n’oubliaient pas surtout de prendre le titre de tribun du peuple, tant parce que cet office était considéré comme saint et sacré, que parce qu’il établit pour la défense et protection du peuple et qu’il était le plus en faveur dans l’État. Par ce moyen ils s’assuraient que ce peuple se fierait plus à eux, comme s’il lui suffisait d’ouïr le nom de cette magistrature, sans en ressentir les effets.
Mais ils ne font guère mieux ceux d’aujourd’hui qui, avant de commettre leurs crimes, même les plus révoltants, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien général, l’ordre public et le soulagement des malheureux. Vous connaissez fort bien le formulaire dont ils ont fait si souvent et si perfidement usage. Et bien, dans certains d’entre eux, il n’y a même plus de place à la finesse tant et si grande est leur impudence. Les rois d’Assyrie, et, après eux, les rois Mèdes, ne paraissaient en public que le plus tard possible, pour faire supposer au peuple qu’il y avait en eux quelque chose de surhumain et laisser en cette rêverie les gens qui se montent l’imagination sur les choses qu’ils n’ont point encore vues. Ainsi tant de nations, qui furent assez longtemps sous l’empire de ces rois mystérieux, s’habituèrent à la servir, et les servaient d’autant plus volontiers qu’ils ignoraient quel était leur maître, ou même s’ils en avaient un ; de manière qu’ils vivaient ainsi dans la crainte d’un être que personne n’avait vu.
Les premiers rois d’Égypte ne se montraient guère sans porter, tantôt une branche, tantôt du feu sur la tête : ils se masquaient ainsi et se transformaient en bateleurs. Et pour cela pour inspirer, par ces formes étranges, respect et admiration à leurs sujets, qui, s’ils n’eussent pas été si stupide ou si avilis, n’auraient dû que s’en moquer et en rire. C’est vraiment pitoyable d’ouïr parler de tout ce que faisaient les tyrans du temps passé pour fonder leur tyrannie ; combien de petits moyens ils se servaient pour cela, trouvant toujours la multitude ignorante tellement disposée à leur gré, qu’ils n’avaient qu’à tendre un piège à sa crédulité pour qu’elle vint s’y prendre ; aussi n’ont-ils jamais eu plus de facilité à la tromper et ne l’ont jamais mieux asservie, que lorsqu’ils s’en moquaient le plus.
Que dirai-je d’une autre sornette que les peuples anciens prirent pour une vérité avérée. Ils crurent fermement que l’orteil de Pyrrhus, roi d’Épire, faisait des miracles et guérissait des maladies de la rate. Ils enjolivèrent encore mieux ce conte, en ajoutant : que lorsqu’on eût brûlé le cadavre de ce roi, cet orteil se trouva dans les cendres, intact et non atteint par le feu. Le peuple a toujours ainsi sottement fabriqué lui-même des contes mensongers, pour y ajouter ensuite une foi incroyable. Bon nombre d’auteurs les ont écrits et répétés, mais de telle façon qu’il est aisé de voir qu’ils les ont ramassés dans les rues et carrefours. Vespasien, revenant d’Assyrie, et passant par Alexandrie pour aller à Rome s’emparer de l’empire, fit, disent-ils, des choses miraculeuses. Il redressait les boiteux, rendait clairvoyants les aveugles, et mille autres choses qui ne pouvaient être crues, à mon avis, que par des imbéciles plus aveugles que ceux qu’on prétendait guérir. Les tyrans eux-mêmes trouvaient fort extraordinaire que les hommes souffrissent qu’un autre les maltraita. Ils se couvraient volontiers du manteau de la religion et s’affublaient quelquefois des attributs de la divinité pour donner plus d’autorité à leurs mauvaises actions. Entre autres, Salmonée, qui, pour s’être ainsi moqué du peuple auquel il voulut faire accroire qu’il était Jupiter, se trouve maintenant au fin fond de l’enfer où (selon la sibylle de Virgile, qui l’y a vu) il expie son audace sacrilège :
Là des fils d’Aloüs gisent les corps énormes,
ceux qui, fendant les airs de leurs têtes difformes
osèrent attenter aux demeurent des Dieux,
et du trône éternel chasser le Roi des cieux,
Là, j’ai vu de ces Dieux le rival sacrilège,
pour arracher au peuple un criminel encens,
de quatre fiers coursiers aux pieds retentissants
attelant un vain char dans l’Élide tremblante,
une torche à la main y semaient l’épouvante :
insensé, qui, du ciel prétendu souverain
par le bruit de son char et de son pont d’airain
du tonnerre imitait le bruit inimitable !
mais Jupiter lança le foudre véritable,
et renversa, couvert d’un tourbillon de feu,
le char, et les coursiers, et la foudre et le Dieu :
son triomphe fut court, sa peine est éternelle.
(Traduction de l’Énéide, par Delille, liv. 6.)
Si celui qui n’était qu’un sot orgueilleux se trouve là-bas si bien traité, je pense que ces misérables, qui ont abusé de la religion pour faire le mal, y seront à plus juste titre punis selon leurs œuvres.
Nos tyrans à nous, semèrent aussi en France je ne sais trop quoi : des crapauds, des fleurs de lys, l’ampoule, l’oriflamme. Toutes choses que, pour ma part, et comme qu’il en soit, je ne veux pas encore croire n’être que de véritables balivernes, puisque nos ancêtres les croyaient et que de notre temps nous n’avons eu aucune occasion de les soupçonner telles, ayant eu quelques rois, si bons en la paix, si vaillants en la guerre, que, bien qu’ils soient nés rois, il semble que la nature ne les aient pas faits comme les autres et que Dieu les ait choisis avant même leur naissance pour leur confier le gouvernement et la garde de ce royaume. Encore quand ces exceptions ne seraient pas, je ne voudrais pas entrer en discussion pour débattre la vérité de nos histoires, ni les éplucher trop librement pour ne point ravir ce beau thème, où pourront si bien s’escrimer ceux de nos auteurs qui s’occupent de notre poésie française, non seulement améliorée, mais, pour ainsi dire, refaite à neuf par nos poètes Ronsard, Baïf et du Bellay, qui en cela font tellement progresser notre langue que bientôt, j’ose espérer, nous n’aurons rien à envier aux Grecs et aux Latins, sinon le droit d’aînesse. Et certes, je ferais grand tort à notre rythme (j’use volontiers de ce mot qui me plaît) car bien que plusieurs l’aient rendu purement mécanique, je vois toutefois assez d’auteurs capables de l’anoblir et de lui rendre son premier lustre : je lui ferais, dis-je, grand tort, de lui ravir ces beaux contes du roi Clovis, dans lesquels avec tant de charmes et d’aisance s’exerce ce me semble, la verve de notre Ronsard en sa Franciade. Je pressens sa portée, je connais son esprit fin et la grâce de son style. Il fera son affaire de l’oriflamme, aussi bien que les Romains de leurs ancilles et des boucliers précités du ciel[47] dont parle Virgile. Il tirera de notre ampoule un aussi bon parti que les Athéniens firent de leur corbeille d’Erisicthone[48]. On parlera encore de nos armoiries dans la tour de Minerve. Et certes, je serais bien téméraire de démentir nos livres fabuleux et dessécher ainsi le terrain de nos poètes. Mais pour revenir à mon sujet, duquel je ne sais trop comment, je me suis éloigné, n’est-il pas évident que, pour se raffermir, les tyrans se sont continuellement efforcés d’habituer le peuple non seulement à l’obéissance et à la servitude, mais encore à une espèce de dévotion envers eux ? Tout ce que j’ai dit jusqu’ici sur les moyens employés par les tyrans pour asservir, n’est guère mis en usage par eux que sur la partie ignorante et grossière du peuple.
J’arrive maintenant à un point qui est, selon moi, le secret et le ressort de la domination, le soutien et le fondement de toute tyrannie. Celui qui penserait que les Hallebardes des gardes et l’établissement du guet garantissent les tyrans, se tromperait fort. Ils s’en servent plutôt, je crois, par forme et pour épouvantail, qu’ils ne s’y fient. Les archers barrent bien l’entrée des palais aux moins habiles, à ceux qui n’ont aucun moyen de nuire ; mais non aux audacieux et bien armés qui peuvent tenter quelque entreprise. Certes, il est aisé de compter que, parmi les empereurs romains, il en est bien moins de ceux qui échappèrent au danger par le secours de leurs archers, qu’il y en eût de tués par leurs propres gardes. Ce ne sont pas les bandes de gens à cheval, les compagnies de gens à pied, en un mot ce ne sont pas les armes qui défendent un tyran, mais bien toujours (on aura quelque peine à le croire d’abord, quoique ce soit exactement vrai) quatre ou cinq hommes qui le soutiennent et qui lui assujettissent tout le pays. Il en a toujours été ainsi que cinq à six ont eu l’oreille du tyran et s’y sont approchés d’eux-mêmes ou bien y ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les complaisants de ses sales voluptés et les copartageants de ses rapines. Ces six dressent si bien leur chef, qu’il devient, envers la société, méchant, non seulement de ses propres méchancetés mais, encore des leurs. Ces six, en tiennent sous leur dépendance six mille qu’ils élèvent en dignité, auxquels ils font donner, ou le gouvernement des provinces, ou le maniement des deniers publics, afin qu’ils favorisent leur avarice ou leur cruauté, qu’ils les entretiennent ou les exécutent à point nommé et fassent d’ailleurs tant de mal, qu’ils ne puissent se maintenir que par leur propre tutelle, ni d’exempter des lois et de leurs peines que par leur protection. Grande est la série de ceux qui viennent après ceux-là. Et qui voudra en suivre la trace verra que non pas six mille, mais cent mille, des millions tiennent au tyran par cette filière et forment entre eux une chaîne non interrompue qui remonte jusqu’à lui. Comme Homère le fait dire à Jupiter qui se targue, en tirant une pareille chaîne, d’amener à lui tous les Dieux. De là venait l’accroissement du pouvoir du Sénat sous Jules César ; l’établissement de nouvelles fonctions, l’élection à des offices, non certes et à bien prendre, pour réorganiser la justice, mais bien pour donner de nouveaux soutiens à la tyrannie. En somme, par les gains et parts de gains que l’on fait avec les tyrans, on arrive à ce point qu’enfin il se trouve presque un aussi grand nombre de ceux auxquels la tyrannie est profitable, que de ceux auxquels la liberté serait utile. C’est ainsi qu’au dire des médecins, bien qu’en notre corps rien ne paraisse gâté, dès qu’en un seul endroit quelque tumeur se manifeste, toutes les humeurs se portent vers cette partie véreuse : pareillement, dès qu’un roi s’est déclaré tyran, tout le mauvais, toute la lie du royaume, je ne dis pas un tas de petits friponneaux et de faquins perdus de réputation, qui ne peuvent faire mal ni bien dans un pays, mais ceux qui sont possédés d’une ardente ambition et d’une notable avarice se groupent autour de lui et le soutiennent pour avoir part au butin et être, sous le grand tyran, autant de petits tyranneaux. Ainsi sont les grands voleurs et les fameux corsaires : les uns découvrent le pays, les autres pourchassent les voyageurs ; les uns sont en embuscade, les autres au guet ; les uns massacrent, les autres dépouillent ; et bien qu’il y ait entre eux des rangs et des prééminences et que les uns ne soient que les valets et les autres les chefs de la bande, à la fin il n’y en a pas un qui ne profite, si non du principal butin, du moins du résultat de la fouille. Ne dit-on pas que non seulement les pirates Ciliciens[49] se rassemblèrent en si grand nombre qu’il fallut envoyer contre eux le grand Pompée ; mais qu’en outre ils attirèrent à leur alliance plusieurs belles villes et grandes cités dans les havres desquelles revenant de leurs courses, il se mettaient en sûreté, donnant en échange à ces villes une portion des pillages qu’elles avaient recélés.
C’est ainsi que le tyran asservit les sujets les uns par les autres. Il est gardé par ceux desquels il devrait se garder, s’ils n’étaient avilis : mais, comme on l’a fort bien dit pour fendre le bois, il se fait des coins de bois même. Tels sont ses archers, ses gardes, ses hallebardiers. Non que ceux-ci ne souffrent souvent eux-mêmes de son oppression ; mais ces misérables, maudits de Dieu et des hommes, se contentent d’endurer le mal, pour en faire, non à celui qui le leur fait, mais bien à ceux qui, comme eux, l’endurent et n’y peuvent rien. Et toutefois, quand je pense à ces gens-là, qui flattent bassement le tyran pour exploiter en même temps et sa tyrannie et la servitude du peuple, je suis presque aussi surpris de leur stupidité que de leur méchanceté. Car, à vrai dire, s’approcher du tyran, est-ce autre chose que s’éloigner de la liberté et, pour ainsi dire, embrasser et serrer à deux mains la servitude ? Qu’ils mettent un moment à part leur ambition, qu’ils se dégagent un peu de leur sordide avarice, et puis, qu’ils se regardent, qu’ils se considèrent en eux-mêmes : ils verront clairement que ces villageois, ces paysans qu’ils foulent aux pieds et qu’ils traitent comme des forçats ou des esclaves, ils verront, dis-je, que ceux-là, ainsi malmenés, sont plus heureux et en quelque sorte plus libres qu’eux. Le laboureur et l’artisan, pour tant asservis qu’ils soient, en sont quittes en obéissant ; mais le tyran voit ceux qui l’entourent, coquinant et mendiant sa faveur. Il ne faut pas seulement qu’ils fassent ce qu’il ordonne, mais aussi qu’ils pensent ce qu’il veut, et souvent même, pour le satisfaire, qu’ils préviennent aussi ses propres désirs. Ce n’est pas tout de lui obéir, il faut lui complaire, il faut qu’ils se rompent, se tourmentent, se tuent à traiter ses affaires et puisqu’ils ne se plaisent que de son plaisir, qu’ils sacrifient leur goût au sien, forcent leur tempérament et le dépouillement de leur naturel. Il faut qu’ils soient continuellement attentifs à ses paroles, à sa voix, à ses regards, à ses moindres gestes : que leurs yeux, leurs pieds, leurs mains soient continuellement occupés à suivre ou imiter tous ses mouvements, épier et deviner ses volontés et découvrir ses plus secrètes pensées. Est-ce là vivre heureusement ? Est-ce même vivre ? Est-il rien au monde de plus insupportable que cet état, je ne dis pas pour tout homme bien né, mais encore pour celui qui n’a que le gros bon sens, ou même figure d’homme ? Quelle condition est plus misérable que celle de vivre ainsi n’ayant rien à soi et tenant d’un autre son aise, sa liberté, son corps et sa vie !
Mais ils veulent servir pour amasser des biens : comme s’ils pouvaient rien gagner qui fut à eux, puisqu’ils ne peuvent pas dire qu’ils sont à eux-mêmes. Et, comme si quelqu’un pouvait avoir quelque chose à soi sous un tyran, ils veulent pouvoir se dire possesseurs de biens, et ils oublient que ce sont eux qui lui donnent la force de ravir tout à tous, et de ne laisser rien qu’on puisse dire être à personne. Ils savent pourtant que ce sont les biens qui rendent les hommes plus dépendants de sa cruauté ; qu’il n’y a aucun crime envers lui et selon lui plus digne de mort, que l’indépendance, ou l’avoir de quoi ; qu’il n’aime que les richesses et s’attaque de préférence aux riches, qui viennent cependant se présenter à lui, comme les moutons devant un boucher, pleins et bien repus, comme pour exciter se voracité. Ces favoris ne devraient pas tant se souvenir de ceux qui ont gagné beaucoup de biens autour des tyrans, que de ceux qui s’y étant gorgés d’or pendant quelque temps, y ont perdu peu après et les biens et la vie. Il ne leur devrait pas venir tant à l’esprit combien d’autres y ont acquis des richesses, mais plutôt, combien peu de ceux-là les ont gardées. Qu’on parcoure toutes les anciennes histoires, que l’on considère et l’on verra parfaitement combien est grand le nombre de ceux qui, étant arrivés par d’indignes moyens jusqu’à l’oreille des princes, soit en flattant leurs mauvais penchants, soit en abusant de leur simplicité, ont fini par être écrasés par ces mêmes princes qui avaient mis autant de facilité à les élever qu’ils ont eu d’inconstance à les conserver. Certainement parmi le grand nombre de ceux qui se sont trouvés auprès des mauvais rois, il en est peu, ou presque point qui n’aient éprouvé quelques fois en eux-mêmes la cruauté du tyran qu’ils avaient auparavant attisée contre d’autres, et qui, s’étant le plus souvent enrichis, à l’ombre de sa faveur, des dépouilles d’autrui, n’aient eux-mêmes enrichi les autres de leur propre dépouille.
Les gens de bien même, si parfois il s’en trouve un seul aimé du tyran, pour si avant qu’ils soient dans sa bonne grâce, pour si brillantes que soient en eux la vertu et l’intégrité qui toujours vues de près, inspirent, même aux méchants, quelque respect ; ces gens de bien, dis-je, ne sauraient se soutenir auprès du tyran ; il faut qu’ils se ressentent aussi du mal commun, et qu’à leurs dépens ils éprouvent ce que c’est que la tyrannie. On peut en citer quelques-uns tels que : Sénèque, Burrhus, Trazéas, cette trinité de gens de bien, dont les deux premiers eurent le malheur de s’approcher d’un tyran qui leur confia le maniement de ses affaires : tous deux estimés et chéris par lui, dont l’un l’avait éduqué et tenait pour gage de son amitié les soins qu’il avait eus de son enfance ; mais ces trois-là seulement, dont la mort fut si cruelle, ne sont-ils pas des exemples suffisants du peu de confiance que l’on doit avoir dans de méchants maîtres. Et en vérité quelle amitié attendre de celui qui a le cœur assez dur pour haïr tout un royaume qui ne fait que lui obéir, et d’un être qui ne sachant aimer, s’appauvrit lui-même et détruit son propre empire ?
Or si on veut dire que Sénèque, Burrhus et Trazéas n’ont éprouvé ce malheur que pour avoir été trop gens de bien, qu’on cherche hardiment autour de Néron lui-même et on verra que tous ceux qui furent en grâce auprès de lui et qui s’y maintinrent par leur méchanceté, ne firent pas meilleure fin. Qui jamais a ouï parler d’un amour si effréné, d’une affection si opiniâtre ; qui a jamais vu d’hommes aussi obstinément attaché à une femme que celui-là le fut à Poppée[50] ? Agrippine sa mère, n’avait-elle pas, pour le placer sur le trône, tué son propre mari Claude, tout entrepris pour le favoriser, et même commis toutes sortes de crimes ? Et cependant son propre fils, son nourrisson, celui-là même qu’elle avait fait empereur de sa propre main[51], après l’avoir ravalée, lui ôta la vie ; personne ne nia qu’elle n’eût bien mérité cette punition à laquelle on eût généralement applaudi si elle avait été infligée par tout autre. Qui fut jamais plus aisé à manier, plus simple et, pour mieux dire, plus stupide que l’empereur Claude ? Qui fut jamais plus coiffé d’une femme que lui de Messaline ? Il la livra pourtant au bourreau. Les tyrans bêtes sont toujours bêtes quand il s’agit de faire le bien, mais je ne sais comment, à la fin, pour si peu qu’ils aient d’esprit, il se réveille en eux pour user de cruauté, même envers ceux qui leur tiennent de près. Il est assez connu le mot atroce de celui-là[52] qui voyait la gorge découverte de sa femme, de celle qu’il aimait le plus, sans laquelle il semblait qu’il ne put vivre, lui adressa ce joli compliment : « Ce beau cou sera coupé tout à l’heure, si je l’ordonne ». Voilà pourquoi la plupart des anciens tyrans ont presque tous été tués par leurs favoris qui ayant connu la nature de la tyrannie étaient peu rassurés sur la volonté du tyran et se défiaient continuellement de sa puissance. Ainsi Domitien fut tué par Stéphanus[53], Commode par une de ses maîtresses[54] ; Caracalla par le centurion Martial [55] excité par Macrin, et de même presque tous les autres.
Certainement le tyran n’aime jamais et jamais n’est aimé. L’amitié, c’est un nom sacré, c’est une chose sainte : elle ne peut exister qu’entre gens de bien, elle naît d’une mutuelle estime, et s’entretient non tant par les bienfaits que par bonne vie et mœurs. Ce qui rend un ami assuré de l’autre, c’est la connaissance de son intégrité. Il a, pour garants, son bon naturel, sa foi, sa constance ; il ne peut y avoir d’amitié où se trouvent la cruauté, la déloyauté, l’injustice. Entre méchants, lorsqu’ils s’assemblent, c’est un complot et non une société. Ils ne s’entretiennent pas, mais s’entrecraignent. Ils ne sont pas amis, mais complices.
Or, quand bien même cet empêchement n’existerait pas, il serait difficile de trouver en un tyran une amitié solide, parce qu’étant au-dessus de tous et n’ayant point de pair, il se trouve déjà au-delà des bornes de l’amitié, dont le siège n’est que dans la plus parfaite équité, dont la marche est toujours égale et où rien ne cloche. Voilà pourquoi il y a bien, dit-on, une espèce de bonne foi parmi les voleurs lors du partage du butin, parce qu’ils sont tous pairs et compagnons, et s’ils ne s’aiment, du moins, ils se craignent entre eux et ne veulent pas, en se désunissant, amoindrir leur force. Mais les favoris d’un tyran ne peuvent jamais se garantir de son oppression parce qu’ils lui ont eux-mêmes appris qu’il peut tout, qu’il n’y a, ni droit, ni devoir qui l’oblige, qu’il est habitué de n’avoir pour raison que sa volonté, qu’il n’a point d’égal et qu’il est maître de tous. N’est-il pas extrêmement déplorable que malgré tant d’exemples éclatants et un danger si réel, personne ne veuille profiter de ces tristes expériences et que tant de gens s’approchent encore si volontiers des tyrans et qu’il ne s’en trouve pas un qui ait le courage et la hardiesse de lui dire ce que dit (dans la fable) le renard au lion qui contrefaisait le malade : « J’irais bien te voir de bon cœur dans ta tanière ; mais je vois assez de traces de bêtes qui vont en avant vers toi, mais de celles qui reviennent en arrière, je n’en vois pas une ».
Ces misérables voient reluire les trésors du tyran ; ils admirent tout étonnés l’éclat de sa magnificence, et, alléchés par cette splendeur, ils s’approchent, sans s’apercevoir qu’ils se jettent dans la flamme, qui ne peut manquer de les dévorer. Ainsi l’indiscret satyre, comme le dit la fable, voyant briller le feu ravi par le sage Prométhée, le trouva si beau qu’il alla le baiser et se brûla[56]. Ainsi le papillon qui, espérant jouir de quelque plaisir se jette sur la lumière parce qu’il la voit briller, éprouve bientôt, comme dit Lucain, qu’elle a aussi la vertu de brûler. Mais supposons encore que ces mignons échappent des mains de celui qu’ils servent, ils ne se sauvent jamais de celles du roi qui lui succède. S’il est bon, il faut rendre compte et se soumettre à la raison ; s’il est mauvais et pareil à leur ancien maître, il ne peut manquer d’avoir aussi des favoris, qui d’ordinaire, non contents d’enlever la place des autres, leur arrachent encore et leurs biens et leur vie. Comment se peut-il donc qu’il se trouve quelqu’un qui, à l’aspect de si grands dangers et avec si peu de garantie, veuille prendre une position si difficile, si malheureuse et servir avec tant de périls un si dangereux maître ? Quelle peine, quel martyre, est-ce grand Dieu ! Être nuit et jour occupé de plaire à un homme, et néanmoins se méfier de lui plus que de tout autre au monde : avoir toujours l’œil au guet, l’oreille aux écoutes, pour épier d’où viendra le coup, pour découvrir les embûches, pour éventer la mine de ses concurrents, pour dénoncer qui trahit le maître ; rire à chacun, d’entre craindre toujours, n’avoir ni ennemi reconnu, ni ami assuré ; montrer toujours un visage riant et avoir le cœur transi : ne pouvoir être joyeux et ne pas oser être triste.
Mais il est vraiment curieux de considérer ce qui leur revient de tout ce grand tourment et le bien qu’ils peuvent attendre de leur peine et de cette misérable vie. D’ordinaire, ce n’est pas le tyran que le peuple accuse du mal dont il souffre, mais bien ceux qui gouvernent ce tyran. Ceux-là, le peuple, les nations, tout le monde à l’envi, jusques aux paysans, aux laboureurs, savent leurs noms, découvrent leurs vices, amassent sur eux mille outrages, mille injures, mille malédictions. Toutes les imprécations, tous les vœux sont tournés contre eux. Tous les malheurs, toutes les pestes, toutes les famines, ceux qu’ils appellent sujets les leur imputent ; et si, quelquefois, ils leur rendent en apparence quelques hommages, alors même ils les maudissent au fond de l’âme et les ont en plus grande horreur que les bêtes féroces. Voilà la gloire, voilà l’honneur qu’ils recueillent de leur service, aux yeux de ces gens qui, s’ils pouvaient avoir chacun un morceau de leur corps, ne seraient pas encore (ce me semble) satisfaits ni même à demi-consolés de leurs souffrances. Et, lors même que ces tyrans ne sont plus, les écrivains qui viennent après eux, ne manquent pas de noircir, de mille manières, la mémoire de ces mange-peuple. Leur réputation est déchirée dans mille livres, leurs os même sont, pour ainsi dire, traînés dans la boue par la postérité, et tout cela, comme pour les punir encore après leur mort, de leur méchante vie.
Apprenons donc enfin, apprenons à bien faire. Levons les yeux vers le ciel, et pour notre honneur, pour l’amour même de la vertu, adressons-nous à Dieu tout puissant, témoin de tous nos actes et juge de nos fautes. Pour moi, je pense bien, et ne crois point me tromper, que puisque rien n’est plus contraire à Dieu, souverainement juste et bon, que la tyrannie ; il réserve sans doute au fond de l’enfer, pour les tyrans et leurs complices, un terrible châtiment.
Conclusion : La Boétie et notre servitude présente
Resserrée sur quelques dizaines de pages, l’analyse de La Boétie est pénétrante. Et le Discours semble appartenir à ce petit nombre de textes dont le message ne se périme pas. L’intuition de La Boétie a rebondi de siècle en siècle. Au lieu de l’user, le temps semble avoir confirmé sa puissance et sa pertinence.
De siècle en siècle
À la veille de la Révolution française, par exemple, Marat publie un essai, Les Chaînes de l’esclavage, qui réactive (d’autres diraient : qui décalque) les idées du Discours. Le constat est le même : partout les peuples – qui devraient chérir et rechercher la liberté – marchent à la servitude. Cherchant à comprendre cette anomalie, Marat examine les moyens qui permettent aux princes de faire accepter et aimer leur despotisme. Il montre comment ils travaillent à « endormir » et « avilir » le peuple, pour que celui-ci perde à la fois « l’exercice » et la « connaissance de ses droits », qu’il « ne prenne plus de part aux affaires publiques, ne songe qu’à ses besoins & ses plaisirs » privés. Le mauvais prince gagne ses sujets par « des promesses », des « égards », des « cajoleries ». Il « épuise le zèle du peuple sur de faux objets », entretient l’ignorance, « dénature jusqu’au nom des choses ». Amollis et dupés, les sujets s’installent dans la résignation et l’impuissance, s’en accommodent, s’en satisfont même.
Un siècle plus tard, en 1911, c’est Jean Jaurès qui, dans un passage de son livre L’Armée nouvelle, retrouve, face à la foule apathique des grandes villes, des accents dignes de La Boétie[57] :
Je me souviens qu’il y a une trentaine d’années, arrivé tout jeune à Paris, je fus saisi un soir d’hiver, dans la ville immense, d’une sorte d’épouvante sociale. Il me semblait que les milliers et les milliers d’hommes qui passaient sans se connaître, foule innombrable de fantômes solitaires, étaient déliés de tout lien. Et je me demandai avec une sorte de terreur impersonnelle comment tous ces êtres acceptaient l’inégale répartition des biens et des maux, comment l’énorme structure sociale ne tombait pas en dissolution.
Je ne leur voyais pas de chaînes aux mains et aux pieds, et je me disais : par quel prodige ces milliers d’individus souffrants et dépouillés subissent-ils tout ce qui est ? Je ne voyais pas bien : la chaîne était au cœur, mais une chaîne dont le cœur lui-même ne sentait pas le fardeau ; la pensée était liée, mais d’un lien qu’elle-même ne connaissait pas. La vie avait empreint ses formes dans les esprits, l’habitude les y avait fixées ; le système social avait façonné ces hommes, il était en eux. Il était, en quelque façon, devenu leur substance même, et ils ne se révoltaient pas contre la réalité, parce qu’ils se confondaient avec elle.
Cet homme qui passait en grelottant aurait jugé sans doute moins insensé et moins difficile de prendre dans ses deux mains toutes les pierres du grand Paris pour se construire une maison nouvelle, que de refondre le système social, énorme, accablant et protecteur, où il avait, en quelque coin, son gîte d’habitude et de misère.
Aujourd’hui encore…
Et aujourd’hui ? Nous n’en avons pas fini avec la domination et l’iniquité. L’ordre économique, social et politique dans lequel nous vivons lamine les collectifs, broie les individus, gâche les intelligences, les énergies et les ressources ; et pourtant, rien ne semble devoir l’ébranler. La chaîne est toujours au cœur.
Qui ne voit pas que La Boétie parle aussi de notre monde ? Les outils de la tyrannie, sans doute, ont évolué, mais les recettes de la domination restent, dans le fond, les mêmes : impressionner le peuple ; acheter les consciences ; organiser l’oubli, l’ignorance et la résignation ; endormir, avilir et épointer les esprits…
- Aujourd’hui encore, le Prince et ses lieutenants abusent des mots pour tromper le public. Il ne s’agit pas seulement d’arrangements sporadiques avec la vérité, mais d’un recours systématique au mensonge et à la novlangue, dont l’effet est de saper le langage et les repères qu’il porte, de troubler les catégories socio-politiques, de brouiller les frontières (entre gauche et droite, paix et guerre, bien public et intérêts privés, etc.). Et, en définitive, de produire une désorientation générale qui permet aux dominants de prospérer.
- Aujourd’hui encore, le pouvoir cherche à s’élever au-dessus d’un peuple mineur, peuple inapte, peuple enfant à guider et à protéger. Certes, il n’est plus question de se présenter comme l’élu de Dieu, et comme un thaumaturge. Mais nos princes modernes adoptent des profils – homme providentiel, Sauveur, bon pasteur, golden boy, « personnage de roman », « politique-rockstar », « chef de guerre », protecteur, etc. – qui continuent de les placer au-dessus du commun des mortels et entretiennent la « religion du pouvoir » (Simone Weil). Résultat logique de cette glorification des chefs : narcissisme, hybris et abus au sommet ; « remise de soi », passivité et abstention massive à la base.
- Aujourd’hui encore, le Prince s’entoure d’obligés, dont il sert les intérêts privés (en puisant, souvent, dans les ressources publiques), et qui le servent en retour.
- Aujourd’hui encore, les dominants abandonnent au peuple des miettes (miettes de richesse, mais aussi bribes de pouvoir, illusions d’autonomie, promesses de sécurité, assurances identitaires ou gratifications symboliques), qui sont la contrepartie dérisoire de sa subordination, mais qui contribuent à le souder à l’ordre établi.
- Aujourd’hui encore, il s’agit de convaincre que rien n’est possible. On efface progressivement des programmes scolaires et des grilles médiatiques ce qui pourrait nourrir une conscience politique et offrir aux jeunes gens la profondeur historique ou les appuis conceptuels dont ils ont besoin pour penser une réalité différente. Et l’on va répétant, devant les micros et sur les plateaux de télévision, qu’il n’y a pas d’alternative – manière de naturaliser l’ordre établi.
- Aujourd’hui encore, on pratique l’avilissement par le divertissement. Grands médias, réseaux sociaux et autres institutions de police symbolique déversent en permanence un déluge d’images et de divertissement – racolage publicitaire intensif, déchaînements sportifs, faits-divers-faisant-diversion, odyssées people, polémiques fabriquées, pièges à buzz, etc. – qui fixent les attentions et les désirs, favorisent le néant de pensée et, sous des dehors festifs, entretiennent l’apathie. Cette « politique de dépolitisation » (Pierre Bourdieu) est le complément efficace de la bonne vieille propagande politique, qui n’a pas disparu, mais s’est au contraire étendue et sophistiquée.
Nouvelles servitudes
C’est ainsi que se perpétue le règne des mauvais princes. Mais il faut bien comprendre que les autorités politiques ne sont pas seules en cause ici. Si, en son temps, La Boétie visait le monarque, aujourd’hui son propos vaut, au-delà du champ strictement politique, pour d’autres maîtres ; il jette une lumière crue sur d’autres formes de la domination. Il faudrait un livre entier pour recenser tout ce qui, dans le monde d’aujourd’hui, relève de la « servitude volontaire » et confirme les analyses de la Boétie. Contentons-nous de quelques exemples.
Dans le monde du travail, les managers contemporains ont compris que, pour mettre les employés à la tâche, le plus efficace n’est pas, comme dans le modèle fordiste, de leur promettre un salaire, et par là de faire miroiter devant leurs yeux les joies (différées) de la consommation. Pour les mobiliser de manière optimale, pour les soumettre pleinement à l’ordre du travail, mieux vaut – c’est la trouvaille du management post-fordiste – les conduire à faire corps directement avec l’entreprise, les convaincre que c’est dans leur mission professionnelle elle-même (même prescrite par la hiérarchie de l’entreprise, même quand elle est absurde, aliénante, épuisante…) qu’ils doivent exister et se réaliser. Et c’est ainsi que l’on voit tant de gens collaborer, de leur propre mouvement, et avec ardeur, à un système d’organisation du travail qui les égare et les malmène, mais dont ils ont si profondément incorporé les normes qu’ils ne peuvent pas le remettre en question. On sait comment, trop souvent, se termine cette intériorisation de l’injonction managériale : dans l’effondrement intime du burn out notamment.
De même, le Discours et les idées de la Boétie peuvent servir à éclairer notre rapport à certaines technologies numériques. Car c’est sans renâcler, et même très volontiers, au fil d’activités jouissives, que nous livrons nos données et notre vie privée aux géants du net, alimentant ainsi la puissance des GAFAM. Nous ne cessons de consentir, ce faisant, au monde qu’ils construisent – un monde où les chiffres et la technique sont mis au service de la prédiction comportementale et de l’hyper-consommation d’une part, d’un renforcement de la surveillance et de la production d’une « société de contrôle » (Ignacio Ramonet) d’autre part. C’est de bon gré, « librement », en somme, que nous entrons dans la « prison algorithmique » (Philippe Vion-Dury).
Enfin, notre apathie collective devant la crise écologique peut être analysée à la lumière du concept de « servitude volontaire ». Nous savons que le modèle socio-économique dans lequel nous vivons nous conduit à la catastrophe. Cela ne fait aucun doute : les signes annonciateurs se multiplient, et les scientifiques unanimes appellent à changer de cap au plus vite. Nous ne pouvons ignorer la menace que nos modes de vie font peser sur nous-mêmes. Mais, à quelques activistes près, nous semblons incapables de sortir de ce modèle mortifère et d’emprunter une voie nouvelle. Incapables de « rompre le charme » et de « déstabiliser le business as usual » (Andreas Malm). C’est que, comme les citadins observés autrefois par Jaurès, nous nous confondons avec le système social – celui du productivisme, de l’hyperconsommation et de la vitesse – qui nous a façonnés. Nous y sommes insérés, nous y tenons par toutes nos fibres. L’idéologie consumériste et croissanciste dans laquelle nous baignons, la propagande publicitaire, l’habitude (des marchandises venues du monde entier et disponibles partout à tout moment de l’année ; de l’énergie sans restriction et à bas prix ; des transports individuels rapide, sans entraves…), le plaisir que procurent ces facilités : tout nous conduit à ne pas nous interroger (sur les conditions écologiques et sociales de ce modèle), à ne pas voir (ce qu’il coûte réellement), à ne pas agir. Servitude, puisque ce système menace de nous broyer. Volontaire, puisqu’une part de nous au moins y consent et en jouit.
« Soyez résolus de ne plus servir… » : les chemins de l’émancipation
Les filets de la servitude sont donc particulièrement serrés, aujourd’hui comme hier. Mais le Discours ne délivre pas pour autant un message résigné. La Boétie affirme qu’il y a, en chaque homme, une part de raison et une propension native à la liberté. Cette propension, gelée par les dispositifs que nous venons d’évoquer, peut se raviver. L’homme peut cesser de « déléguer sa raison et sa conscience à ses supérieurs », et refuser « la vie dans le mensonge » (Václav Havel). Il peut effectuer le pas de côté qui l’arrache à la servitude.
Cessez de consentir, dit La Boétie, et vous contribuerez à ruiner la pyramide des hiérarchies et des dominations. Cessez de servir, et vous pourrez construire un ordre plus juste et plus fraternel, où « personne [n’est] l’Un et ou tous [sont] pairs » (Jean-Michel Delacomptée), un ordre dont l’amicitia antique – cette amitié choisie et cultivée entre égaux, que La Boétie pratiqua avec Montaigne – offre en quelque sorte le modèle.
« Soyez résolus de ne plus servir, et vous voilà libres ». La célèbre formule de la Boétie lui a valu d’être taxé de naïveté. Mauvaise lecture, mauvais procès. Car le Discours ne dit pas qu’il suffit d’une sécession individuelle pour que l’ordre oppressif s’effondre ou s’évanouisse. Puisque ce sont – comme il le démontre – des institutions sociales qui activent et entretiennent en nous l’« opiniâtre volonté de servir », il faut, pour en finir avec la servitude, non seulement s’arracher individuellement à la domination, mais défaire ces institutions de servitude pour y substituer d’autres institutions, émancipatrices. Tout processus de libération engage le sujet, mais on ne se libère pas seul. En d’autres termes, la libération est à la fois un acte individuel et une œuvre collective, une discipline pour soi et un projet pour toutes et tous. L’un et l’autre s’appellent, se complètent, se renforcent.
Chez La Boétie, l’insoumission individuelle, l’appel à l’insurrection de la conscience, s’accompagne d’une réflexion sur les mécanismes sociaux de la domination. En cela, il est un modèle. Il éclaire la voie et nous pouvons, encore, nous inspirer de lui.
Pour un humanisme de combat
Plus largement, il y a encore beaucoup à puiser à la source humaniste. « Humanisme » : le terme paraît usé, bien sûr. Comme « République », comme « Renaissance », il a été utilisé à tort et à travers, vidé de sa substance. Il a traîné dans trop de bouches. On a lessivé le mot et obscurci l’idée. Mais l’humanisme n’est pas ce qu’on croit ordinairement. Ce n’est pas un sentiment vague et consensuel ; c’est une doctrine de combat, une conception du monde indissociable d’une lutte pluriséculaire pour l’émancipation. La pensée humaniste a été développée et enrichie par les Lumières au XVIIIe siècle ; aux XIXe et XXe, elle a nourri le meilleur de la tradition socialiste. Aujourd’hui encore, elle garde son actualité, son acuité, et même son tranchant.
Qu’on en juge. Les humanistes de la Renaissance ont fait le pari de la connaissance et de la raison critique. Ils ont questionné les autorités, passé au crible les dogmes qui pesaient sur eux. Ils ont, comme le résume l’écrivain Jean Rouaud, inauguré « le temps de la puce à l’oreille », celui où l’on s’y reprend « à deux fois/ avant de gober la version que les clercs/ se repassent comme un mistigri sacré depuis cinquante générations »[58]. Serions-nous donc sortis de ce temps ? N’avons-nous pas, nous aussi, besoin de la raison critique, à l’heure où prospère la désinformation de masse, et où les obscurantismes de tous poils redressent la tête ? N’avons-nous pas, nous aussi, grand besoin de contester et congédier quelques clercs – à commencer par ceux qui, depuis des décennies, nous ont imposé la religion du Marché ?
Les humanistes ont affirmé que l’avenir est ouvert, que les êtres humains peuvent faire leur histoire, et qu’il leur revient de bâtir la cité terrestre selon leurs propres valeurs et non suivant une Loi transcendante – ordre de Dieu ou ordre de l’Économie. Ils ont soutenu qu’une Cité digne de ce nom est celle qui accorde une place égale à tous ses citoyens, leur offre les conditions de leur plein développement, et permet à chacun de participer à la conduite des affaires publiques. Ils ont posé que la bonne organisation sociale, et la seule légitime, est celle qui favorise l’humanisation de l’humain, celle qui le civilise au lieu de l’ensauvager. Là encore, comment ne pas reconnaître que la leçon reste d’actualité ? Ce que nous avons sous les yeux – creusement des inégalités, recul de l’État social, brutalisation systémique des plus faibles, abstention électorale croissante… – montre bien que, cinq siècles après avoir été formulé, le programme humaniste reste à accomplir. Si nous avons, en ce début de XXIe siècle, une tâche historique, c’est toujours la même que nos devanciers : civiliser la société.
Enfin, les humanistes ont proclamé que, par-delà toutes les différences de culture, l’humanité est une, et qu’elle a besoin de paix et de concorde. Pour les hommes de la Renaissance, un tel avertissement était profitable. Pour nous, aujourd’hui, il est vital. L’existence de menaces globales – risques de conflagration militaire majeure ou surgissement de la crise climatique – qui, dans leurs causes comme dans leurs conséquences, engagent toute l’humanité sans distinction, fait ressortir comme jamais auparavant l’unité infrangible du peuple humain, dont les grands penseurs de la Renaissance avaient eu l’intuition. Et elle rend plus nécessaire que jamais la construction d’un ordre cosmopolitique, fondé sur la compréhension mutuelle et la coopération.
La leçon des humanistes, on le voit, est loin d’être épuisée. À l’évidence, les hommes de la Renaissance n’ont pas tout dit. Mais, d’Érasme à La Boétie, de Thomas More à Rabelais, ils ont posé des principes, articulé des idées, forgé des outils intellectuels dont nous restons dépositaires. Leur humanisme – humanisme fort, exigeant, aiguisé, humanisme de combat – peut encore nous guider dans la tempête, et accompagner nos luttes.