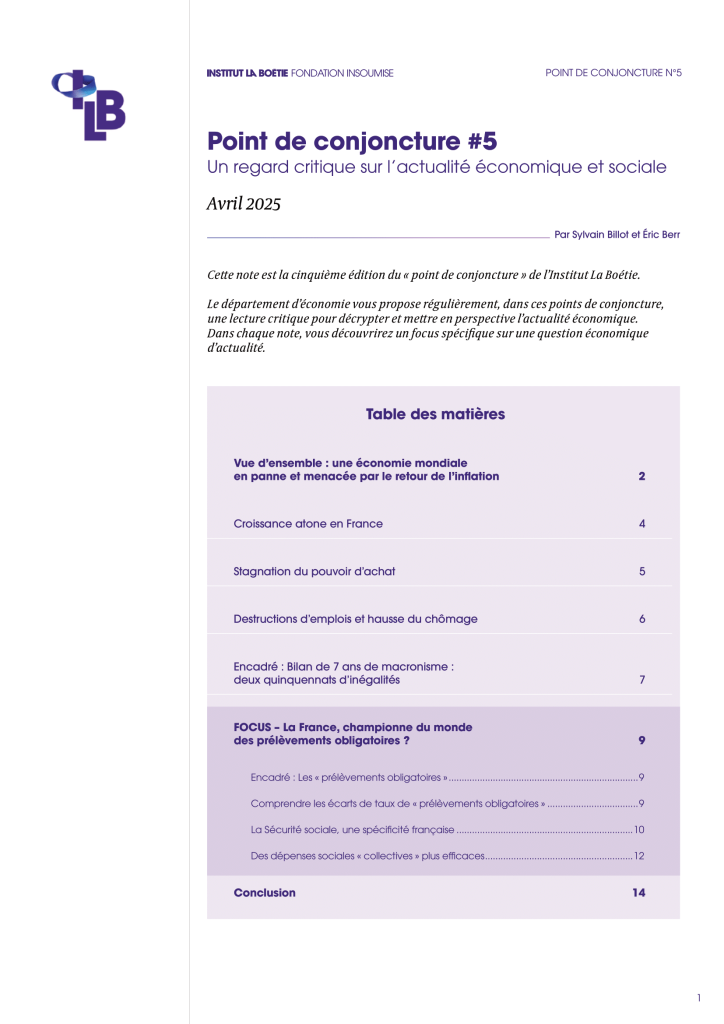Cette note est la cinquième édition du « point de conjoncture » de l’Institut La Boétie.
Le département d’économie vous propose régulièrement, dans ces points de conjoncture, une lecture critique pour décrypter et mettre en perspective l’actualité économique. Dans chaque note, vous découvrirez un focus spécifique sur une question économique d’actualité.
Vue d’ensemble : une économie mondiale en panne et menacée par le retour de l’inflation
Les observations à l’échelle internationale confortent l’hypothèse avancée dans notre point de conjoncture de novembre 2024 : l’inflation persiste et rebondit, dans un contexte de ralentissement économique. C’est le spectre d’une stagflation durable[1] qui devient chaque jour plus probable.
Les hausses spectaculaires des droits de douane annoncées par Donald Trump en avril vont alimenter ce scénario puisqu’elles vont faire augmenter les prix et vont freiner le commerce.
Dans un premier temps, Trump a annoncé le 2 avril des hausses spectaculaires des droits de douane, portant le taux moyen à 24 %, contre 2 % avant son arrivée à la Maison-Blanche. Ce taux a été porté à 21 % pour l’Union européenne, soit une hausse de 20 points, et à 64 % pour la Chine, soit une hausse de 54 points. Puis, suite à la dégringolade des marchés financiers, Trump a annoncé le 9 avril une suspension pour 90 jours, laissant tout de même un taux uniforme de 10 % partout… sauf pour la Chine où le taux est porté à 145 % !
Aux États-Unis, après une croissance soutenue de 2,8 % en 2024, le ralentissement devrait être prononcé en 2025. La banque centrale (la Federal Reserve ou Fed) a réduit ses prévisions de croissance pour le premier trimestre 2025 de 2,1 % à 1,7 %. La Réserve fédérale d’Atlanta[2] prévoit même une baisse du produit intérieur brut (PIB).
Le déficit commercial[3] s’est envolé au début de l’année, avec une hausse significative des importations : les entreprises états-uniennes ont anticipé leurs achats à l’étranger pour éviter d’être impactées par les hausses de droits de douane, qui font augmenter les prix des biens importés. Dans le même temps, les prévisions d’inflation ont été revues à la hausse pour 2025, avant même les annonces de Trump sur les droits de douane : elles s’élèvent désormais à 2,7 % en moyenne annuelle, contre 2,4 % selon les prévisions de septembre 2024. L’inflation est alimentée par la hausse des prix alimentaires et des prix de l’énergie.
En raison de ce contexte inflationniste, la banque centrale a pris la décision, contre la volonté de Donald Trump, d’interrompre sa politique de baisse de taux d’intérêt[4], ce qui va avoir pour conséquence de freiner l’investissement[5] et d’augmenter le risque d’une crise financière en raison de la déconnexion entre la bulle financière et les profits réels[6].
Donald Trump accentue la pression sur la banque centrale pour imposer une politique monétaire favorable aux marchés financiers. Il installe un capitalisme de plus en plus mafieux, cherchant à satisfaire les spéculateurs au mépris des besoins de la population. L’administration multiplie ainsi les dérégulations et les baisses d’impôts pour doper les cours boursiers et ceux des cryptomonnaies[7]. Si Trump exige aujourd’hui une baisse des taux d’intérêt, c’est en réalité pour amortir l’impact de sa guerre commerciale sur l’économie réelle, mais surtout sur les marchés financiers. Malgré ses efforts, l’inquiétude gagne les marchés.
Au Royaume-Uni, la croissance déjà très faible stagne et l’inflation repart à la hausse : 3 % en janvier 2025 contre 1,7 % en septembre 2024. La banque centrale prévoyait, avant l’annonce de la hausse des droits de douane par Donald Trump, une inflation de 3,7 % en fin d’année et une croissance inférieure à 1 %.
En Allemagne, le PIB a baissé de 0,2 % au 4e trimestre 2024. Fait extrêmement rare pour l’économie allemande : la croissance recule pour la deuxième année consécutive, en raison d’une profonde crise industrielle[8].
La production industrielle a reculé de 4,5 % en 2024, notamment dans les secteurs qui constituent le point fort de l’Allemagne : l’automobile et les biens d’investissement, notamment les machines-outils. Dans le même temps, l’inflation a augmenté, passant de 1,8 % en septembre 2024 à 2,6 % en février 2025. La consommation populaire reste donc faible et se concentre essentiellement sur les dépenses contraintes[9].
La future coalition gouvernementale a annoncé un plan de réarmement massif, impliquant de modifier la Constitution pour lever le « frein à l’endettement » et allouer à la défense des fonds colossaux d’environ 900 milliards d’euros[10]. Cela devrait avoir un impact positif sur la croissance, puisque l’activité de l’industrie de l’armement va augmenter significativement[11], mais la baisse marquée du taux de profit en Allemagne, malgré une baisse importante des salaires réels pendant l’épisode inflationniste, empêche un véritable redémarrage de la croissance[12].
Avec une croissance de 3,2 % en 2024, l’Espagne continue à afficher des performances économiques largement supérieures à celles de ses voisins européens. Mais cette bonne santé économique est fragile car la croissance espagnole est essentiellement tirée par l’économie du tourisme de masse. Or, il s’agit d’un secteur à faible productivité, aux conditions de travail dégradées, et qui contribue par ailleurs à accentuer la crise du logement dont souffre la population espagnole. En parallèle, la consommation populaire a diminué en proportion du PIB au cours des cinq dernières années et l’investissement demeure largement inférieur à son niveau de 2007[13].
C’est la faiblesse persistante des gains de productivité[14] au niveau mondial qui est à l’origine de la stagnation économique combinée à la reprise de l’inflation (« stagflation »). Dans un tel contexte, les capitalistes cherchent à imposer une hausse des prix, malgré la faiblesse de la demande, pour maintenir leurs marges.
La guerre commerciale lancée par Donald Trump dans le triple but d’exercer une pression politique, d’accroître les recettes fiscales de l’État fédéral et de réindustrialiser le pays, va alimenter cette stagflation. Car cette guerre est loin d’être un jeu à somme nulle. Les taxes douanières vont frapper la consommation et se répercuter directement sur la population états-unienne, et en priorité sur les ménages les plus précaires[15].
Quel que soit leur comportement, les consommateurs seront pénalisés. Soit ils continueront d’acheter des biens importés et ils paieront alors plus cher, puisque les droits de douane feront mécaniquement augmenter les prix ; soit ils se tourneront vers les biens produits aux États-Unis, mais ils paieront aussi plus cher car la production locale sera plus coûteuse.
Au final, Donald Trump va importer… de l’inflation. De plus, les États-Unis ne bénéficieront pas de la guerre commerciale car même s’ils parviennent à « forcer » certaines entreprises à rapatrier leur production sur leur sol[16], ils resteront dépendants aux importations[17] : les multinationales états-uniennes sont elles aussi insérées dans les réseaux de production internationaux où la production et l’assemblage des biens sont fragmentés et répartis entre plusieurs pays et aires du monde.
Croissance atone en France
Après une légère baisse du PIB en fin d’année 2024, la croissance resterait atone début 2025 selon l’Insee[18] : + 0,1 % au premier trimestre et + 0,2 % au deuxième trimestre.
D’ores et déjà, l’objectif du gouvernement de 0,9 % de croissance en 2025 est caduc. Pour l’atteindre, il faudrait une croissance très dynamique de l’ordre de 0,6 % aux troisième et quatrième trimestres, ce qui semble impossible. La Banque de France a d’ailleurs enterré cet objectif en prévoyant, avant l’annonce de la hausse des droits de douane de Trump, une croissance de 0,7 % pour l’année 2025[19]. La croissance pourrait même en réalité être proche de zéro en incluant l’effet de la hausse des droits de douane, puisque François Bayrou a indiqué qu’elle pourrait avoir un impact négatif de « plus de 0,5 % » en 2025.
C’est du côté de l’investissement que la situation est la plus mauvaise. L’investissement des entreprises a connu une baisse de 2,8 % en cumulé entre le troisième trimestre 2023 et le quatrième trimestre 2024. L’investissement des ménages, c’est-à-dire l’achat de logements, s’est lui aussi effondré : – 19 % entre le deuxième trimestre 2021 et fin 2024. Le seul investissement qui résistait jusqu’au premier semestre 2024 était l’investissement des administrations publiques, mais il a fléchi à la fin de l’année du fait de la pression massive sur les finances publiques.
Le commerce extérieur et les dépenses publiques formaient les deux moteurs du peu de croissance de ces derniers trimestres. Ils vont s’enrayer en 2025. D’une part, les hausses des droits de douane imposées par Trump risquent de freiner le commerce mondial. Les exportations françaises vers les États-Unis pourraient ralentir, notamment dans les secteurs de l’aéronautique, des vins et spiritueux, de l’industrie chimique et des produits laitiers. Les exportations vers l’Allemagne seraient également concernées, puisque l’Allemagne assemble des composants produits en France avant de vendre les produits finaux sur le marché états-unien. Le déficit du commerce extérieur français devrait donc se détériorer, alors qu’il tendait justement à se réduire ces derniers mois en raison d’une diminution des importations[20].
D’autre part, la diminution drastique de la dépense publique nuit lourdement à l’activité économique. Le blocage des crédits publics, imposé par le gouvernement au prétexte de la censure du gouvernement de Michel Barnier, a mis un coup d’arrêt à la consommation des administrations publiques[21]. Le budget d’austérité que François Bayrou a fait adopter par 49.3 en février dernier va à son tour fortement limiter la contribution des dépenses publiques à la croissance tout au long de l’année 2025.
Dans ce contexte, aucune perspective de dynamisme ne se dégage. L’investissement productif des entreprises devrait continuer à baisser. Et la consommation des ménages ne sera pas le moteur de la croissance, compte tenu des prévisions de stagnation du pouvoir d’achat.
Pour espérer une croissance positive, il faudrait donc compter sur une baisse du taux d’épargne[22]. En effet, la fin de la crise Covid, durant laquelle la consommation des ménages a été empêchée, n’a pas marqué un retour à la normale en matière d’épargne. Il y a toujours au contraire une « surépargne » : le taux d’épargne demeure supérieur à la tendance de la décennie pré-Covid. Si l’inflation et le contexte d’incertitude ont pu pousser certains ménages à épargner davantage préventivement, la « surépargne » s’explique surtout par un accroissement de l’épargne financière des ménages les plus riches, qui font fructifier leur argent en le plaçant plutôt que de consommer et investir[23].
Il n’y a rien à attendre non plus du côté de la production industrielle. La crise de l’industrie s’approfondit. La « réindustrialisation » annoncée par Emmanuel Macron est un mirage. Les plans de licenciements se succèdent, dans la filière automobile notamment mais aussi dans le secteur de la chimie, avec récemment le cas de Vencorex.
Les délocalisations menacent en cascade les fournisseurs et les sous-traitants : sur un an, près de 200 000 emplois industriels seraient directement et indirectement mis en danger[24]. La valeur ajoutée[25] dans l’industrie manufacturière[26] a baissé tout au long de l’année 2024, et cela devrait continuer début 2025, avec une baisse de – 0,4 % au premier trimestre puis de – 0,1 % au deuxième trimestre. Au total, entre fin 2023 et mi-2025, la baisse de la valeur ajoutée dégagée par l’industrie manufacturière serait de – 2,5 % !
Stagnation du pouvoir d’achat
Sur l’ensemble de l’année 2024, le pouvoir d’achat[27] moyen des ménages a augmenté en moyenne annuelle de presque 2 %. C’est l’indexation sur l’inflation de l’année précédente des pensions de retraite, conséquence de la censure du gouvernement Barnier, ainsi que des prestations sociales, qui a tiré le revenu des ménages vers le haut[28], car la hausse des prix avait été plus forte en 2023 qu’en 2024.
En réalité, la hausse du pouvoir d’achat en 2024 est loin de bénéficier à tout le monde. C’est une moyenne, qui est calculée en intégrant indistinctement l’évolution des salaires réels[29], qui ont stagné, et celle des revenus du patrimoine, qui ont eux beaucoup augmenté.
L’explosion des revenus du patrimoine dope donc superficiellement les chiffres du pouvoir d’achat. Car dans le même temps, la grande pauvreté, soit le manque d’accès aux biens et services fondamentaux, a progressé. En 2024, plus de 1,2 million de foyers n’ont ainsi pas pu payer leur facture et ont subi des coupures ou réductions de puissance d’électricité : c’est 24 % de plus que l’an dernier, et 85 % de plus qu’en 2019.
Le pouvoir d’achat moyen a cessé d’augmenter : il a stagné au dernier trimestre 2024 et devrait légèrement baisser au premier semestre 2025. Sur l’ensemble de l’année 2025, il devrait diminuer de 0,4 point à cause des coupes budgétaires et de l’obsession austéritaire du gouvernement, qui auront pour effet de ralentir la consommation et l’investissement.
En 2025, les salaires devraient progresser légèrement, au rythme annuel de 1,1 %. Mais ce chiffre pourrait être revu à la baisse, car les précédentes prévisions de hausses de salaires se sont quasiment toutes révélées trop optimistes[30]. Parallèlement, les revenus du patrimoine, qui ont tiré vers le haut le pouvoir d’achat moyen ces derniers mois, devraient ralentir. Après plusieurs trimestres d’euphorie, les rendements des placements (livret A, livret d’épargne populaire…) devraient baisser en lien avec la baisse des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne[31]. Les versements de dividendes ralentiraient en raison de profits moins élevés en 2024 et du fait de la hausse ponctuelle de l’impôt sur les sociétés sur les grands groupes, décidée uniquement pour 2025.
Destructions d’emplois et hausse du chômage
C’est dans ce contexte que les annonces de « plans sociaux » se multiplient partout en France. Au quatrième trimestre 2024, les suppressions d’emplois salariés ont surpris par leur ampleur : 90 100, dont 68 000 dans le privé et 22 100 dans le public[32]. Et ces suppressions devraient se poursuivre en 2025, avec au minimum plus de 100 000 emplois salariés détruits[33].
Les défaillances d’entreprises[34] sont au plus haut : 65 844 en cumul sur 12 mois en janvier 2025, contre 59 000 en moyenne dans les années 2010.
Habituellement, ces chiffres sont gonflés par les échecs et les abandons des auto-entrepreneurs, qui surviennent peu de temps après le lancement de leur activité. Mais en 2024, ce sont les défaillances d’entreprises de grande taille, avec plus de 250 salariés, qui ont été importantes[35]. Elles sont aujourd’hui deux fois plus nombreuses que dans les années 2010[36].
Au total, 260 000 emplois sont concernés par une procédure judiciaire, sans même compter les incidences potentielles sur l’emploi pour les fournisseurs des entreprises défaillantes[37].
Le taux de chômage officiel va progresser tout au long de l’année 2025. De 7,3 % fin 2024, il devrait atteindre 7,6 % au deuxième trimestre[38] et même 7,8 % au quatrième trimestre[39].
Seuls les emplois à faible productivité[40] des micro-entrepreneurs, c’est-à-dire des emplois non-salariés de travailleurs indépendants, devraient continuer à progresser en 2025. Le nombre de créations de micro-entreprises a augmenté de 7,3 % sur la seule année 2024[41]. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à recourir à l’externalisation de missions auprès de travailleurs indépendants, qui gagnent en moyenne 800 € par mois et dont un tiers est obligé de cumuler son activité avec un emploi salarié pour joindre les deux bouts[42]. Ainsi, plus d’une micro-entreprise sur dix est créée à la demande d’une entreprise qui recherche une alternative à l’embauche d’un salarié, y compris en intérim[43].
Encadré : Bilan de 7 ans de macronisme : deux quinquennats d’inégalités
Les résultats de la politique économique d’Emmanuel Macron sont édifiants. Les inégalités ont explosé, sur fond d’appauvrissement général de l’essentiel de la population.
Figure 1 : Évolution de quelques indicateurs économiques et sociaux entre 2017 et 2024
| Évolutions entre le deuxième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2024[44] | |
| Salaire horaire réel (secteur marchand) | – 3,5 % |
| Salaire par tête réel (secteur marchand) | – 2,7 % |
| Dividendes réels | + 79,8 % |
| Productivité horaire | – 1,7 % |
| Profits réels des sociétés non financières (SNF) | + 12,4 % |
| Prélèvements nets des subventions[45] pour les SNF | – 0,8 % |
| Taux de marge des SNF | + 1,1 point |
| Consommation de produits alimentaires en volume | – 8,0 % |
| Taux de privation matérielle et sociale (2017-2023) | + 1,7 point (+ 1,2 million de personnes) |
| Taux de pauvreté monétaire (2017-2022) | + 2,0 points (+ 1,4 million de personnes) |
Lecture : Entre le deuxième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2024, les salaires ont diminué de 3,5 % en moyenne et la consommation de produits alimentaires de 8 %. Sur la même période les profits des entreprises ont augmenté de 12,4 %.
Les salaires réels ont fortement baissé : environ – 3 % en l’espace de sept ans. C’est un phénomène inédit sur une période aussi longue depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ont d’abord stagné entre 2017 et 2021, avant de chuter d’environ 4 % entre fin 2021 et fin 2023 pendant la période de forte inflation. Depuis, ils progressent très modestement : mais la hausse récente d’environ 1 % est très loin de compenser la baisse qui précède. Dans le même temps, les dividendes réels perçus par les ménages les plus riches se sont envolés, eux, d’environ 80 %.
L’inflation sur les produits alimentaires a frappé de plein fouet la population. La précarité alimentaire a ainsi connu une forte hausse. Depuis 2017, la consommation alimentaire a baissé de 8 %. Aujourd’hui, les ménages se privent toujours de nourriture, sautent des repas ou se replient vers des produits de moins bonne qualité.L’industrie agroalimentaire est la première responsable de cette situation : elle a sciemment alimenté l’inflation sur fond de guerre en Ukraine afin d’augmenter ses marges.
Avec l’explosion des inégalités, la pauvreté a progressé de façon importante. Le taux de pauvreté monétaire, qui mesure la part des ménages dans la population ayant un niveau de vie inférieur à 60 % du niveau de vie médian[46], a augmenté de 2 points en cinq ans. Il est passé de 13,4 % à 15,4 % de la population entre 2017 et 2022, dernière année où cet indicateur est connu. Cela représente 1,4 million de personnes supplémentaires qui sont tombées dans la pauvreté.
La part des personnes en situation de « privation matérielle et sociale », c’est-à-dire qui disposent d’un logement mais ne parviennent pas à couvrir certaines dépenses de la vie courante nécessaires pour avoir un niveau de vie acceptable, a augmenté dans des proportions identiques : elle est passée de 11,4 % de la population en 2017 à 13,1 % en 2023 – soit 1,2 million de personnes en plus dans cette situation.
Sept années de macronisme ont profondément accentué le rapport de forces en faveur du capital à un niveau inégalé. Alors que la productivité horaire a diminué de 2 % depuis 2017, le taux de marge[47] des entreprises a lui augmenté de 1 % et les profits de 12 %. C’est absolument inédit.
Dans les années 1970, le ralentissement des gains de productivité, dont l’ampleur était bien moindre que la situation actuelle, s’était répercuté de façon négative sur le niveau des profits : si l’on produit moins de richesses tout en employant la même quantité de travail, alors on dégage logiquement moins de marges. À l’inverse, aujourd’hui les entreprises parviennent aujourd’hui à préserver leurs profits : elles s’enrichissent quel que soit l’état de l’économie réelle. Ce sont donc bien des mécanismes artificiels qui dopent leurs profits :
- d’une part, les entreprises ont imposé avec succès des hausses de prix supérieures aux hausses de salaires nominaux.
- d’autre part, elles ont bénéficié de mesures socio-fiscales très avantageuses qui maintiennent leurs profits à flot : subventions sans restrictions, crédits d’impôts, exonérations fiscales. Ainsi, malgré une hausse conséquente des profits, les prélèvements nets des subventions des entreprises ont quand même baissé…
Trois secteurs économiques ont particulièrement bien tiré leur épingle du jeu (voir figure 2) : d’abord, le secteur de l’énergie, de l’eau et des déchets, où le taux de marge a explosé de 20 points alors que la productivité a diminué de 12,3 %. Deuxièmement, le secteur des industries agroalimentaires ; et troisièmement, celui des services de transports.
Dans ces trois secteurs économiques, non seulement les salaires réels ont fortement baissé, mais les prix ont augmenté bien plus que l’inflation moyenne : comme les grands groupes de ces secteurs sont en situation d’oligopole, ils ont la possibilité d’agir fortement sur les prix pour générer de juteux profits sur le dos des consommateurs. Dans ces secteurs, les profits contribuent ainsi fortement à la hausse des prix de production, bien au-delà de leur poids dans le prix de production.
On voit ainsi se dégager une « boucle prix-profits » : c’est la volonté des entreprises de maintenir leurs marges menacées qui est le premier facteur d’augmentation des prix. Cela infirme la thèse libérale sans cesse évoquée par les économistes mainstream d’une « boucle salaire-prix », selon laquelle la hausse des salaires entraînerait un cercle vicieux d’inflation.
Figure 2 : Secteurs qui ont profité de la crise inflationniste. Évolutions entre le deuxième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2024
| Énergie, eau et déchets | Industries agroalimentaires | Services de transports | |
| Taux de marge | +19,4 points | +7,1 points | +6,5 points |
| Productivité horaire | – 12,3 % | – 11,3 % | – 9,3 % |
| Salaire horaire | – 6,8 % | – 4,6 % | – 5,1 % |
| Profits | + 168,6 % | + 40,1 % | + 31,4 % |
| Hausse des prix de production | + 81,6 % | + 32,7 % | + 25,6 % |
| Poids des profits dans les prix de production en 2017 | 17,4 % | 8,8 % | 14,1 % |
| Contribution des profits à la hausse des prix de production | 47,4 % | 20,3 % | 20,7 % |
Lecture : Entre le deuxième trimestre 2017 et le quatrième trimestre 2024, le taux de marge a augmenté de 19,4 % dans le secteur de l’énergie, de l’eau et des déchets, de 7,1 % dans l’industrie agroalimentaire et de 6,5 % dans les services de transports.
FOCUS – La France, championne du monde des prélèvements obligatoires ?
La France est le pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui a le taux de « prélèvements obligatoires » le plus élevé, en pourcentage du PIB[48]. Cette situation est souvent décriée et présentée par les institutions patronales, les éditorialistes et les représentants politiques du bloc libéral et du bloc d’extrême droite comme une tare qui frapperait lourdement l’économie française.
Cela relève d’abord d’un présupposé négatif très idéologique contre la dépense publique et le système de protection sociale[49].
Mais surtout, il s’agit d’une instrumentalisation malhonnête des comparaisons internationales : l’expression de « prélèvements obligatoires » amalgame en effet tous les paiements faits à des services collectifs, tout en ignorant totalement les prélèvements privés, comme si ceux-ci ne pouvaient par nature être « obligatoires ».
Encadré : Les « prélèvements obligatoires »
Les prélèvements obligatoires sont les impôts et cotisations sociales prélevés par les administrations publiques et par les institutions européennes.
On en distingue trois types :
- Les impôts, qui sont prélevés sur l’ensemble des contribuables sans contrepartie, dans le but de financer les dépenses de l’État. On dit des impôts qu’ils sont « sans contrepartie » parce que les prestations fournies par les administrations au contribuable ne sont pas proportionnelles à la quantité d’impôts versés.
- Les cotisations sociales, qui s’ajoutent au salaire net et sont versées aux organismes de protection sociale.
- Les taxes fiscales, qui sont versées par les usagers d’un service, par exemple la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Comprendre les écarts de taux de « prélèvements obligatoires »
Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) et l’OCDE suggèrent d’ailleurs eux-mêmes de manier les comparaisons internationales avec précaution[50]. Les pays peuvent en effet utiliser des conventions de mesure différentes pour comptabiliser leurs prélèvements obligatoires dans la richesse nationale, ainsi que leur PIB. À cela peuvent s’ajouter des imprécisions dans les calculs. De quoi entraîner au total des écarts de taux de prélèvements obligatoires entre pays allant jusqu’à deux points, faussant considérablement les comparaisons.
Mais surtout, constater un écart de prélèvements obligatoires entre deux pays ne signifie absolument rien en soi : pour l’interpréter, il est indispensable de regarder de plus près de quels prélèvements on parle et quelles sont leurs fonctions.
La Sécurité sociale, une spécificité française
Les écarts de taux de prélèvements obligatoires entre les pays s’expliquent avant tout par le fait que la santé et/ou la protection sociale relèvent d’un financement public dans certains pays, et d’un financement privé pour d’autres[51].
Dans certains pays, les besoins de santé sont pris en charge en très grande partie par les administrations publiques (État, collectivités locales ou Sécurité sociale), à partir des cotisations sociales ou des impôts.
Ainsi, en Suède ou en Finlande, ce sont principalement l’État et les collectivités locales qui financent les besoins de santé grâce aux impôts. Dans d’autres pays comme la France, c’est la Sécurité sociale qui finance ces besoins à partir des cotisations sociales mais aussi, et de plus en plus, à partir de l’impôt, avec la fiscalisation croissante des ressources de la Sécurité sociale[52].
Dans d’autres pays encore, la couverture des besoins de santé laisse une grande place au marché privé. Dans ce cas, le système n’est pas financé principalement par les cotisations et les impôts : ce sont les ménages qui souscrivent par leurs propres moyens des contrats auprès d’assurances privées, généralement à but lucratif[53].
C’est notamment le cas aux États-Unis, où près d’une personne sur deux y est couverte par une compagnie d’assurance-santé dans le cadre de son emploi[54], et où 8 % de la population n’est pas assurée du tout, y compris par une base minimale de protection publique : essentiellement les Latino-américains et les Afro-américains, auto-entrepreneurs, ou privés d’emplois[55].
Figure 3 : Taux de prélèvements obligatoires, en points de PIB, 2022

Lecture : Le taux de prélèvements obligatoires en France s’élève à 46 % du PIB, contre 43 % en Autriche, en Finlande et en Italie. La part des prélèvements obligatoires consacrés au financement de la Sécurité sociale représente près de 24 % du PIB en France, contre environ 12 % en Autriche.
Par rapport à la moyenne des pays de l’OCDE, la structure de la fiscalité en France se caractérise par une part des impôts faible[56] et une part des cotisations élevée (figure 4). Un tiers des prélèvements obligatoires correspond ainsi à des cotisations sociales.
Figure 4 : Structures fiscales en 2021 (en pourcentage du total des recettes fiscales)

Lecture : En Australie, les impôts sur le revenu des personnes physiques représentent près de 40 % du total des recettes fiscales du pays, tandis qu’en France ils s’élèvent à environ 20 % des recettes fiscales totales. En France, les cotisations de Sécurité sociale représentent environ 30 % des recettes fiscales totales, soit la contribution la plus importante aux recettes publiques.
Si le niveau de prélèvements obligatoires est un peu plus important en France que dans d’autres pays ayant un niveau de vie comparable, c’est donc essentiellement parce que la France a fait le choix de mutualiser un certain nombre de risques sociaux. Le choix de développer un système de protection sociale où sont socialisés à la fois le système de retraites et de santé implique que les cotisations sociales sont comptabilisées dans les prélèvements obligatoires en France.
Dans des pays qui n’ont pas fait ce choix, les dépenses des ménages pour financer leur santé ou leur retraite ne sont tout simplement pas comptabilisées dans les prélèvements obligatoires. Mais c’est une réalité avant tout comptable : dans la vie réelle, les ménages doivent s’acquitter de ces prélèvements, qu’ils aillent à un organisme de sécurité sociale, ou à une assurance privée. S’ils ne le font pas, ils en payent un prix beaucoup plus cher au final.
Figure 5 : Tendances des ratios impôts/PIB, 1965-2022 (en pourcentage du PIB)[57]

Lecture : Les recettes fiscales dans les pays de l’OCDE sont passées d’une moyenne de 25 % du PIB moyen de l’OCDE en 1965 à plus de 30 % en 2022.
Pour l’ensemble des pays de l’OCDE, le taux de prélèvements obligatoires a tendance à augmenter sur le long terme. C’est la conséquence du vieillissement de la population, qui exige une forte hausse des dépenses de santé et de retraite. Mais c’est aussi la conséquence du fait que ces besoins croissants sont en grande partie couverts par des dépenses socialisées, ce dont on peut se féliciter !
Surtout, les pays avec les plus forts taux de prélèvements obligatoires sont aussi ceux avec les taux de pauvreté monétaire les plus faibles ! Le fait d’avoir des « prélèvements obligatoires » élevés réduit en réalité la pauvreté. C’est logique, puisque ces prélèvements servent généralement à financer des prestations sociales qui réduisent les inégalités et sortent des personnes de la pauvreté.
Si l’on intégrait au revenu des ménages le bénéfice des services publics (éducation, hôpitaux…), on observerait d’ailleurs une corrélation encore plus négative entre taux de prélèvements obligatoires et taux de pauvreté !
Figure 6 : Corrélation entre taux de pauvreté et taux de prélèvements obligatoires (en pourcentage du PIB et en pourcentage de la population)

Lecture : La Norvège a un taux de prélèvements obligatoires qui s’élève à 41,5 % du PIB et un taux de pauvreté monétaire de 11,5 % de la population. À l’inverse, en Roumanie, le taux de prélèvements obligatoires correspond à 27 % du PIB et le taux de pauvreté monétaire atteint 21 % de la population.
Des dépenses sociales « collectives » plus efficaces
L’efficacité d’un système de santé se mesure d’abord par le poids de ses dépenses de gestion[58] : plus ce poids est faible, plus le système est efficace, puisque les dépenses de santé financent directement les actes médicaux pour la population. Les organismes publics de santé se révèlent à ce titre beaucoup plus performants que les organismes privés.
En France en 2023, les frais de gestion de la Sécurité sociale et de l’État pour la santé sont moins importants que ceux des organismes complémentaires, c’est-à-dire les mutuelles, assurances, et institutions de prévoyance : ils s’élèvent à 7,8 milliards d’euros, contre 8,3 milliards d’euros pour le privé[59]. Et ce alors même que les organismes publics prennent en charge une proportion bien plus importante des dépenses de santé : 78 %, contre 12 % seulement pour les organismes privés[60]. Si les organismes privés consacrent autant d’argent aux dépenses de gouvernance, c’est notamment parce que, pour survivre dans un marché compétitif, elles doivent payer des dépenses supplémentaires comme la publicité.
Mieux encore, les organismes publics continuent à gagner en efficacité, tandis que l’efficacité des organismes privés ne fait que se dégrader ! En effet, les dépenses de gestion des organismes complémentaires ont augmenté de 1,9 milliard d’euros en dix ans, alors que celles de la Sécurité sociale ont baissé dans le même temps de 700 millions[61].
Au niveau international, la présence importante d’assurances privées dans le système de santé tend aussi à faire baisser l’efficacité du système, en augmentant les dépenses de gestion. Moins il y a d’organismes publics, et plus il y a de dépenses de fonctionnement.
Aux États-Unis, où la part des organismes publics dans les dépenses de santé est de 53 %, les dépenses de gouvernance représentent 8 % des dépenses totales de santé. En France, elle n’est que de 5 %, pour une prise en charge des frais de santé à 78 % par le public. Et en Suède, elle est de 2 % seulement, pour une prise en charge des frais de santé à 86 % par le public[62].
En outre, lorsque la part des organismes publics est faible, la part des dépenses de santé dans le PIB tend à être importante pour des résultats médiocres.
Aux États-Unis, les dépenses de santé représentent 16,5 % du PIB, contre 11,8 % pour la France[63]. Les prix des produits de santé sont pourtant 2,4 fois plus élevés aux États-Unis qu’en France et l’accès aux soins est significativement dégradé : il y a 272 médecins pour 100 000 habitants, contre 340 en France[64]. Enfin, l’espérance de vie aux États-Unis est inférieure de quatre années à celle en France[65].
Ainsi, non seulement n’y a-t-il pas de sens à décrier le taux élevé de prélèvements obligatoires en France, mais il conviendrait plutôt de s’en féliciter : notre modèle de Sécurité sociale, financé par ces prélèvements obligatoires, est plus efficace, et moins coûteux pour une meilleure qualité de service, que le système de santé états-unien. Cette spécificité française représente un bien commun et un bénéfice net pour la santé de la population.
Conclusion
Les méfaits de l’organisation néolibérale de l’économie continuent de s’amplifier, sur fond de guerre commerciale. L’économie est aujourd’hui engluée dans une spirale qui mêle inflation, ralentissement de l’activité et destruction des emplois.
L’inflation repart à la hausse et menace le pouvoir d’achat des ménages, déjà durablement affaibli par l’explosion des prix endurée ces deux dernières années. Le capital continue de préserver son taux de profit par la hausse des prix. Et la hausse brutale des droits de douane va agir comme une taxe à la consommation dont la population sera la première victime. En conséquence, la consommation populaire stagne, ce qui prive la croissance économique de son principal moteur.
La menace du chômage de masse refait son apparition. Les destructions d’emplois connaissent une intensité alarmante. L’emploi indépendant précarisé semble être la norme sous le néolibéralisme.
Huit années de macronisme ont fait exploser les inégalités et fortement fragilisé l’économie française. D’un côté, les profits n’ont fait qu’augmenter, essentiellement grâce à la hausse des prix et aux aides publiques. De l’autre, les moyens de subsistance de la population se sont considérablement réduits : les salaires réels ont baissé, la précarité alimentaire et la pauvreté ont augmenté.
C’est le tableau d’une économie incapable d’assurer les besoins du plus grand nombre, mais pleinement disposée à semer le chaos pour enrichir le capital. La prochaine cible principale de ce capitalisme prédateur est ainsi la protection sociale, discréditée dans les discours et attaquée par des coupes budgétaires massives que le gouvernement compte intensifier.
Pourtant, la prise en charge collective des besoins fait ses preuves et se révèle même bien plus performante en termes économiques que l’organisation par le marché. Souvent présentée à tort comme championne des prélèvements obligatoires, sur la base d’instrumentalisation de comparaisons internationales, la France garantit une mutualisation des risques qui assure à chacun un accès à la santé. La Sécurité sociale coûte en réalité moins cher que les organismes de santé privé et elle diminue le coût des dépenses de santé.