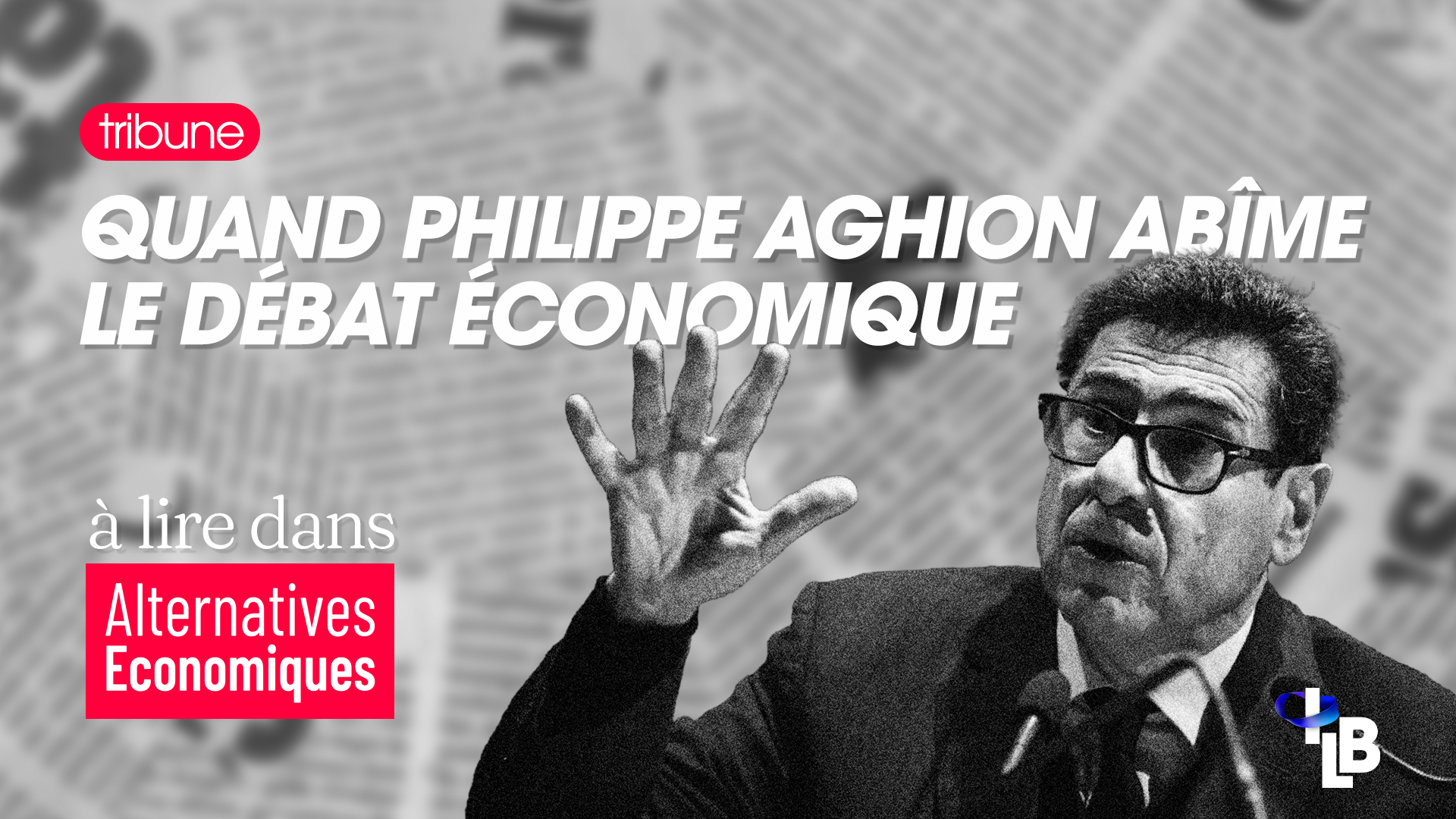Cette tribune, initiée par des économistes de tout le pays contributeur·ices des travaux de l’Institut La Boétie, est parue dans Alternatives Économiques le lundi 20 octobre 2025.
Fraichement auréolé de son « prix Nobel d’économie », Philippe Aghion était l’invité de BFMTV vendredi 17 octobre. Interrogé sur des questions économiques et politiques, il a affirmé mettre le Rassemblement national (RN) et La France insoumise (LFI) « sur le même plan ». Pour les signataires de cette tribune, qui ont contribué aux travaux de l’institut La Boétie sans pour autant être tous des soutiens inconditionnels de LFI, c’est une formule rapide, un effet de manche, qui est un double contresens.
D’abord parce qu’elle entretient un confusionnisme dangereux : quelle que soit l’hostilité que l’on peut nourrir à l’égard de tel ou tel programme, les valeurs, les pratiques et les propositions portées par ces deux forces politiques ne sont ni équivalentes ni interchangeables. Indépendamment de l’opposition fondamentale entre un mouvement défendant des valeurs humanistes (LFI) et un autre dont l’ADN est le rejet de « l’autre » (RN), leurs programmes économiques sont radicalement opposés.
Quand LFI propose une rupture avec le néolibéralisme, le RN le conforte. Quand LFI propose d’abroger la réforme portant l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, le RN oscille entre retour à 62 ans ou au contraire allongement à 65 ans. Quand LFI propose un système fiscal plus progressif et une meilleure redistribution des richesses, le RN promeut des mesures limitant les ressources de l’État et fragilisant notre système de protection sociale. Quand LFI propose de conditionner les aides aux entreprises, le RN s’aligne sur les positions du Medef. Quand LFI propose de s’engager résolument dans la planification écologique, le RN défend les politiques responsables de la crise climatique. Quand LFI promeut la hausse du SMIC, et plus généralement celle de l’ensemble des salaires, afin d’offrir des débouchés à la production des entreprises, le RN s’y oppose au nom d’une politique de l’offre qui a pourtant montré son inefficacité.
La formule de Philippe Aghion est également un contresens scientifique. En effet, lorsqu’un économiste est érigé en autorité scientifique, il lui revient plus que jamais de poser des critères, des faits et des arguments, plutôt que des sentences qui ferment la discussion. À l’heure où le débat public est miné par les « vérités alternatives » et les attaques contre la science, dévaluer la parole savante par des jugements à l’emporte-pièce, c’est affaiblir l’exigence de rationalité dont nous avons collectivement besoin.
Cette mise à distance du travail d’argumentation est d’autant plus regrettable qu’elle vient d’un chercheur reconnu qui, depuis son piédestal académique, n’hésite pas à intervenir dans le débat public afin de promouvoir le rôle de l’innovation. Or, trop souvent, la défense généreuse de l’innovation a servi de paravent à la préservation de rentes privées. De fait, les politiques de l’offre mises en place depuis 2014 par Emmanuel Macron, d’abord comme ministre de l’économie puis en tant que président de la République — CICE, baisse de la fiscalité sur les plus riches, flat tax, etc. — ont eu un coût budgétaire massif sans parvenir à transformer notre structure productive ni renforcer notre économie.
Si l’on veut parler sérieusement d’efficacité, jouons cartes sur table : l’attractivité de la France, mesurée par la hausse des investissements directs étrangers, se traduit aussi par des rachats d’entreprises françaises, donc par une perte de souveraineté économique. Philippe Aghion revendique sa participation à l’élaboration de ces politiques de « compétitivité » sans aucun recul critique ni esquisse d’un bilan de ces mesures.
Autre paradoxe : on ne peut pas marteler le rôle central de l’éducation dans le processus d’innovation tout en adoubant des politiques qui détruisent les bases de notre système éducatif. L’innovation n’advient pas par incantation. Elle réclame des enseignants considérés, des filières de formation continue sérieusement dotées, une recherche publique stable et exigeante, et un État stratège qui oriente, évalue et corrige. Si nous voulons une économie créative et robuste, la condition première est là : investir dans les capacités collectives plutôt que multiplier les cadeaux fiscaux sans conditionnalité.
Revenons alors à la méthode. Mettre RN et LFI « sur le même plan » n’est pas une analyse, c’est un argument d’autorité manipulateur et sans fondement. La science, elle, commence par spécifier un cadre, explicite des hypothèses, discute des preuves empiriques et accepte le débat contradictoire. Elle n’est ni un propos d’estrade, ni une morale commode qui distribue bons et mauvais points. Le rôle public des chercheurs n’est pas d’arbitrer la démocratie à la place des citoyens, mais d’éclairer les alternatives, d’en chiffrer les effets, d’en nommer les coûts et les bénéfices — y compris lorsque ces résultats contredisent leurs préférences. C’est cette éthique de la discussion que nous défendons.
Nous n’esquivons pas le débat, bien au contraire. Plutôt que d’en rester aux passes d’armes télévisuelles, nous proposons à Philippe Aghion un débat public, contradictoire et sourcé sur ses hypothèses théoriques et l’impact des politiques économiques menées par Emmanuel Macron, qu’il a largement soutenues, ainsi que sur les alternatives possibles.
Il y a, au fond, deux conceptions du débat démocratique. La première, verticale et paresseuse, aligne des étiquettes et met tout « sur le même plan » pour s’éviter toute contradiction. La seconde accepte la complexité : elle distingue, mesure, compare, et reconnaît le droit au désaccord — à condition qu’il soit informé. Nous plaidons pour cette seconde voie, non par courtoisie académique, mais parce qu’elle est la seule à la hauteur des défis économiques que nous devons relever. C’est ainsi que nous ferons progresser la science et la démocratie.