Introduction
Le 25 avril 2019, lors d’une conférence de presse faisant suite au « Grand débat national », Emmanuel Macron jugeait non seulement « hypocrite » le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, mais également contraire à ses engagements de campagne. Trois ans plus tard, il s’agit pourtant de la mesure phare du projet de réforme porté par le gouvernement d’Élisabeth Borne, Première ministre du même Emmanuel Macron. Cette réforme, menée au nom de la sauvegarde du système par répartition[1], s’inscrit dans une dynamique de plus long terme de dégradation des droits des travailleurs et notamment de leurs droits à la retraite.
Le mouvement social qui s’annonce est l’occasion de revenir sur l’histoire conflictuelle du système de retraites français et d’en examiner la genèse progressive.
Le système de retraites repose sur le principe de la répartition : des cotisations sont prélevées sur les salaires des actifs, afin de financer les pensions[2] des retraités actuels et d’ouvrir des droits pour leurs retraites futures. Il est composé d’un régime général[3], de régimes complémentaires[4], et de régimes spéciaux – ou « pionniers » – et constitue l’un des systèmes les plus protecteurs au monde. Ainsi, le panorama des pensions 2021 de l’OCDE note que « le système de retraite français offre une bonne protection qui se traduit par un revenu disponible moyen élevé pour les plus de 65 ans en comparaison internationale et un taux de pauvreté parmi les plus bas »[5]. De même, le revenu moyen des plus de 65 ans est égal au revenu moyen de la population, ce qui témoigne de l’efficacité du système, bien que peut-être aussi de la précarisation de la population active.
Si ce système de retraites est aussi ambitieux, c’est en grande partie parce qu’il est issu d’une longue histoire de conquêtes sociales et de conflits, comme le rappelle Nicolas Da Silva dans un ouvrage paru en 2022, La Bataille de la Sécu[6]. Car la conquête des retraites est aussi et avant tout une innovation radicale, au cœur de notre modèle de société et un pilier de la République sociale[7].
En effet, le risque vieillesse a longtemps été pris en charge par la solidarité familiale, la charité, voire par des caisses de prévoyance mutuelles[8]. Ces dernières reposaient sur le volontariat et le principe de capitalisation[9], de telle sorte que la masse des travailleurs n’y avait pas accès, en raison de la faiblesse de ses revenus et d’emplois souvent irréguliers. La retraite apparaît donc comme un objet historique complexe qui s’inscrit dans des dynamiques de longue durée. Des dispositifs extrêmement variés, aux philosophies parfois diamétralement opposées, ont ainsi vu le jour au cours des derniers siècles afin de prendre en charge la question du risque vieillesse.
Le système actuel porte les traces de cette histoire au long cours. La création, au début du XXe siècle, d’un système d’assurance retraite obligatoire, est encore très insuffisante, et l’on fustige alors une « retraite pour les morts ». De fait, il faut attendre la Libération pour que soit mis en place un système de retraite par répartition suffisamment ambitieux pour protéger les vieux travailleurs. Si Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail et de la Sécurité sociale, pouvait dire que la législation qu’il comptait mettre en œuvre ferait de la retraite « non plus l’antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie », c’est que les concepteurs de notre modèle social avaient conscience de la dimension révolutionnaire d’un tel système, intégré à la Sécurité sociale. Héritiers des progrès précédents, ils n’envisageaient pas que l’on puisse revenir en arrière sur ces acquis, qui devaient au contraire en appeler de nouveaux.
Telle est l’histoire de notre modèle de protection sociale et de nos retraites, construit grâce à la détermination du mouvement ouvrier et à sa traduction progressive dans le droit. Les origines conflictuelles de ce système se poursuivent logiquement dans l’opposition déterminée aux réformes successives qui le menacent, en particulier depuis les années 1990, jusqu’au projet actuel porté par Élisabeth Borne et Emmanuel Macron.
I. L’Ancien Régime et la révolution : le secours et la pension, du fait du prince au droit
« De retraire est temps et saison[10] » : la retraite au XVe siècle
Le projet de recherche sur les âges de la vie à la fin du Moyen Âge initié par Bernard Guenée en 1984 a permis de mettre à distance l’ancienne idée historiographique que la société médiévale serait un monde de jeunes. Comme le dit B. Guenée, répondant en 1985 à une communication de Françoise Autrand sur l’âge des serviteurs de l’État français du XVe siècle : « Il me semble aujourd’hui évident, du moins à la fin du Moyen Âge, du moins en Occident, que les vieux sont nombreux et jouent un rôle important[11] ».

L’allégorie de l’âge de vieillesse apparaît à des jeunes.
La notion de vieillesse se comprend à cette époque avant tout comme le synonyme d’impotence physique. C’est lorsqu’il constate que le greffier du Parlement[12] Nicolas de Baye, âgé de 52 ans, n’arrive plus à lire les registres du tribunal sans lunettes, que Charles VI lui propose de terminer sa carrière en tant que juge, travail moins pénible où il suffit d’entendre les affaires[13]. Des théoriciens ont tout de même proposé un chiffrage des âges de la vie. Pour Saint Thomas d’Aquin, la cinquantième année fait basculer du monde des jeunes vers celui des vieux. Plus fréquemment, on intercale un âge mûr allant de 40 à 60 ans, appelé « âge souverain » par Nicolas Oresme, philosophe du XIVe siècle. Puis la soixantième année marque à coup sûr le temps du repos. C’est l’âge, comme le dit le chevalier moraliste Philippe de Novare, où « l’on est quitte de services, et bien semble raison car homme de tel âge a assez à servir à soi-même[14] ».
Ce principe s’observe aussi dans les sources de la pratique. Dans les administrations de l’État central, c’est aux alentours de 60 ans qu’on clôt les carrières et refuse de nouvelles nominations. Ainsi, en 1455, lorsque Bureau Boucher, âgé de 70 ans, demande à Charles VII de le nommer président de la Chambre des Requêtes en récompense de sa longue carrière, le roi lui répond sèchement : « Dit que ceci n’a lieu car pour son ancien âge il se doit reposer pour récompense de raison[15] ». Aux jeunes le travail, aux vieux le repos ; ce principe semble s’établir fermement à mesure que le XVe siècle s’écoule.
Mais que faire des travailleurs qui, après une vie de bons et loyaux services, ne peuvent plus assurer leur charge ? Les administrations princières du XVe siècle connaissent-elles un système de pensions accordées aux vieux officiers[16] ? Pour répondre à cet enjeu, chaque institution développe des pratiques ponctuelles, empiriques, qui, sans constituer un système normé de retraites, mettent à l’abri du besoin une partie de leurs anciens officiers.
Les deux États qui se font face durant la seconde moitié du XVe siècle, l’État royal français et l’État bourguignon, sont les seules administrations à systématiser le recours à des pensions viagères de retraite pour les officiers de leurs hôtels et grands corps. Dès 1406, treize conseillers de la Chambre des Comptes du roi, « qui par faiblesse et impotence peuvent peu », sont autorisés à conserver leurs gages sans avoir à travailler[17]. La pratique s’étend au Parlement en 1428 : exténué par la vieillesse, le conseiller Pierre Ogier obtient de percevoir ses gages jusqu’à sa mort sans avoir à siéger. Après la refondation de l’institution en 1445, Charles VII rend systématique ce droit de ne plus siéger en fin de carrière, créant de facto une pension de retraite[18]. De même, les historiens ont tôt remarqué le poids spectaculaire des pensions viagères dans les comptes de l’Hôtel des ducs de Bourgogne. Dans un article de 1942, B.-A. Pocquet du Haut-Jussé notait que la plupart s’assimilaient à « des pensions de retraite accordées à de vieux serviteurs qui n’exercent plus leur fonction qu’au ralenti, ou qui ne peuvent plus les remplir du tout[19] ».
Mais ce privilège ne concerne que les plus hauts corps de l’État. Les officiers de moindre rang doivent se contenter d’expédients ponctuels pour clore leur carrière. Le développement de la résignation in favorem à partir de 1450 permet à un officier de vendre son office à un tiers, et ainsi de partir en retraite avec un modeste pécule. Par ailleurs, peu de princes peuvent se permettre des dépenses de charité aussi somptuaires que celles du roi ou du duc de Bourgogne. Le duché d’Orléans est en cela un cas intéressant. Décapité deux fois (d’abord par le meurtre du duc Louis d’Orléans en 1407, puis par la capture de son fils Charles en 1415 et sa captivité jusqu’en 1440), ravagé par les guerres sur son sol, le duché n’a pas les moyens de financer toutes les dépenses que son rang imposerait. Aussi les officiers de l’Hôtel partant à la retraite doivent se contenter d’avantages médiocres, que les ducs mobilisent par intermittence, selon l’état de leurs finances[20]. Il peut s’agir d’une pension « à volonté », révocable à tout moment par le duc ; d’un office de conseiller gagé, ce qui impose au retraité de rester disponible au cas où le duc déciderait de le rappeler ; ou encore d’une simple prime de départ, à l’instar de Bernardon de Serres, écuyer en fin de route à qui Charles d’Orléans offre 50 livres tournois pour tout remerciement de ses décennies de service.
On est à vrai dire frappé par la diversité des solutions trouvées pour venir en aide aux serviteurs en fin de carrière. Outre les déboires des ducs d’Orléans qui les poussent à l’innovation, on peut noter le système original développé par le duc de Bourbon. En 1400, Louis II de Bourbon inaugure à Moulins, capitale du duché, un hôpital Saint-Nicolas entièrement dédié à accueillir ses serviteurs infirmes ou en fin de vie[21]. Cette œuvre exprime bien un des objectifs de la sollicitude du prince. Certes, les sources de la pratique indiquent que maintenir l’état d’un officier âgé vient remercier une carrière de loyaux services. Mais c’est aussi un acte de charité contribuant au salut de l’âme du donateur. Cette dimension caritative s’observe également dans les comptes de la ville de Laon. Nicolas Offenstadt a mis en valeur des « dons et aumônes » qui s’avèrent être des formes de pensions de retraite[22]. De 1485 à 1500, la ville autorise son ancien valet Jean de Gascogne à vivre dans une de ses maisons sans en payer le loyer. De même, à partir de 1496, la ville verse au valet retraité Bertin Noël une « aumône » équivalente à ses anciens gages. Nous apprenons d’ailleurs, grâce à ce travail d’histoire locale, que financer des retraites d’officiers n’était pas réservé aux princes et administrations centrales, mais était aussi une pratique usuelle des échevinages[23].
À partir de ces traces éparses, on ne peut qu’être d’accord avec la conclusion de Françoise Autrand : « au XVe siècle, on commence à penser que les serviteurs de l’État, devenus vieux, ont le droit de se retirer sans perdre leurs ressources[24] ». Cependant, ce « droit » n’est pas réalisé, puisqu’il n’existe pas de système institutionnalisé de pensions de retraite. L’affaire semble arbitrée au cas par cas, selon l’état des finances, la qualité du serviteur et la piété ou les objectifs politiques du prince. De fait, la plupart des officiers ne partaient pas avec une pension, mais devaient se contenter d’un don unique, ou de services hospitaliers, lorsqu’ils n’étaient pas renvoyés sans aucune aide.
Dans la France de l’Ancien Régime, il existait donc déjà des formes de pensions ou de rentes pour les personnes âgées, mais celles-ci dépendaient de la charité des autorités ecclésiastiques, des corporations, voire des grands détenteurs d’offices royaux. Par ailleurs, des formes de retraite viagère par capitalisation qu’on appelait les tontines[25] étaient apparues au XVIIe siècle. La seule institution qui ressemblait à un système de retraite était réservée aux militaires âgés et/ou invalides. Les pensions des militaires étaient pensées comme un devoir découlant d’un contrat moral à l’égard de ceux qui avaient risqué leur vie au service du roi. Au XVIIIe siècle, dans une grande partie des États européens, les souverains avaient suivi l’exemple de l’hôtel des Invalides créé par Louis XIV. Tous les vieux soldats qui pouvaient être logés et nourris dans ces hospices[26] y étaient admis. Le nombre de places étant limité, on décida le plus souvent de pensionner ceux qui restaient à domicile. À partir du milieu du XVIIIe siècle, des institutions d’État furent mises en place pour financer ces pensions de « vétérance ».

L’idée que l’État devait assurer la subsistance et une existence digne, même modeste, à ses anciens soldats s’était imposée, même si ces pensions n’étaient versées qu’à ceux qui ne pouvaient pas travailler. L’âge auquel ces pensions étaient versées correspondait grosso modo à 60 ans, sans que cet âge ne constitue un droit. D’autres institutions comme la Ferme générale, c’est-à-dire l’organisme semi-public chargé du recouvrement des impôts indirects, avaient également créé des pensions de retraite pour leurs anciens employés. Mais bien évidemment, toutes ces formes ne relevaient pas d’un droit universel.
La Révolution et les retraites : l’affirmation du droit aux secours
Ce n’est que sous la Révolution française, et plus particulièrement sous la Convention montagnarde, que l’on commença à établir les secours[27] et les pensions comme un droit universel, découlant du droit à une existence digne, premier des droits de l’homme[28].
La demande sociale existait bien. Ainsi, dans quelques cahiers de doléances du printemps 1789, on demanda une exonération fiscale pour les personnes âgées mais surtout le droit à une existence digne pour les pauvres, les infirmes et les vieillards, catégories souvent confondues dans les revendications populaires. Cette existence digne devait être assurée soit par la création de « maisons de refuge » soit par des « secours » et des « rentes » versées à domicile.
Dans les premières années de la Révolution, de 1789 à 1791, l’Assemblée constituante chargea son « comité de mendicité » d’élaborer des plans visant à assurer une existence digne aux personnes âgées[29]. La loi du 22 août 1790 proclama que « l’État doit récompenser les services rendus au corps social quand leur importance et leur durée méritent ce témoignage de reconnaissance ». Les pensions des serviteurs de l’État (et plus seulement les militaires) étaient acquises comme un droit à partir de 50 ans et 30 ans de service. Le duc de Liancourt, membre de ce même comité, proposa même une forme de cotisation par répartition. Le comité proposa également de favoriser les pensions à domicile aux dépens des hospices, trop souvent le réceptacle de toutes les misères et donc impropres à assurer une existence digne. Ces secours à domicile, ou dans une famille d’accueil, auraient été dus à partir de 60 ans. C’est donc bien le principe de l’assistance comme un droit — ce que l’on appelait alors la bienfaisance — qui s’était imposé au détriment de la charité. Cette bienfaisance devait être gérée au plus près des citoyens, dans les municipalités.
La mise en œuvre s’avéra complexe. Le premier obstacle était d’ordre idéologique, car la majorité des Constituants, puis des Législateurs, en bons disciples des « économistes physiocrates », refusaient une quelconque atteinte au droit de propriété et donc que des biens nationaux (les anciennes propriétés du clergé) soient distribués aux pauvres et aux vieillards par petits lots[30]. Pour les disciples des « économistes », la subsistance des vieillards devait relever de caisses de prévoyance (par capitalisation en quelque sorte). C’est pourquoi la politique sociale eut tendance à se réduire à des « secours » ponctuels au lieu d’un plan général de bienfaisance.
L’autre obstacle était d’ordre pratique. Il fallait d’abord recenser les ayants droit et faire dresser les rôles des vieillards par les communes. À noter que les veuves et les femmes âgées seules étaient également concernées et pas seulement les hommes. Cela prit du temps dans le contexte de la guerre étrangère commencée en avril 1792 et de la guerre civile face à la contre-révolution.
La Convention nationale élue après la chute de la royauté le 10 août 1792 créa un comité, significativement appelé « comité des secours » (et non plus de mendicité) qui fut chargé du suivi. La Déclaration des droits de l’Homme précédant la Constitution de 1793 reconnut explicitement le droit aux secours publics dans son article 21 : « Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler ». Le décret du 19 mars 1793 établit des agences cantonales chargées de la distribution des pensions et celui du 28 juin proposa le choix entre les secours à domicile et les hospices. Les montants étaient modestes : 60 livres par an (grosso modo le salaire d’un journalier ou d’un ouvrier sans qualification) à partir de 60 ans et 90 livres à 65 ans. En osant l’anachronisme, on dirait qu’elles correspondaient à un SMIC ou à un SMIC et demi. À partir de la fin de l’année 1793, les listes des ayants droit avaient été établies (mais pas partout) et l’on avait une vision un peu moins floue des besoins (qui étaient énormes).
En l’an II, sous l’impulsion des Montagnards, la Convention décida la création d’un « Grand livre de la bienfaisance nationale » qui devait, entre autres, recenser les ayants droit d’un système de retraite presque universel pour les travailleurs des champs et des villes (et de tous les autres « secours » aux orphelins, infirmes, etc.) La loi du 22 floréal an II (11 mai 1794) l’établit en droit. Une attention particulière était accordée aux parents et grands-parents des soldats combattant aux frontières.

Hélas, on connaît mal l’application de cette législation. Les travaux historiographiques sont relativement peu nombreux. Un lieu commun a consisté à dire que cette législation n’a que peu été appliquée par manque de moyens dans le contexte de la guerre, mais les quelques études réalisées localement montrent qu’elle a connu au minimum un début d’application et que des « secours » ont bien été versés même si l’inflation a en pratique réduit la valeur de ces pensions[31].
Il est néanmoins certain que le principe de la « bienfaisance nationale » a été établi et qu’un début d’application du système de pensions de retraite a été réalisé dans le cadre des communes… jusqu’à ce que la « République des propriétaires », sous le Directoire, liquide progressivement cette législation (le Grand Livre de la Bienfaisance est abandonné en 1797).
Parmi les projets révolutionnaires les plus aboutis figure celui de Thomas Paine (1737-1809), le grand révolutionnaire anglo-américano-français (il fut élu à la Convention nationale), qui, dans la deuxième partie de Rights of Man publiée en février 1792, a élaboré un plan très précis de financement de ce que les Anglais appellent une ébauche de « welfare[32] ». Son objectif était de redistribuer le surplus de la richesse nationale de manière à réduire les inégalités et d’en finir avec la richesse et la pauvreté extrêmes. Ce plan prévoyait à la fois une instruction gratuite et des secours publics universels. Les pensions de retraite y auraient été versées à partir de 50 ans et augmentées à partir de 60 ans. Leur financement se serait appuyé sur un impôt progressif sur les successions.
II. Le grand âge au XIXe siècle : entre tradition assistancielle et invention de l’assurance
La Révolution française pose le principe du droit au secours et de la solidarité nationale. Toutefois au XIXe siècle les réalisations restent minces en matière de retraites. La question du statut des travailleurs âgés reste peu débattue, les contemporains renvoyant celle-ci à la solidarité familiale, à la prévoyance individuelle ou à la bienfaisance confessionnelle ou laïque, le plus souvent dans le cadre d’institutions communales. Le principe de l’assurance ne s’impose quant à lui qu’à la toute fin du XIXe siècle. Selon l’historien Vincent Viet, au cours du siècle, la question des travailleurs âgés devient pourtant, au même titre que celle de l’âge d’entrée dans les usines, constitutive de la « protection légale des travailleurs[33] » que les élites ouest-européennes et les États allemand[34], britannique et français s’efforcent de mettre en place afin de répondre à la « question sociale » et sous la pression d’une classe ouvrière toujours plus nombreuse et mobilisée.
L’entrelacement d’institutions et d’acteurs participant à la gestion de la protection sociale a conduit les historiens à emprunter, depuis le début des années 2000, le concept « d’économie mixte du welfare » aux économistes pour caractériser l’articulation de structures publiques et privées dans la gestion des risques sociaux. Le récent numéro de la Revue d’histoire de la protection sociale, dirigé par Lola Zappi et Antoine Perrier, confirme la pertinence de ce concept pour caractériser le XIXe siècle français, période durant laquelle la prise en charge de la vieillesse n’a rien d’un système unifié[35]. Tout au long du XIXe siècle, l’État apparaît en effet en retrait sur la question de la gestion du risque vieillesse. Yannick Marec, spécialiste du système de protection sociale et d’assistance mis en place dans la ville de Rouen au XVIIIe et au XIXe siècle, insiste quant à lui sur la nécessité d’étudier, à toutes les échelles (de la ville à l’international), l’articulation entre assistance, mutualité et assurance pour comprendre « l’efficacité » de la protection sociale de chaque pays à une période donnée, notamment lorsqu’il n’existe pas de système national[36]. Le XIXe siècle est enfin marqué, comme le souligne l’historien Henri Hatzfeld, par la lente mutation de « la sécurité propriété à la sécurité-droit du travail[37]», c’est-à-dire le recul d’une logique où seule la détention d’un patrimoine permet de se prémunir contre les risques sociaux et la montée en puissance de droits attachés au salariat sous l’effet des luttes ouvrières.
L’hospice et l’assistance

Avant que ne s’impose l’idée d’une retraite généralisée fondée sur le prélèvement de cotisations, différents systèmes cohabitent en France afin de prendre en charge le risque vieillesse. Dans une logique assistancielle, les vieillards infirmes sont pris en charge dans des hospices, confessionnels ou non, mais doivent pour cela justifier de leur incapacité à subvenir seuls à leurs besoins. Depuis la loi du 7 octobre 1796, qui crée la catégorie de « vieillard », c’est aux municipalités qu’il revient de financer les politiques d’accueil et d’assistance aux personnes âgées (les aliénés et les enfants relèvent quant à eux du département).
Dans son ouvrage Vies d’hospice. Vieillir et mourir en institution au XIXe siècle, l’historienne Mathilde Rossigneux-Méheust rend compte du fonctionnement de ces institutions et des fortes inégalités qui existent entre les différentes parties du territoire[38]. Paris apparaît ainsi fortement dotée avec, pour le XIXe siècle, une cinquantaine d’établissements destinés à accueillir les vieillards (avec des capacités d’accueil variables, entre 500 et 1000 lits).
Cette centralité parisienne dans le domaine de l’assistance est non seulement liée au statut de capitale de la ville mais également à l’importance des dons et legs dont bénéficie l’Assistance pPublique parisienne. Les politiques municipales s’articulent donc avec les formes plus anciennes de la charité privée, à l’image de la fondation Rossini pour les artistes désargentés. La municipalité met également en place, dès 1840, une politique de versement de secours en argent et en nature afin de favoriser le maintien à domicile. Cette politique du “hors-les-murs” répond aussi à la volonté de désengorger les hospices dont les capacités d’accueil restent limitées. Enfin ces versements sont justifiés par des raisons morales et financières : le coût d’une journée d’hospice s’avère bien plus important que le montant des subsides alloués tandis que les hospices sont systématiquement accusés par une partie des élites de favoriser l’imprévoyance des couches populaires et de décourager l’épargne.
De manière concomitante, on assiste au développement des colonies familiales : l’Assistance publique propose à des familles majoritairement rurales d’accueillir, contre rémunération, des personnes âgées à leur domicile et de s’en occuper[39]. La logique financière de réduction des coûts liés à l’entrée en hospice joue dans le développement de ce dispositif très bon marché. Les colonies familiales ont de plus la réputation de préserver des formes de lien social plus traditionnelles et de représenter une alternative préférable à « l’encasernement » que constitue la mise en hospice. Les versements d’aides monétaires aux personnes âgées, d’abord expérimentés à Paris sont ensuite introduits à Lyon à la fin du XIXe siècle avant que ces politiques de secours ne soient généralisées à l’ensemble du territoire national par la loi d’assistance du 14 juillet 1905[40]. Cette loi fait de l’assistance une règle nationale et opère une clarification des conditions d’entrée dans les hospices. Elle vise, dans le contexte des premières discussions sur l’assurance obligatoire, à compléter les dispositifs de retraite existants. Les secours, réservés aux plus pauvres, sont donc conditionnés à des enquêtes de revenus effectuées auprès des familles des vieillards secourus, l’assistance ne se déclenchant que si la famille est incapable de prendre en charge l’un de ses membres. La généralisation de l’assistance s’accompagne par conséquent du développement du contrôle des pouvoirs publics sur les populations jugées vulnérables. Au-delà de la surveillance dont les bénéficiaires de secours et leurs familles font l’objet, Mathilde Rossigneux-Méheust met en évidence les contreparties exigées des personnes accueillies en hospice[41]. Ceux et celles qui en sont physiquement capables sont mis à contribution pour la gestion du ménage, de la cuisine ou de l’entretien des bâtiments, parfois de manière très conséquente. Ce travail domestique, gratuit jusqu’en 1897, est parfois complété par un travail rémunéré. On estime à environ un tiers la proportion de personnes en hospice travaillant dans des ateliers de couture, de cordonneries ou de confection de cercueils.

Une autre conséquence de la loi de 1905 est d’écarter les étrangers de l’assistance aux personnes âgées. L’assistance se nationalise et les vieux travailleurs étrangers, belges ou italiens pour la plupart, sont contraints de se tourner vers l’assistance privée comme par exemple celle fournie par les petites sœurs des pauvres. L’assistance est cependant confrontée à des difficultés croissantes. La transition démographique au cours du XIXe siècle entraîne le vieillissement de la population ouest-européenne. Ce phénomène est particulièrement précoce en France : alors qu’un Français sur 12 avait plus de 60 ans en 1800, c’est le cas d’un Français sur 8 en 1900. Dans le même temps, l’urbanisation de l’Europe et l’exode rural mettent à mal certaines solidarités familiales. En cette fin du XIXe siècle, le recours au soutien des proches et à l’Assistance Publique ne suffit plus pour prendre en charge toute la précarité liée à la vieillesse ouvrière.
Le rôle des mutuelles
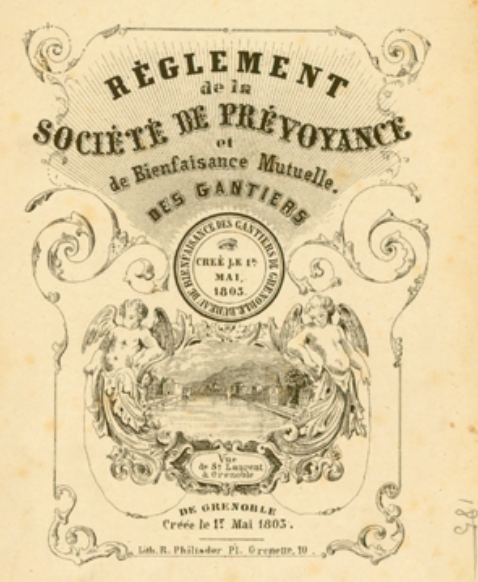
À côté de l’assistance se développent au XIXe siècle des systèmes d’épargne et de prévoyance à destination des travailleurs âgés, notamment dans le cadre des mutuelles ouvrières ou des sociétés de secours. L’industrialisation provoque en effet un vieillissement accéléré des corps dont les ouvriers sont les premières victimes. Bien qu’interdites dans le droit depuis la Révolution française[42], les mutuelles sont ainsi près de 2500 à la veille de 1848 et rassemblent 270 000 membres[43]. Leur autorisation par Napoléon III, via le décret du 26 mars 1852, permet à celles-ci de proposer plus facilement à leurs membres des prestations de retraites en échange de cotisations[44]. Cette transformation législative fait également d’elles un relai du pouvoir central, supprimant leur potentiel subversif et anticapitaliste, ce que montre notamment Nicolas Da Silva dans le chapitre qu’il leur consacre dans son ouvrage La bataille de la Sécu[45].
La majorité des travailleurs, du fait de la faiblesse des salaires tout au long du XIXe siècle, n’est de plus pas en mesure de payer des cotisations dans le cadre des mutuelles et donc de bénéficier d’une véritable retraite une fois l’activité laborieuse cessée. Malgré la volonté de Napoléon III de rendre obligatoire l’épargne au sein des sociétés mutuelles et ainsi de dégager une importante manne financière, celui-ci renonce du fait de l’opposition de l’Église et d’une large partie des élites, farouchement attachées au principe de la libre prévoyance. L’activité des mutuelles, contrainte par la faiblesse de leurs ressources financières et par les plafonds de dépôts imposés, se cantonne donc largement à fournir quelques secours aux travailleurs âgés ou bien à participer au financement des obsèques. Comme le souligne le député radical Paul Guieysse au moment des débats sur la loi relative aux retraites ouvrières et paysannes (ROP), les sociétés mutuelles françaises se sont révélées relativement inefficaces pour prendre en charge le versement de pensions de retraite pour les ouvriers[46].
Les régimes pionniers
Seules quelques catégories de travailleurs participent à cette époque à de véritables systèmes de retraites. À compter de 1853, les fonctionnaires bénéficient ainsi d’une pension dont le montant est lié à leur grade et est pensé comme une poursuite de leur traitement[47]. Bernard Friot, dans Puissances du salariat, considère ce statut original comme un embryon subversif du mode de production capitaliste, puisque la rémunération apparaît entièrement détachée de la soumission aux aléas du marché du travail[48]. Pour les fonctionnaires, la pension n’est pas la contrepartie de cotisations passées mais la poursuite, sous conditions, de leur traitement. Dans le secteur privé, le patronat s’intéresse de plus en plus à la question des retraites, notamment dans les secteurs où les conditions de travail sont les plus difficiles et le vieillissement des corps le plus rapide : les mines, la métallurgie, le chemin de fer.
Pour l’historien Michel Dreyfus, interrogé en 2010 au micro de France Culture dans l’émission La fabrique de l’histoire, c’est l’action tardive de l’État dans le domaine des retraites qui favorise la multiplication de ces régimes de retraites d’entreprise ou de branche gérés par le patronat[49]. Entre 1884 et 1909, différents secteurs créent des caisses de retraites spécifiques. Le Comité des forges, rassemblement patronal du secteur de la métallurgie, fonde la Caisse syndicale de retraite des Forges afin de constituer des pensions de retraite pour les ouvriers de la métallurgie[50]. Comme le note l’historienne Danièle Fraboulet, il s’agit là d’un élément dans la stratégie patronale de fixation d’une main d’œuvre ouvrière très mobile, puisque douze ans de cotisations sont nécessaires afin d’espérer toucher une pension[51]. La retraite est ainsi perçue comme la contrepartie de services rendus à l’entreprise par l’ouvrier.
La nécessité de conserver à son service une main d’œuvre très qualifiée et de se prémunir contre des pratiques de débauchage sauvage de la part des concurrents incite le patronat à créer ces caisses de retraites. L’historienne Élise Feller, dans son ouvrage Du vieillard au retraité. La construction de la vieillesse dans la France du XXe siècle, relève ainsi comment, dans les secteurs de pointe de la mine (depuis 1894) et du rail (depuis 1900), des systèmes d’assurance retraite comparables à celui de la métallurgie se mettent en place[52]. L’esprit résolument paternaliste de ces caisses patronales explique la grande méfiance, voire la franche hostilité, des socialistes et des syndicalistes à l’égard de ces systèmes d’assurance retraite.
Les retraites à l’échelle européenne à la Belle époque
Au début du XXe siècle, les différences de législation sociale entre les différents États-nations européens préoccupent d’ailleurs au sein et en dehors du mouvement ouvrier. Des négociations diplomatiques internationales et des échanges transnationaux portant sur la signature d’accords de réciprocité sont conduits, notamment dans le cadre de l’Association internationale pour la protection légale des travailleurs (AIPLT). Fondée en septembre 1901 à Bâle, cette association a pour but de coordonner l’action des réformateurs des différents pays européens[53]. Elle est la traduction, à l’échelle internationale, de la « nébuleuse réformatrice » mise en évidence par Christian Topalov dans le cas français[54]. L’AIPLT organise notamment des débats et des conférences afin de faciliter en amont, la signature de conventions bilatérales ou internationales sur le travail.
La question des retraites obligatoires motive ainsi en avril 1904 la signature par la France et l’Italie de la première convention internationale concernant les droits des travailleurs. Ainsi, alors que la loi de 1905 sur l’assistance exclut les étrangers, les projets d’assurance obligatoire font l’objet d’accords internationaux. Luigi Luzzatti, homme politique italien spécialiste des questions commerciales, et Arthur Fontaine, directeur du Travail au Ministère du Commerce français, sont les principaux artisans de cet accord. Il doit permettre d’éviter des pratiques de dumping social dans un contexte d’accroissement des tensions commerciales et diplomatiques en Europe. Pour les réformateurs sociaux européens, dont Arthur Fontaine est l’un des principaux représentants[55], la coopération internationale autour de la protection sociale doit conjurer le spectre de la guerre commerciale et de la concurrence exacerbée entre les nations. Toutefois, malgré leur importance diplomatique, ces conventions restent peu suivies d’effets. Ainsi, du fait de longues tractations et de difficultés dans le calcul des pensions des travailleurs italiens, l’application de la convention de 1904 est encore jugée comme insuffisante par les autorités italiennes en 1918.
En France, à la fin du XIXe siècle, l’industrialisation, par l’usure accélérée des corps qu’elle suscite, confère aux débats politiques sur la prise en charge du grand âge une centralité nouvelle, à la fois dans le mouvement ouvrier mais également au Parlement. La vieillesse apparaît en effet située socialement, les ouvriers étant touchés beaucoup plus tôt que les autres catégories de la population par des incapacités de travail et des problèmes de santé.
Selon Didier Renard, entre 1880 et 1914, au moins deux définitions de la vieillesse entrent en concurrence dans les débats français sur la protection légale des vieux travailleurs[56]. Certains acteurs continuent à définir la vieillesse comme « incapacité au travail », c’est-à-dire comme une forme d’invalidité parmi d’autres. D’autres défendent une conception plus « républicaine » de la vieillesse : la société française aurait « une dette […] à l’égard de tous les citoyens âgés », quel que soit leur état de santé. Selon cette deuxième définition, la pension de retraite ne relève plus du registre de l’assistance et du secours aux vieillards sans ressources. Elle doit devenir un droit social et permettre à tous les citoyens français d’arrêter de travailler après un certain âge. Au tournant du XIXe et du XXe siècle, il apparaît de plus en plus souvent reconnu que la prévoyance libre ne peut pas résoudre tous les problèmes sociaux et toutes les injustices structurelles.
La République française a opté dans la décennie 1900 pour le cumul des logiques de protection sociale plutôt que pour la substitution de l’assistance par l’assurance. Un projet de retraites pour les travailleurs avait par exemple été déposé par l’ancien maçon creusois devenu député Martin Nadaud dès 1879[57]. Il avait alors été jugé inacceptable par la majorité des députés et du patronat. De manière intéressante, Jules Guesde, l’un des chefs de file du mouvement ouvrier français à la fin du XIXe siècle et principal relai de la pensée marxiste, s’oppose également en 1880 dans son journal L’Égalité, à la retraite des mineurs de la Loire qu’il perçoit comme un leurre : « vol impudent des deniers prélevés sur les salaires des ouvriers »[58]. Toutefois, le 14 août 1882, le journal Le Socialiste, l’un des principaux organes du guesdisme, se prononce en faveur de la création d’un système de retraites pour pallier le congédiement sans aucune contrepartie des vieux travailleurs. L’article 7 du programme du Parti ouvrier français, élaboré par Paul Lafargue et Jules Guesde en 1882 prévoit ainsi que les vieillards et invalides du travail devront être mis à la charge de la société et qu’une autonomie ouvrière en matière de gestion des caisses de retraites devra être instaurée.
Le mouvement ouvrier apparaît donc, au tournant des XIXe et XXe siècles, divisé sur l’attitude à adopter vis-à-vis des systèmes d’assurance retraite dans un contexte de multiplication de projets de lois visant à les généraliser. Les différents partis socialistes comme les militants syndicalistes, s’ils apparaissent hostiles à l’assistance comme aux systèmes d’assurances contrôlés par le patronat, sont en revanche particulièrement soucieux d’assurer aux travailleurs des droits et une dignité au-delà de leur vie salariée.
III. De la « retraite pour les morts » à Vichy : capitalisation et répartition dans la France du premier XXe siècle
Un nouveau rapport aux vieux travailleurs
Au tournant du XIXe et du XXe siècle, la question de la rémunération des personnes âgées s’affirme comme un enjeu du débat politique en France. Les expérimentations comme le placement familial, déjà évoquées, ne sont pas concluantes. Comme le montre Jean-Pierre Bois dans Les vieux. De Montaigne aux premières retraites, les enquêteurs sociaux dénoncent l’abandon des vieillards et préconisent des lois d’assistance[59]. L’historien insiste sur les principaux thèmes autour desquels s’articule alors le débat sur les retraites. Tout d’abord, l’idée de justice réparatrice est mobilisée, car il semble injuste que la société abandonne un citoyen fragilisé par une longue vie de travail. Ensuite, le concept de solidarité sociale est avancé, de telle sorte que le droit à l’assistance est progressivement considéré comme devant être un service public. Enfin, des arguments d’ordre utilitaires et pragmatiques sont utilisés pour justifier le bien fondé d’un système obligatoire de retraites, comme la lutte contre le vagabondage ou la misère des vieux travailleurs.
Des revendications exprimées par le mouvement socialiste
Dans le même temps, le mouvement socialiste fait de la protection sociale et de la retraite un objet de revendication prioritaire. La résolution du Congrès socialiste international d’Amsterdam en 1904 insiste sur le droit aux soins, mais aussi aux retraites et à l’indemnisation du chômage pour la classe ouvrière :
« Dans la société capitaliste, ce résultat (garantie de ressources en cas de maladie, chômage, etc.) peut être obtenu au mieux par une législation d’assurance ouvrière effective. Les travailleurs de tous les pays ont donc à réclamer des institutions par lesquelles la maladie, les accidents, l’invalidité soient le mieux possible prévenus et par lesquelles, par l’assurance obligatoire, il soit donné aux travailleurs un droit légal à des moyens d’existence suffisants et aux secours médicaux quand par maladie, accident, invalidité, vieillesse, grossesse, maternité, chômage, ils ne peuvent plus exercer leur force de travail. […] Les travailleurs doivent exiger que ces institutions d’assurance soient placées sous l’administration directe des assurés et que les mêmes dispositions soient appliquées aux travailleurs de toutes les nations, nationaux et étrangers. »
La reconnaissance du droit à la protection sociale dans le « droit légal », garanti par des institutions que les travailleurs doivent revendiquer auprès de leurs gouvernements, dévoile la nécessité d’établir un rapport de force, une pression populaire sur les gouvernements. En France, des revendications similaires, articulées à la tradition républicaine et révolutionnaire, sont au cœur du discours de Jean Jaurès, notamment quand il s’adressait aux électeurs d’Albi en 1906 :
« La République, stimulée par le socialisme, pressée par la classe des travailleurs, commence à instituer cette assurance sociale qui doit s’appliquer à tous les risques, à la maladie, comme à la vieillesse, au chômage et au décès comme à l’accident. Par-là, elle ne diminuera pas seulement les misères et les angoisses qui dévorent tant d’existences humaines. Mais, en donnant à tous les prolétaires plus de sécurité et de liberté d’esprit, elle leur permettra de mieux préparer l’ordre social nouveau. En les associant à la gestion des grandes institutions d’assurance, elle les habituera à l’administration des grands intérêts qu’ils auront à gérer dans la société transformée.[60] »
En plus de reconnaître à la classe ouvrière un droit à la dignité, et de leur apporter une sécurité matérielle nécessaire à l’épanouissement personnel, l’expérience de ces assurances sociales aurait une portée tout aussi importante et même décisive dans l’organisation du mouvement ouvrier, à travers l’apprentissage de la gestion des affaires de l’État, nécessaire à la transformation de la société et à l’avènement final du socialisme.
À la Chambre, les députés de gauche défendent l’extension des « régimes pionniers » à l’ensemble des travailleurs. En 1906, le gouvernement Clemenceau, qui comporte un ministère du Travail inédit avec à sa tête le socialiste René Viviani, défend un projet de loi sur les retraites ouvrières. Celui-ci prévoit un droit à la retraite de 360 francs par an pour chaque ouvrier de plus de 60 ans ayant cotisé au moins 30 ans. Il reposait sur l’obligation pour les travailleurs gagnant au moins 1,50 franc par jour de cotiser à hauteur de 2 % du salaire et sur un versement patronal équivalent, une contribution de l’État permettant de compléter la somme.
Quelques années plus tard, en 1909, la loi unifie les systèmes de retraite des cheminots de compagnies différentes. Prenant en compte la pénibilité et l’espérance de vie qui peut y être associée, l’âge de départ est fixé à 50 ans pour les personnels « roulants », à 55 ans pour les personnels de « services actifs » et à 60 ans pour les personnels de bureau, au terme de 25 annuités. Les cotisations sont proportionnelles au salaire (5 % versés par les agents, 15 % par les compagnies) et les pensions atteignent 50 % du salaire moyen des six meilleures années. Une grande grève ferroviaire est organisée en 1911 par le Syndicat national des chemins de fer qui revendique la rétroactivité de la loi de 1909, et qui obtient gain de cause.
Un premier système obligatoire de retraite en France : la loi sur les « retraites ouvrières et paysannes » de 1910 et ses limites
Après trente ans de débats parlementaires, une loi sur les « retraites ouvrières et paysannes » (ROP) est adoptée le 5 avril 1910. Elle institue le premier régime de retraite obligatoire en France, par capitalisation, à travers des cotisations forfaitaires obligatoires et à parts égales entre les patrons et les salariés dont le revenu est supérieur à 3 000 francs par an. Au-delà de ce plafond d’affiliation, les salariés touchant moins de 5 000 francs peuvent également bénéficier de ce régime s’ils le souhaitent, de même que les fermiers, métayers, cultivateurs ou encore les artisans. La cotisation ouvrière est fixée à 18 francs pour les hommes, 12 francs pour les femmes, avec intervention de l’État pour une prime de 60 francs.
Une fois constitué, ce capital est ensuite géré au niveau local par des caisses d’affinités : caisses départementales ou régionales d’État, mutuelles, caisses patronales ou ouvrières. L’une des évolutions de cette loi tient dans la gestion tripartite des caisses d’État, avec des représentants élus des assurés, des patrons et de l’État. Une Caisse nationale est par ailleurs instituée et un contrôle est exercé par l’administration.
L’âge de départ est fixé à 65 ans après 30 années de cotisations, contre 60 ans dans le projet de 1906. Les pensions sont composées d’une allocation forfaitaire complétée par une somme proportionnelle au capital accumulé par l’assuré. Défendu par les radicaux, en particulier Paul Guieysse et Léon Bourgeois, le contenu de cette loi et la lenteur de son adoption témoignent des oppositions et des obstacles rencontrés, ainsi que des limites évidentes de ce système. Si le patronat combat farouchement la loi, en dénonçant déjà des charges intolérables et un encouragement à la paresse, les principales critiques émanant du mouvement ouvrier portent sur l’âge de départ et sur le principe même de la cotisation ouvrière.

La CGT critique ce qu’elle fustige comme étant une « retraite pour les morts », à une époque où l’espérance de vie atteint en moyenne 48,5 ans pour les hommes et 52,4 pour les femmes, et où 94 % des ouvriers meurent avant 65 ans. Autre limite : la Cour de cassation exempte de cotisations les employeurs dont les salariés refusent eux-mêmes de cotiser, de telle sorte que sur 12 millions de travailleurs concernés par l’obligation, seuls 7 millions et demi sont réellement assurés. Malgré ces limites évidentes, Jean Jaurès appelle les socialistes à soutenir cette loi, lors du congrès de la SFIO à Nîmes le 8 février 1910 :
« Dès demain, si vous le voulez, par le vote immédiat de la loi, et par l’effort d’amélioration que nous ferons tout de suite, dès demain, tous les vieux relèveront le front, et tous les jeunes, tous les hommes mûrs se diront du moins que la fin de la vie ne sera pas pour eux le fossé où se couche la bête aux abois. »
Parmi les améliorations apportées à la loi, sa révision en 1912 offre la possibilité de toucher une pension à 60 ans, tout en instaurant une prime de 10 % par enfant au-delà du troisième. Ainsi, la législation cherche aussi à lutter contre la baisse de la natalité et les effets du vieillissement de la population.
L’après-guerre et la nécessaire refonte du système de retraite : vers les assurances sociales
Néanmoins, le désastre de la Première Guerre mondiale porte un coup au système. En 1919, on ne compte plus que 1,4 million de cotisants. L’inflation et les dévaluations monétaires qu’elle entraîne démontrent les limites structurelles posées par le système par capitalisation, ce qui justifie une refondation. Dans le même temps, l’accélération de l’exode rural et de la seconde industrialisation, qui exige de fidéliser et de stabiliser la main-d’œuvre, font progresser la société salariale. La guerre totale a quant à elle placé l’État au cœur de la société, légitimant sa place croissante dans l’économie et le développement de l’État social. Les anciens obstacles à l’avènement d’un régime obligatoire de retraite semblent progressivement levés.
De plus, le retour en France de l’Alsace-Moselle, dont les salariés bénéficiaient de la protection sociale allemande, suscite des débats sur le modèle social à mettre en œuvre. Plutôt que de supprimer le régime bismarckien qui s’y applique, on choisit de s’en inspirer pour la nouvelle législation, et de l’étendre au reste du pays. Les « régimes pionniers » font également référence, avec l’amélioration en 1924 du régime des fonctionnaires, qui obtiennent que leurs pensions soient indexées sur les salaires des personnels actifs.
La préférence affichée pour une harmonisation du système par le haut mène à la loi sur les assurances sociales de 1928-1930, obligatoires pour tous les salariés de l’industrie et du commerce dont le salaire ne dépasse pas un plafond fixé à 15 000 francs par an, et 18 000 francs en région parisienne[61]. Facultatives pour les travailleurs non-salariés aux revenus inférieurs, elles s’appuient sur des cotisations de 8 % du salaire, réparties à égalité entre employeurs et salariés, et gérées selon le principe de la répartition pour l’assurance maladie, mais toujours selon celui de la capitalisation pour le risque vieillesse, d’après la loi du 30 avril 1930. Le principe de la liberté d’affiliation à la caisse primaire de son choix est maintenu. La mutualité et les caisses confessionnelles et patronales conservent leur rôle dans la gestion de cette nouvelle législation. Les caisses syndicales aussi, à l’instar de la CGT confédérée qui gère la caisse « Le Travail » et ses 300 000 assurés environ. Du point de vue des dispositions concernant les pensions, elle garantit aux retraités qui ont atteint 60 ans après 30 années de cotisations une pension égale à 40 % du salaire moyen sur l’ensemble de la période de cotisation, avec possibilité également pour l’assuré de liquider sa retraite à 65 ans. Les pensions restent composées d’une partie forfaitaire indépendante de la durée de cotisation et d’une partie variable en fonction du nombre d’annuités.
Faisant écho aux oppositions à la loi de 1910, la CGTU communiste se prononce quant à elle contre le projet d’assurances sociales, principalement en raison de son opposition au versement ouvrier, affirmant que « c’est la classe ouvrière qui finira par solder les assurances sociales[62] ». Elle exige un financement patronal et public, contre le versement ouvrier.
La crise des années 1930 touche durement les travailleurs de plus de 50 ans, directement concernés par la hausse du chômage, ce qui participe à l’évolution des représentations de la vieillesse : du « vieillard indigent », responsable de son manque de prévoyance, on passe à la figure du « vieux travailleur », miséreux malgré de longues années de dur labeur, à cause de la violence du marché du travail. En 1935, le total des assurés, régimes spéciaux compris, atteint 12,3 millions, soit un peu plus de la moitié des 21,6 millions d’actifs.
Le nouvel élan du Front populaire
La période du Front populaire est marquée par un nouvel élan populaire et mobilisateur suscitant et soutenant les réformes sociales du gouvernement de Léon Blum, installé depuis le 6 juin 1936. Si les grèves massives de l’été en ont accéléré le rythme, il faut mesurer d’emblée l’aspect volontariste des réformes proposées par le Président du Conseil. Si la question des retraites n’apparaît pas dans la première série de mesures portées par l’exécutif d’alors, elle fait partie de la seconde série annoncée par Léon Blum lors de son discours d’investiture, à travers la promesse d’un « régime de retraites garantissant contre la misère les vieux travailleurs des villes et des campagnes[63] ».
Le gouvernement Blum n’a toutefois pas le temps de mettre en œuvre cette réforme des retraites, puis, avec la « pause », le projet est repoussé[64]. Toutefois, comme le rappelle Antoine Prost, « la loi de finances du 31 décembre 1936 remet en vigueur la législation de 1924, annule tous les décrets-lois et maintient une péréquation intégrale des pensions sur la base des traitements d’activité au Ier octobre 1930, qui étaient encore les traitements en vigueur (art. 62 sq.)[65] ». De même, de 1936 à 1939, on compte pas moins de 24 projets ou propositions de loi portant sur la question des retraites[66].
Mais les gouvernements suivants ne continuent pas dans la voie initiée par Léon Blum. Le gouvernement de Camille Chautemps ne met pas en place les mesures qui n’ont pas encore été réalisées, à l’image de celle des retraites. Le PCF, quant à lui, continue de défendre « du pain, du feu pour les vieux de France ! » et appelle à « souten[ir] l’action du Parti communiste français qui seul lutte pour l’augmentation et l’extension de la retraite des vieux », à travers une campagne qui revendique l’extension de la loi de 1905 à l’ensemble des vieux travailleurs.
Les retraites sous Vichy : une politique mise au service de l’idéologie réactionnaire du régime
La chute de la IIIe République après la défaite de juin 1940 et l’avènement du régime de Vichy condamnent les principaux acteurs du Front populaire, socialistes comme communistes, à l’exil, à la prison ou à la Résistance clandestine. Dans le même temps, le ministre du Travail René Belin, ancien cégétiste, reprend certains projets de la fin des années 1930, notamment ceux qui visaient à remplacer le système de capitalisation par le principe de la répartition. Des spécialistes des retraites et des assurances sociales font temporairement partie de son cabinet, comme Francis Netter et Pierre Laroque, davantage par continuité administrative que par adhésion à la Révolution nationale. Pierre Laroque est d’ailleurs révoqué à la suite de la loi du 3 octobre 1940 écartant les juifs de la fonction publique.
Un projet de loi est néanmoins adopté en conseil des ministres dès le 11 octobre 1940, et prévoit que « les pensions de vieillesse et d’invalidité délivrées au titre des assurances sociales [seront] constituées selon le régime de la répartition. La liquidation, le service de ces pensions ainsi que les allocations sont assurés par une caisse générale des pensions prenant la suite des organismes de gestions pour la vieillesse et l’invalidité ». S’y opposent les mutualistes, représentés au sein du gouvernement par Jean Ybarnégaray, secrétaire d’État à la Famille et à la Santé, qui défend ardemment le principe de la capitalisation et la dimension morale de l’épargne.
L’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), créée par la loi du 14 mars 1941, donne droit à une pension de 40 % du salaire de référence, à partir de 65 ans. Toutefois, comme le montre l’historien Jean-Pierre Le Crom, ce nouveau régime vise avant tout à faire accepter socialement le régime de Vichy, et à libérer le marché du travail des plus âgés, afin de faire baisser le chômage. Le système par répartition naît justement des échecs répétés de la capitalisation. En effet, avec l’inflation et les dévaluations monétaires qu’elle entraîne, 1 franc cotisé ne vaut plus 1 franc perçu. Comme le montre Philippe-Jean Hesse : « Dès septembre 1940, il apparaît en effet clairement que la capitalisation suppose la stabilité monétaire, or quatre dévaluations depuis 1936 ont déjà fait perdre à la monnaie 64,38 % de sa valeur. Les conséquences de la défaite permettent de supposer que ce mouvement ne va pas se ralentir, bien au contraire. Il est donc urgent de passer à la répartition[67] ». Ce nouveau système fait toutefois rapidement face à des problèmes de financement, près des deux tiers des allocataires de 1944 n’ayant jamais cotisé. La faiblesse des pensions de l’époque est liée à l’extension du nombre de personnes couvertes par les assurances sociales, et au déficit de cotisations précédentes. Ces difficultés sont à replacer dans le contexte de la crise des années 1930, de la flambée du chômage et de la dévaluation du point de cotisation. Les réserves des anciennes caisses d’assurance vieillesse, qui avaient accumulé 20 milliards de francs, permettent toutefois de financer les premières années de l’AVTS, mais les fondations du système social vichyste ne semblent, à long terme, pas viables financièrement. Cette période ne fut donc pas, loin s’en faut, marquée par une amélioration de la condition des vieux travailleurs.
La politique sociale de Vichy est par ailleurs fortement articulée à l’esprit corporatiste et paternaliste de la Charte du Travail de 1941. Elle est instrumentalisée par Pétain, au même titre que la philanthropie, afin de légitimer socialement son régime. Elle s’explique donc par les nécessités politiques et sociales nées de l’Occupation, comme le montrent les auteurs de La protection sociale sous le régime de Vichy, et notamment le fait de retirer les vieux travailleurs du marché du travail pour faire baisser le chômage des jeunes. D’ailleurs, sous l’influence de son entourage, de la mutualité et de la Fédération catholique nationale, tous opposés aux orientations de Belin, il semble que c’est le maréchal Pétain lui-même qui prend la décision de rejeter un projet d’amélioration de l’allocation déposé par Belin en 1942, « jugé contraire à l’esprit de la Charte du travail et donc de la Révolution nationale. D’ailleurs l’ère Belin est terminée, le ministère va passer entre des mains plus sûres du point de vue des collaborationnistes[68] ». La protection sociale de l’État français apparaît dès lors soumise au cadre strict de la Révolution nationale, et à son idéologie conservatrice du point de vue de l’ordre social.
Ces lois s’inscrivent aussi plus généralement dans le développement continu de l’État social depuis la fin du XIXe siècle[69], et en constituent une manifestation particulièrement autoritaire entre le Front populaire et la Libération. Contrairement à ce que prétend une réécriture réactionnaire de l’histoire, notamment portée par Éric Zemmour[70], la faiblesse du régime de retraites mis en place par Vichy comme son aspect bancal et soumis à l’ordre conservateur rendent abusif de dater de cette période la naissance de notre régime de retraite. Plutôt, le Front populaire ouvre une séquence historique plus longue, laquelle trouve son débouché dans le programme du Conseil national de la Résistance (CNR), et qui est mise en œuvre une fois la France libérée et la légalité républicaine restaurée. L’esprit du Front populaire est alors prolongé, affirmé et enrichi entre 1944 et 1946.
IV. 1945-1981 : inventer une nouvelle étape de la vie, la retraite comme émancipation
De fait, il faut attendre la Libération pour que soit mis en place un système de retraite par répartition suffisamment ambitieux pour protéger les vieux travailleurs. Si Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail et de la Sécurité sociale à la Libération, pouvait dire que la législation qu’il comptait mettre en œuvre ferait de la retraite « non plus l’antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie », c’est que les concepteurs de notre modèle social avaient conscience de la dimension révolutionnaire d’un tel système, intégré à la Sécurité sociale. Héritiers des avancées sociales précédentes, ils n’envisageaient pas que l’on puisse revenir en arrière sur ces acquis, qui devaient au contraire en appeler de nouveaux. Telle est l’histoire de notre modèle de protection sociale et de nos retraites, construit grâce à la détermination du mouvement social et à sa traduction progressive dans le droit. Désormais, la protection sociale n’est plus affaire de paternalisme, qu’il soit patronal, confessionnel ou étatique, mais doit au contraire participer à l’émancipation des individus.
Penser des « jours heureux »
Car la Libération est aussi et surtout une grande période de démocratisation de la société française, de construction d’une démocratie politique et sociale, en même temps que de réaffirmation de l’ordre républicain. Peu de périodes de notre histoire ont autant ouvert le champ des possibles à ses acteurs, ont autant suscité d’espoirs au sein de la population. En particulier, l’espoir de faire advenir un régime démocratique et d’en finir avec la peur du lendemain, en garantissant des droits économiques et sociaux à une population éprouvée par la guerre et à des travailleurs appelés à reconstruire le pays. Cet esprit de la Résistance trouve son expression dans le programme du CNR adopté le 15 mars 1944, même si l’unanimisme apparent et revendiqué par le texte masque en réalité des discussions internes parfois conflictuelles, comme l’a montré Claire Andrieu[71]. Sur le plan social, aux côtés d’« un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se les procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État[72] », le programme des « Jours heureux » prévoit « une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours ».
En novembre 1944 Pierre Laroque est nommé « directeur des assurances sociales et de la mutualité », par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Alexandre Parodi. Désormais au pouvoir, les forces politiques émanant du CNR rejettent l’esprit corporatiste de la Charte du travail du régime de Vichy[73]. A posteriori, René Belin lui-même admet que « si les principes qui fondent les lois sur la sécurité sociale de 1945 et 1946 peuvent, par certains traits – mais à [ses] yeux pas forcément les plus significatifs – être rapprochés de ceux qui ordonnaient [son] projet de 1940, il serait abusif de ne pas reconnaître une inspiration plus haute qui est celle du plan Beveridge (1942).[74] » Le rapport Beveridge, à l’origine de la mise en place du système de santé étatique en Grande-Bretagne, était en effet connu de Pierre Laroque, mais ce dernier ne pensait pas qu’il puisse constituer le modèle des institutions sociales françaises, en raison notamment de la « tradition [française] d’entraide volontaire » en matière de protection sociale[75].
La retraite, d’une « antichambre de la mort » à une « nouvelle étape de la vie »

Le régime général de la Sécurité sociale institué par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 s’accompagne d’une assurance vieillesse à laquelle tous les salariés sont obligatoirement assujettis. Ses quatre principes fondateurs sont l’universalité, le financement par le biais de la cotisation, l’unité de caisse pour l’ensemble des risques sociaux, et la gestion démocratique de ces caisses. Il revient au communiste Ambroise Croizat, nommé ministre du Travail le 21 novembre 1945, puis ministre du Travail et de la Sécurité sociale jusqu’au 4 mai 1947, de mettre en place ce vaste système de protection sociale, dont il avait contribué aux débats et à la réflexion en tant que président de la commission du Travail et des Affaires sociales des Assemblées consultative et constituantes.
Lors de son premier discours en tant que ministre du Travail à l’Assemblée, le 3 décembre 1945, Ambroise Croizat résume son programme de la façon suivante : « Il faut en finir avec la souffrance, l’indignité et l’exclusion. Désormais, nous mettrons l’homme à l’abri du besoin. Nous ferons de la retraite non plus une antichambre de la mort mais une nouvelle étape de la vie ». Sachant que ses mois à la tête de ce ministère sont comptés, et pourraient prendre fin à la moindre crise gouvernementale, il témoigne de la priorité que constitue pour lui la mise en œuvre de la Sécurité sociale et de la retraite des vieux travailleurs. Le régime général repose sur un réseau de caisses primaires à l’échelle locale, qui remplacent les caisses d’affinité. L’administration est confiée à une majorité d’administrateurs salariés (deux tiers en 1945, puis trois quarts dès l’année suivante, notamment grâce à l’action de Croizat) désignés par les syndicats, puis élus à partir de 1947. Une hausse du niveau des cotisations vieillesse et maladie confondues permet de financer le nouveau régime, de 8 à 16 %, dont 10 % à la charge des employeurs et 6 % à la charge des salariés.
Pour ce qui est des retraites, le principe de la répartition est adopté, après les échecs répétés et démontrés de la capitalisation. Les pensions des retraités sont donc financées par les cotisations des actifs qui se constituent ainsi des droits pour leur retraite future. Le principe de la solidarité nationale et intergénérationnelle est au cœur du nouveau système. Le 7 avril 1946 déjà, Ambroise Croizat propose à l’Assemblée nationale l’extension de l’allocation aux vieux travailleurs salariés à tous les Français. Les droits à la retraite sont ouverts à 60 ans, après 30 annuités. Le taux de remplacement équivaut alors à 20 % du salaire de référence, calculé selon la moyenne des dix meilleures années, et augmente de 4 % par année supplémentaire, de telle sorte que la pension atteint 40 % du salaire de référence à 65 ans. Cette disposition vise à maintenir le maximum de travailleurs en activité, dans le cadre de la bataille de la production. À ce système d’assurance d’inspiration bismarckienne, s’ajoutent également des éléments du système beveridgien, à travers un minimum vieillesse et de droits à la retraite spécifiques, pour les mères de famille notamment.
Une page glorieuse de l’histoire populaire de la France
S’opposant à la logique libérale qui réduit la pension à un « revenu différé » pour des travailleurs devenus trop vieux pour poursuivre leur emploi, les « pères » du modèle social français conçoivent la retraite comme un « salaire continué » reconnaissant le retraité non pas comme étant au repos – et donc comme une charge pour la société – mais comme producteur, libre de choisir son activité. Comme le montre Bernard Friot[76], c’est la raison pour laquelle la pension est calculée en fonction du meilleur salaire du retraité – à l’époque calculé à partir des six derniers mois pour les fonctionnaires, et des dix meilleurs mois pour les salariés du privé –, et indexé sur le salaire moyen des actifs. À la tête de ce ministère, Ambroise Croizat dépose pas moins de 45 projets de loi. Il y joue un rôle majeur dans l’implantation des caisses sur l’ensemble du territoire à travers la mise en place de 138 caisses primaires d’assurances maladie ainsi que de 113 caisses d’allocations familiales, entre novembre 1945 et juillet 1946.

Néanmoins, un tel édifice n’aurait pu se concrétiser sans l’appui des travailleurs et des militants syndicalistes, avant tout de la CGT, avec lesquels il semble garder un contact permanent. Aussi s’adresse-t-il à eux le 12 mai 1946 : « Rien ne pourra se faire sans vous. La sécurité sociale n’est pas une affaire de lois et de décrets. Elle implique une action concrète sur le terrain, dans la cité, dans l’entreprise. Elle réclame vos mains… » En ce sens, la mise en place du régime général de la Sécurité sociale est un moment important de réactivation de la Sociale, définie par Nicolas Da Silva comme une forme de protection sociale reposant sur l’auto-organisation populaire. Il écrit ainsi qu’« en 1946, c’est parce que les travailleurs dirigent directement les caisses de sécurité sociale qu’ils sont en mesure d’en finir avec le paternalisme social et d’utiliser une partie des fonds collectés pour répondre directement à leurs besoins et aspirations[77] ».
La démocratie sociale instaurée par le régime général est dès lors considérée comme l’une des principales originalités du système social français, et du caractère révolutionnaire que certains lui reconnaissent, à l’instar de Bernard Friot.
Le mouvement social de l’année 1945-1946 qui permet la mise en place du régime général de Sécurité sociale n’est d’ailleurs pas qu’une spécificité hexagonale. Comme l’a bien montré l’historien Frederick Cooper, la question des allocations familiales et des accidents du travail ne se cantonne pas à la France métropolitaine, mais s’avère centrale dans les mouvements de travailleurs africains de l’Afrique occidentale et équatoriale française (AOF et AEF) de la fin des années 1940 et 1950[78]. Ces travailleurs réclament l’égalité des droits sociaux avec leurs homologues métropolitains, et notamment les droits conquis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C’est d’ailleurs à la suite de ces vastes mobilisations qu’est adopté en 1952 le Code du Travail d’outre-mer qui autorise, sous conditions, la création de caisses d’allocations familiales et de réparation des accidents du travail dans l’Union française. Un régime de retraite commun à l’ensemble des pays de l’Afrique de l’Ouest, l’IPRAO, calqué sur le modèle du régime complémentaire de l’Union nationale des institutions de retraite des salariés (UNIRS), voit également le jour en 1958[79].
Ainsi, le nom de Croizat est associé à la fois à la construction de l’édifice législatif de la Sécurité sociale, à sa dimension affective pour les militants, et à l’implantation territoriale de ces caisses. En somme, l’action de Croizat et des militants de la CGT apparaît nécessaire à la concrétisation du plan rédigé par Pierre Laroque, afin que celui-ci ne demeure pas une simple orientation théorique, classée sans suite. Leur vision de la société était fondée sur la Sécurité sociale, entendue comme droit social de l’homme, et comme dette sacrée de la Nation. Une ambition alors partagée par des millions de Français, et mise en œuvre par autant d’anonymes, tous acteurs à leur échelle de cette page majeure de l’histoire populaire de la France.
Des complémentaires aux premières offensives contre le système
En règle générale, les « régimes pionniers », souvent plus avantageux, sont maintenus, dans la mesure où le régime général encore en construction ne peut s’aligner sur leur niveau de prestations et leur âge de départ. Le problème du plafond, hérité de la loi de 1910, inquiète les cadres, car il bloque le montant de leurs pensions. Face à l’urgence, la question est résolue en 1947, à travers la convention collective des cadres qui débouche sur la création de caisses spécifiques financées par des cotisations prélevées sur la partie du salaire supérieure au plafond de la Sécurité sociale. Ces caisses sont gérées paritairement, avec un poids des employeurs plus grand que dans le régime général donc, et réunies au sein de l’AGIRC. L’ambition universaliste des promoteurs de la Sécurité sociale fait également face au refus des actifs non-salariés de voir leurs intérêts fondus dans le régime général. Les indépendants redoutent ainsi d’être les « vaches à lait du système ». Quatre régimes spéciaux se forment donc entre 1948 et 1952, contre la CGT, favorable au déplafonnement des cotisations : la CNAVPL pour les professions libérales, la Cancava pour les artisans, ou encore l’Organic pour les industriels et commerçants. Les retraites complémentaires des salariés sont gérées par l’ARRCO depuis 1961, et ont été généralisées en 1972. Notons que leurs déficits structurels sont compensés par le régime général, donc par les salariés. Dans les faits, la situation des retraités reste précaire. Le montant des pensions demeure faible, la plupart des retraités ne pouvant justifier une durée de cotisation suffisante, et 40 % des personnes âgées touchent encore le minimum vieillesse en 1960. Comme le montre Christophe Capuano, dans Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours, il faut attendre les années 1970 pour que les retraités ne constituent plus la catégorie la plus pauvre de la population française, grâce au relèvement du minimum vieillesse et des pensions.
La suite de l’histoire des retraites est quant à elle marquée par une série de réformes qui ont eu pour effet de les vider peu à peu de leur substance. Elles ont ainsi subi des attaques répétées de la part des gouvernements successifs, toujours selon l’objectif annoncé de « garantir les retraites ». L’utilisation de l’argument démographique pour réformer les retraites a ainsi pu être mobilisé en 1953 ou en 1968 quand, en moyenne, l’espérance de vie à la retraite pour les hommes était de trois ans, tandis que beaucoup n’y accédaient tout simplement pas, après des décennies de travail et de cotisation. Ainsi, en 1953, un projet de regroupement des régimes spéciaux, jugés trop généreux, dans le régime général, pour être alignés sur le secteur privé, est mis en échec par un mouvement de grève, particulièrement suivi par les fonctionnaires. En 1956, une vignette automobile est créée pour alimenter le Fonds national de solidarité (FNS). D’autres professions, qui avaient fait le choix de conserver des régimes spécifiques, rejoignent finalement le régime général. L’évolution socio-professionnelle du pays nécessite également des transferts entre caisses. Par exemple, le nombre de pensionnés du régime des agriculteurs augmente tendanciellement alors que le nombre de cotisants chute, en raison de la mécanisation et de l’exode rural qui conduit les jeunes à adopter d’autres métiers. La caisse agricole et les autres caisses touchées par ce type de phénomène, comme celle des mineurs, reçoivent ainsi une compensation de la part des caisses qui bénéficient de nouveaux cotisants. Dans la dynamique des ordonnances Jeanneney de 1967, le régime général des retraites a fait l’objet d’une refonte organisationnelle, avec pour modèle celui des assurances privées, portant atteinte à certains principes fondateurs de 1945-1946. Ainsi, c’est la fin du principe de la caisse unique, de telle sorte que les risques maladie, vieillesse, famille et accidents du travail sont séparés de manière comptable. Le régime général de la Sécurité sociale est dès lors réorganisé en quatre branches, avec la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), la branche AT-MP (accidents du travail et maladies professionnelles) et donc une Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) autonomisée. Par ailleurs, l’instauration du paritarisme, qui met à égalité les représentants des patrons et des salariés dans les caisses, affaiblit le pouvoir de négociation de ces derniers.
La question de l’allongement du temps de travail s’impose également dans les débats sur les « nécessaires réformes » du système de retraite. Le 31 décembre 1971, la loi Boulin augmente de 120 (30 ans) à 150 (37,5 ans) le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le droit à une retraite à taux plein. En contrepartie, le salaire de référence est désormais calculé sur la base des dix meilleures années de salaire, et non plus des dernières. Un dispositif de préretraite est également instauré en 1972 afin de lutter contre le chômage des jeunes, mais aussi de permettre aux entreprises de licencier des travailleurs âgés jugés moins rentables, à partir de 60 ans, puis de 55 ans en 1980. L’État s’engage également à subventionner les régimes spéciaux dont le ratio pensionnés-cotisants se creuse, comme le régime agricole qui bénéficie d’un Budget annexe des prestations sociales agricoles, ancêtre du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles. Enfin, la loi Boulin prévoit une amélioration des dispositifs dédiés aux mères de famille, comme en témoigne l’Allocation vieillesse des mères au foyer (AVMF), permettant d’attribuer aux mères jusqu’à quatre trimestres de retraite, en compensation des périodes d’interruption de leur emploi[80]. Néanmoins, les conséquences de la crise de 1973, et en particulier la hausse du chômage, affaiblissent les rentrées de cotisations et renforcent le chômage des plus de 55 ans. La crise pétrolière et la concurrence croissante liée à la mondialisation renforcent également l’utilisation d’arguments comptables pour justifier une réforme du système. Les premiers défenseurs du néo-libéralisme, au tournant des années 1970-1980, s’appuient ainsi sur la rhétorique des « charges » qui pèseraient sur la compétitivité des entreprises, pour remettre en cause l’État social et le principe même de cotisation.
V. Battre en retraite ? Contre-réformes et résistances populaires de 1982 à nos jours
La réforme du gouvernement d’Élisabeth Borne est le dernier avatar d’un processus de plus longue durée, débuté dans les années 1980. Ces transformations sont portées par des gouvernements de droite et de gauche, à mesure que le Parti socialiste opère sa conversion au néo-libéralisme[81]. Michel Laroque, dans un récent numéro de la Revue d’histoire de la protection sociale consacré à l’histoire longue des réformes du système de retraites, détaille ce processus mené au nom de l’adaptation au vieillissement de la population[82]. Les divisions internes au monde syndical ont pu favoriser l’imposition de ces réformes au cours de la période[83].Toutefois, en 1995, 2003, 2010 ou encore en 2020, les projets hostiles au système des retraites se heurtent à des formes de résistance populaire massives, ce dont témoignent systématiquement les images des journaux télévisés qui diffusent des images de manifestations noires de monde[84]. Les mouvements sociaux liés aux retraites sont en effet en France, ceux qui, au cours des quarante dernières années, ont su mobiliser le plus largement. Si ces mouvements peinent à empêcher le flot continu des réformes, leur vigueur peut expliquer qu’en France, l’agenda néo-libéral se soit heurté, au tournant des XXe et XXIe siècles, à davantage d’obstacles qu’en Angleterre ou en Allemagne[85].
La marche des réformes, des réformes à marche forcée
Le 26 mars 1982, le gouvernement socialiste conduit par Pierre Mauroy rend possible, via une ordonnance, la liquidation des pensions à 60 ans, sans décote pour les salariés ayant une carrière complète. Ce passage à la « retraite à 60 ans », mesure qui figurait dans le programme commun de la gauche en 1972[86] et intégrée aux 110 propositions de François Mitterrand, transforme également les chômeurs âgés de plus de 60 ans en retraités[87]. Ceux-ci, depuis 1972 (en cas de licenciement) ou 1977 (en cas de démission) bénéficiaient entre 60 et 65 ans d’une garantie de ressources versée par l’Unédic[88]. Cette réforme de la retraite à 60 ans, mise en place par la coalition de gauche au pouvoir est la dernière d’une succession de mesures favorables au remplacement du salaire par une pension et améliorant le niveau de vie des retraités[89]. La décennie qui suit est celle, pour reprendre l’expression du sociologue Ilias Naji, d’un véritable « retournement des retraites[90] ».
Le coup d’envoi du processus de contre-réforme des retraites est donné en 1987 par Philippe Séguin, ministre des Affaires sociales du gouvernement Chirac. Celui-ci pose le premier acte de la « réforme des pensions » qui n’a depuis cessé, sous des formes renouvelées, de diminuer les droits à la retraite des travailleurs et des travailleuses. Séguin indexe les pensions du régime général sur les prix et non plus sur les salaires. Alors que les salaires continuent d’évoluer plus rapidement que les prix, cette mesure rogne le niveau des pensions[91]. Une autre conséquence de la réforme est d’isoler les retraités des actifs en décorrélant leurs pensions du niveau des salaires. Une caractéristique des réformes du système de retraite depuis 1987 est qu’elles sont portées conjointement par la droite et une partie de la gauche, notamment le Parti socialiste, dont Michel Rocard est la figure la plus active sur le sujet de la réforme des retraites[92].
Le 24 avril 1991, le journal de France 3 consacre ainsi un cours sujet au Livre blanc de Michel Rocard sur les retraites[93]. Au nom du sauvetage du système par répartition et pour lutter contre un déséquilibre démographique à venir, ce document, devenu célèbre, propose trois pistes de réformes : l’allongement de la durée de cotisation (de 37,5 ans à 40 ans de cotisation), la prise en compte dans le calcul de la pension du salaire des vingt-cinq et non plus des dix meilleures années[94], et enfin l’indexation définitive des pensions sur le niveau des prix. Le rapport, qui fait l’objet d’une campagne de communication considérable, conclut : « Ne rien faire doit être clairement écarté »[95]. Ce triptyque, abaissement du niveau des pensions, accroissement de la logique contributive et report de l’âge légal de départ à la retraite ou allongement de la durée de cotisation, constitue la matrice de toutes les réformes menées depuis, au-delà des alternances politiques.
De fait, en 1993, le gouvernement Balladur transforme l’ordonnance Séguin en loi valable cinq ans, dispositif pérennisé en 1998 sous la gauche plurielle, étendu aux fonctionnaires en 2003 par Raffarin et aux régimes spéciaux par François Fillon en 2008[96]. L’essentiel des préconisations du Livre blanc est d’ailleurs repris dans la réforme du gouvernement Balladur, alors que la droite vient de remporter les élections législatives. Deux ans plus tard, à l’issue de l’élection présidentielle, un nouveau projet de réforme est présenté aux Français. Le 26 octobre 1995, lors d’une allocution télévisée, Jacques Chirac, pourtant élu sur la thématique de la réduction de la « fracture sociale », érige en priorité la réduction des déficits publics. Le 15 novembre, le Premier ministre Alain Juppé annonce une série de mesures qui visent en large partie à étendre aux salariés du secteur public les préconisations du Livre blanc : allongement de deux ans et demi de la durée de cotisation et introduction d’une loi annuelle fixant les objectifs budgétaires de la Sécurité sociale[97]. Cette ardeur réformatrice se heurte à un puissant mouvement social dont les salariés du secteur des transports sont le fer de lance. Si dans la mémoire collective le plan Juppé est associé à la victoire des cheminots contre la réforme de leur système de retraite, ce plan marque aussi une défaite du mouvement social en 1996[98]. En effet, cette année-là, le gouvernement parvient à mettre sur pied un grand nombre d’institutions qui entérinent la dépossession des travailleurs de leur régime général de Sécurité sociale : le budget de la Sécurité sociale, la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) ou encore la création des Agences régionales d’hospitalisation (ancêtres des Agences régionales de santé) sous l’autorité directe du ministère de la Santé.
L’arrivée de la gauche au pouvoir en 1997 ne change pas fondamentalement la donne en matière de retraites. Refusant de revenir sur les réformes passées, le gouvernement Jospin affirme au contraire sa volonté de « défendre les retraites des Français » en allongeant progressivement la durée de cotisation des fonctionnaires pour la porter à quarante ans (aucune mesure n’est finalement prise en ce sens)[99]. Le gouvernement crée également un fonds spécial destiné à accumuler des réserves en prévision de l’arrivée à l’âge de la retraite des cohortes du baby-boom. C’est enfin le gouvernement de la gauche plurielle qui met sur pied le Conseil d’orientation des retraites (COR) pour organiser dans la durée la concertation sur l’avenir des retraites. Dans les années 2000, les avis émis par le COR contribuent à justifier l’agenda réformateur des gouvernements de droite successifs.
À l’été 2002, le nouveau gouvernement mené par Jean-Pierre Raffarin annonce son intention de réaliser une nouvelle réforme des retraites. Le pilotage du dossier est confié à François Fillon, ministre des Affaires sociales et à Jean-Paul Delevoye, ministre de la Fonction publique. La réforme de 2003 généralise pour l’ensemble des actifs le système des décotes et surcotes afin d’inciter au recul de l’âge de la retraite. Elle concerne cependant de manière prioritaire les fonctionnaires en allongeant la durée d’assurance requise pour l’accès au taux plein (de 37,5 ans à 40 ans) et en indexant leurs pensions sur les prix[100]. En « compensation » de ces réformes, un régime additionnel (RAFP) prenant en compte une partie des primes des fonctionnaires est créé, introduisant une forme de capitalisation dans le régime de retraite de la fonction publique dans un contexte de gel des salaires et de généralisation des primes[101].
Cette réforme est complétée par celle de 2010, portée par le gouvernement de François Fillon. Ce dernier fait adopter un relèvement progressif de l’âge légal de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans et de l’âge du droit automatique au taux plein de 65 à 67 ans. La réforme de Marisol Touraine (dont la mise en place n’est pas encore achevée), initiée en 2014 par un gouvernement socialiste, s’inscrit dans la logique des précédentes puisqu’elle allonge la durée de cotisation nécessaire pour toucher une retraite à taux plein, sans toutefois toucher à l’âge de départ[102]. Les contreparties visant à garantir le caractère socialement juste de cet allongement apparaissent minimes : assouplissement de l’acquisition de trimestres d’assurance pour tenir compte des périodes de travail précaire, facilitation de l’ouverture à la retraite anticipée pour les salariés ayant commencé à travailler avant 20 ans ou pour les travailleurs handicapés. Enfin est ouvert un compte personnel de prévention de la pénibilité au travail, fonctionnant par points, système issu des régimes complémentaires et défendu par la CFDT. Combinées avec l’allongement de la durée de cotisation, ces réformes contribuent à la réduction globale des droits à la retraite.
Ces différentes modifications du système de retraite ont contribué à faire passer l’âge moyen de départ à la retraite de 60,7 ans en 2000 à 62,4 en 2020[103] mais également à faire diminuer le taux de remplacement médian[104]. De ce fait, le mouvement amorcé au début des années 1970 d’élévation du niveau de vie des personnes de plus de 65 ans s’est interrompu[105]. L’historien Christophe Capuano a montré comment le développement de la Sécurité sociale après 1945, conjugué avec des dispositifs spécifiques comme le minimum vieillesse, avait puissamment contribué à éradiquer la très grande pauvreté qui sévissait alors massivement dans les catégories les plus âgées de la population française[106]. Ainsi, en 2015, les plus de 65 ans font deux fois moins souvent que les 25-64 ans partie des 10 % les plus modestes et sont aussi deux fois moins souvent concernés par la pauvreté monétaire[107].
Cette amélioration progressive s’est interrompue pour les générations de retraités les plus récentes : les personnes nées entre 1946 et 1950, ont un niveau de vie comparable, voire légèrement inférieur, pour un âge donné, à celui de la génération 1941-1945. À ces transformations s’ajoutent, depuis les années 1980, des politiques économiques de gel des cotisations assises sur le salaire qui assèchent les financements des caisses de retraites et mettent en péril l’équilibre du système dans son ensemble. Ainsi le taux de cotisation patronal n’a pas évolué depuis 1979 et connaît depuis la fin des années 1990 un recul certain, notamment via les exonérations dégressives jusqu’à 1,6 SMIC[108]. Les cotisations salariales ont quant à elles vu leur hausse progressive stoppée au milieu des années 1990, conduisant à une étatisation croissante du financement des retraites et ouvrant la voie à des systèmes d’épargne et de prévoyance retraite. C’est à ce « déclin organisé[109] » de la Sécurité sociale en général, et du système de retraites en particulier, que s’oppose de larges pans de la société françaises au cours de spectaculaires mouvements sociaux.
Résistances populaires : « la mère des batailles »
En 1995, en 2003, en 2010 les projets de contre-réforme des retraites provoquent des mouvements sociaux massifs[110]. L’importance économique des pensions, l’ampleur de la mobilisation syndicale ainsi que le caractère universel de la question des retraites expliquent en partie l’intensité des grèves et des manifestations auxquelles les projets gouvernementaux se heurtent systématiquement. « Mère des batailles[111] » dans la vie politique française des quarante dernières années, la lutte pour les retraites connaît toutefois des dénouements variés. Ainsi, si les opposants à la réforme apparaissent en partie victorieux en 1995, ils sont en revanche défaits en 2003 et 2010. Le dernier projet de réforme en date, mis à l’agenda au cours de l’hiver 2019-2020, s’est soldé par la victoire des opposants à la réforme et le report sine die de celle-ci[112]. Ce dénouement a été rendu possible par la conjonction d’une opposition parlementaire résolue multipliant les amendements, d’un front syndical large, de grèves nombreuses et d’une mobilisation considérable dans la rue. Elle est aussi en partie due aux circonstances exceptionnelles de la pandémie de Covid-19, lesquelles ont contraint le gouvernement d’Édouard Philippe à mettre entre parenthèses ce projet de réforme systémique voulu par Emmanuel Macron. Revenir sur ces différents moments de l’histoire récente permet d’en restituer le déroulement, d’en identifier les principaux acteurs et de dégager les similitudes qui peuvent exister comme leurs spécificités intrinsèques.
La victoire de 1995 ?

Lorsque Jacques Chirac annonce en 1995 une réforme de l’assurance-maladie, un « contrat de plan » austéritaire pour la SNCF et un alignement du régime de retraite du public sur celui des salariés du privé, la CGT et Force ouvrière (mais pas la CFDT) décident d’engager un bras de fer avec le pouvoir fraîchement élu. Les cheminots apparaissent comme l’élément moteur de la mobilisation[113]. Le jeudi 23 novembre au soir, les sept fédérations syndicales du rail français appellent leurs adhérents à débrayer. La grève du 24 est très suivie, mais dans le secteur des transports ferroviaires uniquement. À l’issue de nombreuses assemblées générales, la grève est reconduite dans la plupart des centres SNCF le lundi 27 novembre[114]. Les conducteurs de train, dont le départ à la retraite à 50 ans est directement menacé, sont les plus mobilisés. Christian Chevandier estime leur taux de participation au plus fort du conflit à 90 % (légèrement au-dessus de 50 % pour les autres catégories de cheminots)[115]. Les cadres, traditionnellement mobilisés pour contourner les dysfonctionnements liés aux grèves, rejoignent cette fois largement le mouvement et contribuent fortement à son succès.
Aux grèves dans les transports s’ajoutent, à compter de la toute fin du mois de novembre, le blocage des centres de tri postaux[116] ainsi que les agents d’EDF-GDF dont la moitié sont en grève. Ce sont donc les secteurs clefs du transport, de l’énergie et du courrier qui sont les premiers à entrer dans une lutte qui les concerne au premier chef. Ce qui caractérise les manifestations du début du mois de décembre, c’est leur dimension interprofessionnelle, à l’image de celle du 5 décembre. Dès février 1995, le secrétaire général de Force ouvrière Marc Blondel déclarait d’ailleurs : « La défense de la Sécurité sociale mérite une grève générale interprofessionnelle. Nous y sommes prêts si nécessaire[117] ». Les syndicats et leurs adhérents se préparent en effet depuis le début de l’année 1995 à des attaques contre le système de Sécurité sociale et les systèmes de retraite. Le 5 décembre, la grève devient massive dans l’Éducation nationale puisque près de 45 % des agents cessent le travail selon le Ministère lui-même. La stratégie des journées d’action déployée par les syndicats est alors celle d’une véritable montée en puissance dont les journées de grève constituent autant d’étapes.
Devant la pression de la rue et les blocages persistants à la SNCF, le Premier ministre Alain Juppé annonce, le 10 décembre, la tenue d’un congrès social et le renoncement du plan cadre pour la SNCF. Celui qui déclarait le 16 novembre dans les colonnes du journal Sud-Ouest : « si deux millions de personnes descendent dans la rue, mon gouvernement n’y survivra pas. Mais je ne crois pas à cette hypothèse[118] », se voit infliger un camouflet par les manifestants le 12 décembre, puisqu’ils sont plus d’un million pour le ministère de l’Intérieur et près du double pour les confédérations syndicales. Le « Juppéthon » moqueur des « Guignols de l’Info » a été approprié par les cortèges de manifestants. Le quotidien régional Le Progrès peut titrer : « La rue déborde[119] ». À Noël, le mouvement s’achève tandis que les conducteurs de tramways marseillais reprennent définitivement le travail au début du mois de janvier 1996. La victoire du mouvement social est indéniable puisque les mesures les plus emblématiques du gouvernement, la révision du système de retraite dans le secteur public et le contrat de plan avec la SNCF, sont retirées. Toutefois, comme le souligne Nicolas Da Silva, cette victoire, pour impressionnante qu’elle soit, demeure en demi-teinte dans la mesure où les mesures concernant la Sécurité sociale sont appliquées dès l’année 1996[120].
Le succès de la grève de 1995 doit beaucoup au volontarisme affiché par les directions syndicales ainsi qu’aux actions menées sur le terrain par les militants cheminots, postiers ou électriciens-gaziers. Les nombreuses assemblées générales inter-services, emblématiques du mouvement, ont contribué à entraîner les différents secteurs les uns après les autres[121]. Si le secteur privé participe peu aux grèves, les sondages trahissent un basculement progressif de l’opinion en faveur des grévistes, ce qui a permis aux observateurs contemporains de parler de « grèves par procuration ». Les salariés du privé, fragilisés par la montée du chômage et les politiques de flexibilisation du marché du travail délègueraient aux travailleurs du public la défense de leurs intérêts communs. Ainsi, selon un sondage Ifop, 43 % des personnes interrogées estiment à la fin du mois de novembre que les grèves sont légitimes et doivent continuer tant que satisfaction n’a pas été obtenue[122].
Du côté des partis politiques, le mouvement reçoit peu de soutiens. François Hollande, alors porte-parole du PS déclare : « ce n’est pas à l’opposition de jouer les boutefeux ». Celui qui, en 1993, plaidait dans un article du Monde intitulé « Ruptures » pour une participation accrue des retraités au financement de la Sécurité sociale et à la généralisation de dispositifs assistanciels, se garde bien de soutenir un mouvement opposé à des mesures que son propre parti défend[123]. En effet, certaines mesures proposées par le plan Juppé sont directement inspirées du Livre blanc de Michel Rocard, ce qui explique en partie ce malaise du Parti socialiste vis-à-vis d’un mouvement très combatif, à l’exception des courants les plus à gauche. Les soutiens viennent ainsi plutôt de l’extrême-gauche trotskiste et du parti communiste.
Le mouvement a également d’importantes conséquences sur le monde syndical. La CGT-FO, absente des premières journées de mobilisation, devient finalement le partenaire privilégié de la CGT dans cette lutte, ce que manifeste par exemple la poignée de main de Louis Viannet, secrétaire général de la CGT, et de Marc Blondel le 28 novembre. La CFDT sort quant à elle très fragilisée du conflit dans la mesure où la confédération, dirigée par Nicole Notat, a apporté un « soutien critique » au plan Juppé[124]. Cette prise de distance avec les mouvements sociaux, qui rompt avec la tradition et la pratique de la CFDT des années 1960 et 1970, est mal vécue par une part significative des adhérents. Le mouvement de 1995 cristallise ces tensions latentes jusqu’à provoquer une scission avec la création des nouveaux syndicats SUD-Rail et Sud-PTT, lesquels se rattachent à l’Union syndicale solidaire[125].
2003, les raisons de l’oubli
Le mouvement de 2003, moins important dans la mémoire collective que celui de 1995, s’en rapproche pourtant de par la nature des attaques qui sont portées contre le système de retraites. Il s’agit en effet d’aligner la durée de cotisation des fonctionnaires sur celle des salariés du secteur privé. Les confédérations syndicales CGT et Force ouvrière, contrairement à 1995, sont initialement moins enclines à se mobiliser contre cette réforme et jouent davantage le jeu de la négociation avec le gouvernement, du moins jusqu’à ce que François Fillon présente explicitement le périmètre de la réforme. Le gouvernement, par volonté tactique, retarde continûment l’annonce publique de ses intentions jusqu’au 18 avril 2003. En choisissant la période des vacances scolaires de printemps, il souhaite en partie désamorcer la résistance des enseignants, dont les signes avant-coureurs sont, à cette date, déjà nombreux.
L’opération est un échec puisque c’est bien du monde enseignant que surgit la contestation qui met en branle un mouvement social d’ampleur d’avril à juin 2003[126]. Alors que François Fillon annonce le 24 avril que sa réforme « est la seule possible », les assemblées générales se multiplient dans les établissements scolaires. André Désiré Robert et Jeffrey Tyssens relèvent le caractère original de cette grève enseignante, marquée par une durée relativement longue, la recherche de formes d’action renouvelées, la redéfinition de la place des organisations syndicales dans le mouvement revendicatif au profit de « collectifs » censés mieux exprimer la base, un certain climat de radicalité, et son retentissement dans l’opinion[127]. Le 6 mai a lieu une journée de grève très suivie par les agents de l’Éducation nationale, laquelle prépare le terrain à la journée d’action interprofessionnelle du 13 mai.
Conscients de la nécessité d’élargir le mouvement, les collectifs enseignants multiplient les slogans à destination des autres secteurs du monde du travail : « Il y en a marre de ces guignols qui ferment les usines et cassent les écoles[128] ». Des assemblées générales interprofessionnelles sont à nouveau organisées tandis que certains enseignants se déclarent en grève reconductible afin de participer activement à l’élargissement du mouvement et à l’organisation de la journée du 13 mai. Les différentes confédérations syndicales (CGT, FO, FSU, CFDT) appellent finalement à la mobilisation contre la réforme Fillon et la journée du 13 est un immense succès puisqu’on compte entre 1 et 2 millions de manifestants à travers le pays. Les syndicats enseignants déclarent relever 66 % de grévistes dans l’Éducation nationale. Cette mobilisation considérable est à l’origine de la fameuse formule de Jean-Pierre Raffarin, largement reprise par la suite : « C’est pas la rue qui gouverne ».
Le 15 mai, la CFDT de François Chérèque signe un accord avec le gouvernement, acceptant la réforme en échange de la mise en place d’un dispositif spécifique pour les carrières longues[129]. Les critiques, très virulentes de la part des partenaires de Chérèque, émanent également de l’intérieur de la CFDT. Cette décision de la direction provoque en effet une hémorragie d’adhérents (près de 15 000 personnes rendent leur carte). À cette fragmentation du front syndical (qui n’est pas une nouveauté) s’ajoute la stratégie attentiste de la CGT et de Force ouvrière qui déclarent, conjointement avec l’UNSA et la FSU, souhaiter « une mobilisation plus grande du secteur privé afin de faire plier le gouvernement ». Une journée d’action est ainsi prévue le dimanche 25 mai et une journée de grève annoncée le 3 juin, ce qui, pour nombre d’enseignants, apparaît trop tardif. Si ces deux journées sont finalement un succès en termes de participation (près de 500 000 personnes défilent le 25 mai), avec notamment la présence de nombreux salariés de la SNCF, de la Poste et de la RATP, ceux-ci reprennent largement le travail au début du mois de juin, contribuant à l’isolement des enseignants et à l’adoption de la réforme. Les difficultés de mobilisation du personnel de l’Éducation nationale dans les mouvements sociaux des années suivantes peuvent en partie s’expliquer par ce sentiment d’abandon et l’échec final d’un mouvement exceptionnel par sa longueur et son intensité[130].
2010, l’impuissance ?

Lorsque Nicolas Sarkozy esquisse, au mois de juin 2010, son projet de réforme des retraites, celui-ci, à l’inverse de 1995 et 2003, concerne l’ensemble des catégories de salariés, du public comme du privé. Ce report de l’âge légal de départ à la retraite au nom de la réduction des dépenses publiques provoque une forte mobilisation du monde du travail et une lutte d’ampleur s’étalant du mois de mars, pour les premières journées d’action, au mois de novembre. Les chercheurs en science politique Sophie Béroud et Karel Yon inscrivent ce mouvement dans la lignée de celui de 1995 en soulignant notamment sa logique d’élargissement progressif à des secteurs de plus en plus nombreux (par exemple les lycéens)[131].
Dès le 24 juin, une journée d’action interprofessionnelle à laquelle l’ensemble des syndicats appelle réunit entre 800 000 et 2 millions de manifestants. Par rapport à 2003, le mouvement apparaît nourri d’un rejet plus large de la politique de Nicolas Sarkozy, lui conférant une dimension politique plus affirmée, notamment dans le contexte de l’affaire Woerth-Bettencourt dont les manifestants se saisissent. Le mouvement contre la réforme des retraites est ainsi une réponse du monde du travail à la politique du « Président des riches » selon l’expression des sociologues Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot[132]. Au lendemain de la pause estivale, la journée du 7 septembre renoue avec les très hauts niveaux de mobilisation observés en juin : plus d’un million de personnes défilent dans les rues et le mouvement s’intensifie de la fin du mois de septembre à la fin octobre. Les journées du 23 septembre ainsi que des 2, 12 et 16 octobre dépassent les 3 millions de manifestants. La journée du 28 octobre est encore marquée par une forte mobilisation avant que celle-ci ne décroisse au début du mois de novembre.
Le mouvement apparaît donc encore plus puissant que ceux de 1995 et 2003. Une spécificité du mouvement de 2010 est de présenter un front syndical unique rassemblant les huit principales confédérations syndicales. La CFDT, après l’épisode éprouvant de 2003, choisit d’éviter de faire cavalier seul. La CGT, porte quant à elle de manière très volontaire le cadre unitaire dans la perspective d’un « syndicalisme rassemblé ». D’un point de vue stratégique, il s’agit d’adopter une posture ouverte afin de faire peser sur le gouvernement la responsabilité de la radicalisation du mouvement et ainsi remporter la bataille de l’opinion publique. Ce dernier pari est en partie réussi puisqu’en octobre, au cœur du mouvement, un sondage BVA relève un faible nombre d’indécis à la question : « Si le gouvernement refuse de revenir sur sa décision de repousser l’âge du départ à la retraite, seriez-vous favorable ou opposé à ce que les syndicats organisent une grève générale comme en 1995 ? ». Les interrogés sont 54 % à se déclarer favorables et 45 % défavorables[133].
Cette stratégie intersyndicale s’est nourrie de la très forte participation des salariés du secteur public et privé, lui permettant de dépasser les fortes tensions qui pouvaient exister entre par exemple la CGC d’une part, et Solidaires d’autre part. Contrairement à 1995 et 2003, les salariés moteurs de la mobilisation sont ceux du secteur privé, notamment les raffineurs, dont la grève fait craindre un blocage du pays. Le 18 octobre, les professionnels du secteur recensent ainsi entre 2 500 et 2 600 stations-service sans essence[134]. La mobilisation des cheminots et des enseignants, certes importante, s’est quant à elle heurtée à de nombreux obstacles : l’accumulation des échecs depuis 2003 ou encore la loi de 2007 sur le service minimum dans les transports. De même, si les cortèges des manifestations sont impressionnants, la grève, sous sa forme reconductible, peine à s’installer et demeure localisée à quelques secteurs : les raffineries, la SNCF ou les ports. L’absence de perspectives claires à l’issue de la journée de mobilisation du 19 octobre a quant à elle nourri la thématique de l’essoufflement du mouvement. L’échec des opposants à la réforme est rendu manifeste le 16 novembre, lorsque Nicolas Sarkozy décide, sur le plateau du journal de TF1, de rendre hommage aux forces syndicales pour leur gestion du conflit et l’absence de violences.
Ce rapide retour sur les réformes des retraites et les oppositions qu’elles ont rencontré en 1995, 2003 et 2010 met en évidence deux éléments : d’une part les réformes des retraites sont des moments de conflictualité sociale majeurs et d’autre part, le succès ou l’échec d’un mouvement ne saurait être déterminé à l’avance. Ces mouvements sociaux ont leurs dynamiques propres, lesquelles dépendent de très nombreux facteurs dont il n’est pas toujours aisé de mesurer l’importance. L’implication des centrales syndicales, le rapprochement des journées d’action, le caractère reconductible des grèves, le soutien des partis politiques ou la multiplication des manifestations sont des éléments décisifs de ces luttes. Si les secteurs comme les transports ou l’énergie apparaissent comme les plus importants dans les statistiques administratives des grèves, leur centralité dans les conflits du travail est surtout rendue visibles par les grandes séquences de mobilisation interprofessionnelle que sont les mouvements de l’automne 1995, de 2003 ou de 2010[135]. L’ampleur du mouvement de l’hiver 2019-2020, tout comme la participation massive à la journée d’action du 19 janvier 2023, attestent quant à elles de l’attachement des Français en général, et des salariés en particulier, au système de retraite tel qu’il s’est constitué au fil des luttes du XXe siècle.
Conclusion
Cet aperçu de l’histoire de notre système de retraite permet de saisir l’importance des mouvements sociaux dans la mise en place d’une législation sociale à la hauteur de leurs aspirations. Longtemps aléatoire ou subordonnée à une relation paternaliste, la prise en charge du risque vieillesse en France a progressivement évolué, au rythme des luttes et des conquêtes sociales, pour prendre la forme après la Libération d’un système par répartition, fondé sur la continuation du salaire et participant à émanciper les assurés. Le pouvoir confié à ces derniers ainsi que la masse monétaire concernée par les pensions ont par la suite justifié de nombreuses attaques contre le régime général des retraites. Une série de réformes a ainsi eu pour effet de vider peu à peu ce régime de sa substance, toujours selon l’objectif annoncé de « garantir les retraites », lequel masque en réalité une libéralisation rampante du système de protection sociale.
Pendant la campagne présidentielle de 2017 déjà, Emmanuel Macron avait déclaré, le 4 septembre 2016 sur France inter, que « le modèle de l’après-guerre ne marche plus. Le consensus politique, économique et social, qui s’est fondé en 1945 et qui a été complété en 1958, est caduc. […] Le monde du travail de demain, c’est un monde dans lequel chacune et chacun devra plusieurs fois dans sa vie changer vraisemblablement d’entreprise, de secteur, et peut-être de statut, et donc, c’est un monde où il faut permettre à chacune et chacun de s’adapter à ces cycles économiques qui sont en train de se retourner. » Cet argumentaire reprenait largement le programme libéral en matière de protection sociale, fondé sur la responsabilisation des individus, considérés comme des agents économiques mineurs devant apprendre à assurer leur existence par leur initiative personnelle, à travers la capitalisation. On notera également le caractère décomplexé de cette remise en cause du modèle social français, qui renvoie à la volonté de moderniser un système devenu caduc et inadapté aux défis de demain.
C’est précisément cet agenda que le président de la République a appliqué depuis son arrivée au pouvoir : poursuivre le programme de réforme libérale engagé par ses prédécesseurs, afin d’en finir avec le modèle social hérité de la Libération. À ce titre, la réforme des retraites qu’Emmanuel Macron persiste à imposer sonne bel et bien comme un recul historique.
Glossaire
Cotisations : Part des salaires qui est socialisée. Elles peuvent être « salariales », à savoir prélevées directement sur le salaire brut de l’assuré, et/ou « patronales », calculées sur les salaires bruts et versées par l’employeur aux organismes chargés du recouvrement. Elles permettent le financement d’un système de protection sociale selon les moyens de l’assuré et sont redistribuées selon ses besoins.
Échevinage : Corps de ville ou municipalité.
Hospices : Au XIXe siècle, les hospices sont des institutions accueillant toutes sortes de souffrances sociales (invalides, incurables, vieillards, enfants abandonnés). Les fonctions de soin n’y sont que très progressivement intégrées.
Mutuelles : Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif organisant la solidarité entre leurs membres, et dont les fonds proviennent principalement des cotisations des membres.
Officier : Détenteur d’une parcelle d’autorité monarchique (l’office) vendue par l’État depuis le XVIe siècle. Elle peut être transmise depuis 1604, moyennant le paiement d’un droit annuel (la paulette).
Parlements : Aux époques médiévale et moderne, il s’agit de cours souveraines établies pour rendre la justice en dernier ressort, au nom du roi.
Pension : Allocation périodique versée à une personne. Sous l’Ancien Régime, les pensions visent principalement à récompenser les officiers qui se sont illustrés au service du roi en temps de paix ou en période de guerre.
Régimes complémentaires : Les régimes complémentaires de retraite (Agirc-Arrco) ont été créés dès 1947 en raison des plafonnements imposés au régime général. L’affiliation et le versement de cotisations sont obligatoires depuis 1972. Il s’agit d’un système par points.
Régime général : Né en 1946, le régime général ou l’Assurance retraite s’adresse aux salariés de l’industrie, du commerce et des services. Il est géré par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav).
Retraite par capitalisation : Système dans lequel chacun cotise et se constitue une épargne, soit sous forme de points, soit sous forme de placements.
Retraites par répartition : Système dans lequel les pensions des retraités sont financées par les cotisations des actifs, qui se constituent ainsi des droits pour leur retraite future.
Secours : Allocations découlant d’un droit politique décrété au moment de la Révolution française qui nationalise le principe de l’assistance (on passe alors de la charité à la bienfaisance).
Tontines : Dans le système des tontines, chaque souscripteur verse une somme dans un fonds et touche les dividendes du capital investi. Quand un souscripteur meurt, sa part est répartie entre les survivants. Le dernier survivant récupère le capital.
Bibliographie
Amable Bruno, La résistible ascension du néolibéralisme. Modernisation capitaliste et crise politique en France 1980-2020, Paris, La Découverte, 2021
Andrieu Claire, Le Programme commun de la Résistance : des idées dans la guerre, Paris, Éditions de l’Érudit, 1984.
Autrand Françoise, « Rétablir l’État : l’année 1454 au Parlement », Actes du104e Congrès national des Sociétés savantes, Bordeaux 1979. Section de philologie et d’histoire jusqu’à 1610, t. 1, Paris, 1981, p. 7-23
Autrand Françoise, « La force de l’âge : jeunesse et vieillesse au service de l’État en France aux XIVe et XVe siècles », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1985
Bergounioux Alain, et Fulla Mathieu, Michel Rocard Premier ministre, Paris, Presses de Sciences Po, 2020
Bernard Mathias, Les Années Mitterrand. Du changement socialiste au tournant libéral. Belin, 2015
Béroud Sophie, « Nouveaux usages et modalités des grèves », dans Pigenet Michel et Tartakowsky Danielle, (dir.), Histoire des mouvements sociaux en France. De 1814 à nos jours. La Découverte, 2014, p. 652-660.
Bois Jean-Pierre, Les vieux, de Montaigne aux premières retraites, Paris, Fayard, 1989
Boulhol Hervé et Queisser Monika, « Panorama des pensions 2021 : Comment la France se situe-t-elle ? », Éditions OCDE, 2021
Capuano Christophe, Que faire de nos vieux ? Une histoire de la protection sociale de 1880 à nos jours. Presses de Sciences Po, 2018
Castel Nicolas, La retraite des syndicats, Paris, La Dispute, 2009
Castel Nicolas, Retraites : généraliser le droit au salaire, Paris, Éditions du Croquant, 2020
Cézard Yann, « 1995-2003-2010. Retour sur trois batailles et leçons pour la lutte présente », l’Anticapitaliste, septembre 2013
Chevandier Christian, La Fabrique d’une génération. Georges Valero, postier, militant et écrivain, Paris, Éditions Les Belles Lettres, 2009
Chevandier Christian, « Les grèves de 1995 », dans Pigenet Michel et Tartakowsky Danielle, (dir.), Histoire des mouvements sociaux en France. De 1814 à nos jours. La Découverte, 2014, p. 633-639.
Cooper Frederick, Décolonisation et travail en Afrique. L’Afrique britannique et française, Paris, Karthala, 2004
Da Silva Nicolas, La bataille de la Sécu, une histoire du système de santé, Paris, La Fabrique, 2022
Dayen Daniel, Martin Nadaud, ouvrier maçon et député, 1815-1898, Le Puyfranc, Lucien Souny éditeur, 1998
De Novare Philippe, des IIII tenz d’aage d’ome, Paris, M. de Fréville, 1888
Deschamps Eustache, « Des vieulx serviteurs de la court et de leur boute hors », dans J.-P. Boudet et H. Millet (dir.), Eustache Deschamps en son temps, Paris, Publications de la Sorbonne, 1997, p. 204-206.
Douët d’Arcq Louis, Choix de pièces inédites relatives au règne de Charles VI, t. 1. Paris, 1864, p. 295-296
Dumons Bruno et Pollet Gilles, « Les socialistes français et la question des retraites (1880-1914). », Vingtième Siècle, revue d’histoire, n°38, avril-juin 1993. p. 34-46
Dreyfus Michel, Liberté, égalité, mutualité : mutualisme et syndicalisme 1852–1967, Paris, Éditions de l’Atelier, 2001
Dreyfus Michel et al., Se protéger, être protégé : Une histoire des assurances sociales en France, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006
Douzou Laurent, Découvrir le programme du CNR, Paris, les Éditions sociales, 2022.
Dupont Marc, « Les grands courants fondateurs de la réforme sociale et les grands moments de la réforme », dans Bulletin d’histoire de la Sécurité sociale, Paris, Association pour l’étude de l’histoire de la Sécurité sociale, 2006
Feller Élise, Du vieillard au retraité. La construction de la vieillesse dans la France du XXe siècle, Paris, L’Harmattan, 2017.
Fraboulet Danièle, « L’Union des industries métallurgiques et minières. Organisation, stratégies et pratiques du patronat métallurgique (1901-1940) », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, vol. 114, no. 2, 2012, p. 117-135.
Friot Bernard, Puissances du salariat, Paris, La Dispute, 1998
Friot Bernard, Le travail, enjeu des retraites, Paris, La Dispute, 2010
Génard Elsa et al., « Les liens familiaux à l’épreuve des institutions disciplinaires », Le Mouvement Social, vol. 279, n°2, 2022, p. 3-15.
Georgi Frank, CFDT : l’identité en questions. Regards sur un demi-siècle (1964-2014), Nancy, Arbre bleu éditions, 2014
Gleizes François, Grobon Sébastien et Rioux Laurence, « Niveau de vie et patrimoine des seniors : la progression au fil des générations semble s’interrompre pour les générations de seniors les plus récentes », dans France, portrait social, Paris, Insee, 2018.
Godin Romaric, La guerre sociale en France, Paris, La Découverte, 2019
Gonzalez Elizabeth, « L’heure de la retraite a sonné : les serviteurs de l’Hôtel du duc d’Orléans enfin de carrière (fin XIVe-fin XVe siècle) », dans : Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 29ᵉ congrès, Pau, 1998. Les serviteurs de l’État au Moyen Âge.
Hatzfeld Henri, Du paupérisme à la Sécurité Sociale. Essai sur les origines de la Sécurité Sociale en France. 1850-1940, Paris, Armand Colin, 1971
Hesse Philippe-Jean et Le Crom Jean-Pierre (dir.), La Protection sociale sous le régime de Vichy, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001
Imbert Jean, (dir.), La protection sociale sous la Révolution française, Paris, Association pour l’étude de l’histoire de la Sécurité Sociale, 1990
Johanet Gilles, « Sécurité sociale, 1993-2023, chronique d’un déclin organisé », Revue d’histoire de la protection sociale, vol. 13, n°. 1, 2020, p. 127-129.
Kott Sandrine, L’État social allemand. Représentation et pratiques, Paris, Belin,1995.
Laroque Michel, « L’adaptation de la politique d’assurance vieillesse au vieillissement (1961-2015) », Revue d’histoire de la protection sociale, vol. 13, n°1, 2020, p. 54-73.
Lespinet Moret Isabelle, « Arthur Fontaine, grand commis de la nation et ambassadeur du travail », Histoire et sociétés. Revue européenne d’histoire sociale, n° 6, 2003, p. 110-120
Machu Laure, « Construction et pratiques du système français de relations professionnelles », Thèse d’histoire contemporaine, Paris 10 Nanterre, 2011
Marec Yannick, Pauvreté et protection sociale au XIXe et au XXe siècle, des expériences rouennaises aux politiques nationales, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006.
Masméjan Jean-Baptiste, « Le comité de mendicité mandaté par la nation : vers une harmonisation de la politique d’assistance des valides (1790-1791) », Cahiers Jean Moulin, n° 2, 2016
Mattéoni Olivier, Servir le prince. Les officiers des ducs de Bourbon à la fin du Moyen Âge (1356-1523) : étude d’une société politique, mémoire de thèse de doctorat, Université de Paris-I, 1994, t. 2.
Mayens Paul, « La Caisse et l’expert : L’assistance technique du Bureau international du Travail auprès de la caisse des compensations de Dakar (1963-1967) », Revue d’histoire contemporaine de l’Afrique, nᵒ 3, 2022, p. 169-79.
Naji Ilias, Le retournement des retraites (1983-1993). Acteurs, histoire, politiques de l’emploi et circuits financiers. Thèse de sociologie soutenue sous la direction d’Odile Join-Lambert et Eve Chiapello.. Université de Versailles Saint-Quentin (Paris Saclay), 2020
Offenstadt Nicolas, En place publique. Jean de Gascogne, crieur au XVe siècle, Paris, éditions stock, 2013
Perrier Antoine et Zappi Lola, « Introduction. De la ville à l’empire colonial : nouvelles échelles de l’économie mixte du welfare (XIXe-XXe siècles) », Revue d’histoire de la protection sociale, vol. 15, n°1, 2022, p. 10-25
Pigenet Michel et Tartakowsky Danielle (dir.), Histoire des mouvements sociaux en France. De 1814 à nos jours. La Découverte, 2014
Pigenet Michel (dir.), Histoire des régimes spéciaux, Paris, ESF, 2008.
Pinçon-Charlot Monique et Pinçon Michel, Le président des riches. Enquête sur l’oligarchie dans la France de Nicolas Sarkozy, Paris, Zones, 2010
Pocquet du Haut-Jussé Barthélémy-Amédée, « Les pensionnaires fieffés des ducs de Bourgogne de 1352 à 1419 », Mémoires de la société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands, 8, 1942
Population Council, « Thomas Paine on a Plan for a Welfare State », Population and Development Review, vol. 39, n° 2, 2013, p. 325-332
Prost Antoine, « Jalons pour une histoire des retraites et des retraités (1914-1939) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 11, n°4, Octobre-décembre 1964.
Renard Didier, « Une vieillesse républicaine ? L’État et la protection sociale de la vieillesse de l’assistance aux assurances sociales (1880-1914) », Sociétés contemporaines, n°10, 1992, p. 9-22
Robert André Désiré, Tyssens Jeffrey, « Comparer deux grèves prolongées d’enseignants : Belgique francophone 1996, France 2003 », Éducation et sociétés, vol. 20, n° 2, 2007, p. 61-73.
Rosell Léo, « Quand Zemmour réécrit l’histoire de la Résistance et des conquêtes de la Libération », dans Sylvain Boulouque, Raphaëlle Branche, Pascal Brioist et al., Le grand détournement. Quand Zemmour falsifie l’histoire, Neuilly-sur-Seine, Atlande, 2022, p. 89-136.
Rossigneux-Méheust Mathilde, Vies d’hospice. Vieillir et mourir en institution au XIXe siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2018
Souamaa Nadjib, « Les origines de l’OIT (1890-1950) : élaboration et premières expérimentations d’un modèle d’« Europe sociale » », La Revue de l’Ires, vol. 87, n° 4, 2015, p. 63-88.
Steiner Philippe, « Les Physiocrates et la Révolution française », Revue Française d’Histoire des Idées Politiques, vol. 20, n°2, 2004, p. 3
Topalov Christian (dir.), Laboratoires du nouveau siècle. La nébuleuse réformatrice et ses réseaux en France (1880-1914), Paris, Éditions de l’EHESS, 1999
Viet Vincent, « La question sociale et son traitement à la fin du XIXe siècle. Une comparaison France-Allemagne, Histoire & Sociétés. Revue européenne d’histoire sociale, n° 6, avril 2003, p. 6 -21.
Vigreux Jean, Histoire de la France contemporaine. Tome 9, Croissance et contestations (1958-1981), Paris, Seuil, 2014.
Vigreux Jean, Histoire du Front populaire. L’échappée belle, Paris, Tallandier, 2016.
Ressources complémentaires
Podcasts
- France Culture, La Fabrique de l’histoire, série « Histoire des retraites ». Épisode 1 : 1910, la loi sur les retraites est adoptée. URL : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-fabrique-de-l-histoire/histoire-des-retraites-1-3-4600736
- France Culture, La Fabrique de l’histoire, série « Histoire des retraites ». Épisode 2 : 1953, la grande grève contre une réforme des retraites. URL : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-fabrique-de-l-histoire/histoire-des-retraites-2-3-5875800
- France Culture, La Fabrique de l’histoire, série « Histoire des retraites ». Épisode 3 : Histoire des régimes spéciaux de retraites. URL : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/la-fabrique-de-l-histoire/histoire-des-retraites-3-3-7811242
- Petit Pauline, « Histoire de la retraite en France : de l’acquisition d’un droit à la valse des réformes », France Culture, 4 décembre 2019. URL : https://www.radiofrance.fr/franceculture/histoire-de-la-retraite-en-france-de-l-acquisition-d-un-droit-a-la-valse-des-reformes-1601330
- Tellier Maxime, « Capitalisation puis répartition : l’histoire de nos retraites », France Culture, 13 décembre 2019. URL : https://www.radiofrance.fr/franceculture/capitalisation-puis-repartition-l-histoire-de-nos-retraites-9252557
- France Culture, Le cours de l’histoire, série « Vieillir, mais comment ? Une histoire sociale de la vieillesse ». Épisode 8/4 : Assurer la vieillesse, la longue histoire des retraites. URL : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-cours-de-l-histoire/assurer-la-vieillesse-la-longue-histoire-des-retraites-8057051
- France Culture, Entendez-vous l’éco, série « Etat social, tu perds ton sang froid ». Épisode 1 : Au secours de nos vieux. URL : https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/entendez-vous-l-eco/au-secours-de-nos-vieux-6789864
Films et documentaires
- Gilles Perret, La Sociale, Rouge productions, 84’, 2016, https://www.lasociale.fr/le-film/

