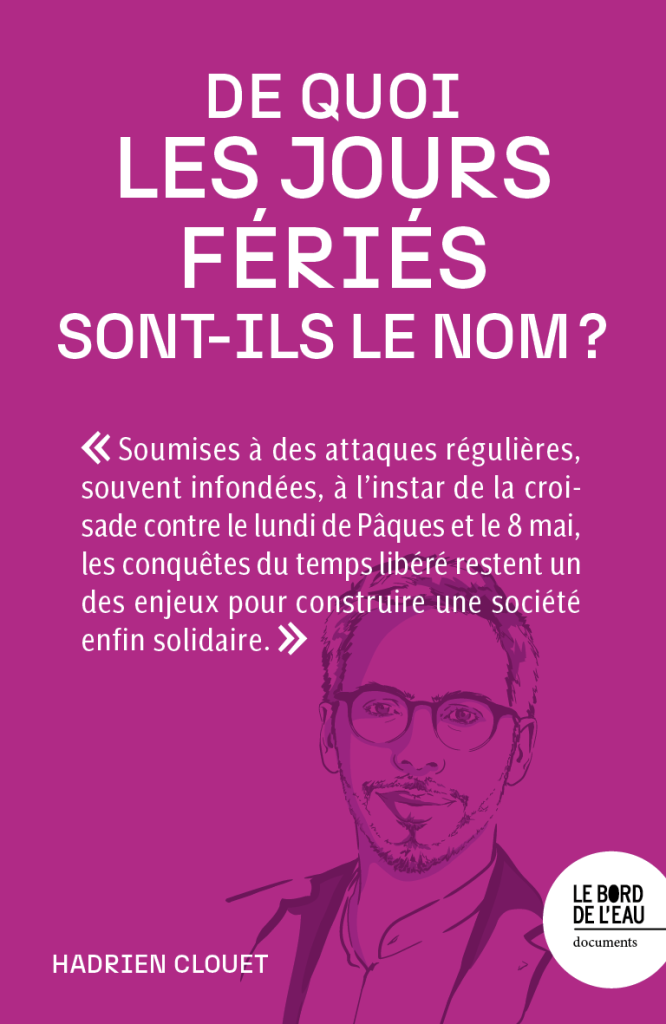| Note de lecture de l’ouvrage d’Hadrien Clouet, « De quoi les jours fériés sont-ils le nom ? », Éditions Le Bord de l’eau, octobre 2025 |
Hadrien Clouet est sociologue et député de la France insoumise depuis 2022. Il est chercheur associé au CERTOP (Université Toulouse-Jean Jaurès), au Centre de Sociologie des Organisations (Sciences Po) ainsi qu’au Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique (CNAM). Il est spécialisé dans la sociologie du travail et l’étude de l’action publique. Il est co-responsable du département de sociologie de l’Institut La Boétie. Il a notamment publié Emplois non pourvus : une offensive contre le salariat (2022) et coécrit Chômeurs, vos papiers ! (2023).
De quoi les jours fériés sont-ils le nom ? À l’été 2025, le gouvernement Bayrou a annoncé vouloir supprimer 2 jours fériés pour économiser 4,2 milliards d’euros et redresser les comptes publics. Dans ce court ouvrage, Hadrien Clouet explique que cette proposition n’est pas simplement une provocation isolée et anecdotique du macronisme. Elle s’inscrit dans la lutte de longue date que mène le capitalisme contre le temps libre des travailleurs et des travailleuses. Symbole du « travailler plus pour gagner moins » de la droite néolibérale, elle est aujourd’hui au cœur de l’offensive conservatrice contre les conquis sociaux.
Pour mieux comprendre cette opération, Hadrien Clouet remonte le fil de la longue histoire des jours fériés en France et des luttes sociales qui ont mené à leur instauration malgré l’hostilité du patronat. Il démontre ensuite comment la suppression de 2 jours fériés proposée par les macronistes vise en réalité à diminuer le salaire réel des travailleurs au profit du capital, un objectif central pour les néolibéraux. Il revient enfin sur les vertus sociales du temps libéré pour la société, en décrivant les formes d’activité et de sociabilité que permettent les jours fériés.
Ce livre déconstruit minutieusement les nombreux poncifs néolibéraux sur la question du temps de travail et propose au contraire une lecture politique de la mise en place des jours fériés. Ce faisant, il la donne à voir cette pour ce qu’elle est : une lutte de classes.
| « Les luttes du capitalisme sont des luttes de temps. » |
I) Les jours fériés : du temps libre gagné par les travailleurs contre les élites patronales et politiques
Les premiers jours fériés apparaissent dans notre histoire avec l’instauration de la République. Il s’agit alors de souder le peuple autour de moments importants de la construction nationale, comme la proclamation de la IIe République le 24 février, après l’abdication du roi Louis-Philippe Ier. C’est ensuite sous la IIIe République que naissent la plupart des jours fériés que l’on connaît aujourd’hui : le 14 juillet, bien sûr, mais aussi les lundis de Pâques et de Pentecôte rendus fériés par la loi du 8 mars 1886. Surprenamment, la demande n’émanait pas des instances religieuses mais des banques et des chambres de commerces, pour des raisons purement commerciales et financières[1]. Malgré cela, la résistance patronale se met rapidement en place, notamment dans le secteur de l’industrie. Beaucoup d’employeurs refusent d’octroyer ces jours fériés à leurs employés. Les procès verbaux pour « violation de jours fériés légaux » se multiplient partout sur le territoire. C’est seulement grâce à la mobilisation des syndicats, associations et autres organismes publics que les salariés pourront bénéficier effectivement de ces droits.

Cet affrontement de classe est encore plus marqué dans le cas du Premier Mai, journée internationale des travailleurs, rendu férié par la mobilisation consciente de la classe ouvrière. Dès 1889, le congrès socialiste de Paris exige de proclamer ce jour férié. Les mairies socialistes puis communistes vont ensuite progressivement le mettre en place pour leurs propres services municipaux et défendre sa généralisation à l’ensemble du pays, en demandant un vote de la chambre des députés. Après son instrumentalisation par le régime de Vichy – qui le transforme en « Jour du Travail » – le Premier Mai est inscrit dans le marbre à la Libération par les forces de la résistance. Le 1er mai 1946 est le premier chômé à salaire constant. En 1947, le gouvernement pérennise la disposition pour tous les premiers mai à venir, et la loi du 29 avril 1948 précise les modalités de cette généralisation.
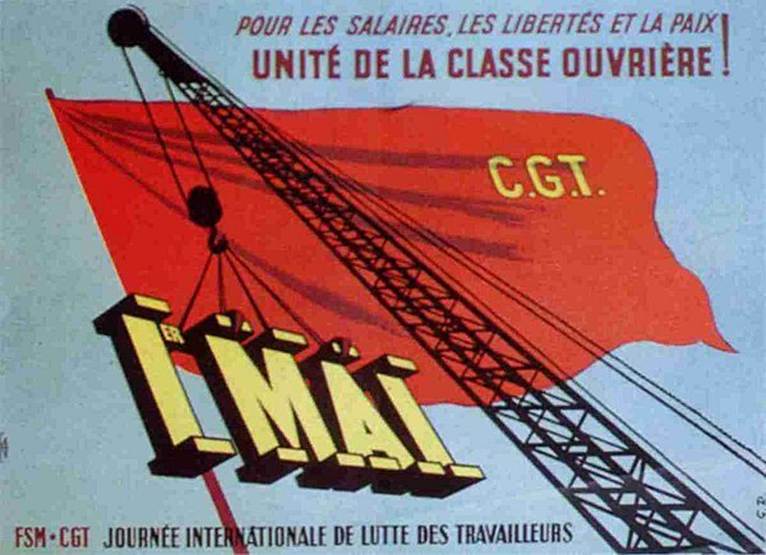
L’instauration du 8 Mai férié a elle aussi été le fruit d’un long combat. Au lendemain de la guerre, l’État ne souhaite pas reconnaître la spécificité de la victoire du 8 mai 1945 contre le nazisme, trop marquée politiquement par la résistance antifasciste et communiste. Alors que le 11 Novembre est rendu férié dès 1922 en hommage aux morts de la Première Guerre mondiale, le jour de la capitulation allemande devra attendre 1953 – et des années de mobilisations communistes et gaullistes – avant de devenir un jour férié.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Dans les années qui suivent, le 8 Mai férié sera régulièrement supprimé puis rétabli – pour des raisons à la fois politiques et économiques. En 1959, De Gaulle décale la commémoration nationale au deuxième dimanche de mai, avec les mêmes justifications que celle d’un François Bayrou aujourd’hui : de trop nombreux ponts tueraient la productivité nationale… S’ensuivent plusieurs années de va-et-vient. En 1975, le président Valéry Giscard d’Estaing abroge tout simplement la commémoration officielle de la victoire sur le nazisme, au nom de l’amitié franco-allemande. En 1979, le Sénat vote son rétablissement comme jour férié, avant qu’il ne redevienne définitivement un jour férié et chômé sous la présidence de François Mitterrand.
Avec six évolutions en un demi-siècle, le 8 Mai symbolise à lui seul le caractère profondément politique et polarisant des jours fériés.
| Trop de jours fériés : les Français travaillent-ils vraiment moins que leurs voisins ? L’idée selon laquelle les Français travaillent moins que leurs voisins européens est un mythe, y compris du point de vue du nombre de jours fériés, rappelle Hadrien Clouet. • Les pays de l’Union européenne comptent en moyenne 12 jours fériés par an. Avec ses 11 jours fériés, la France se situe en dessous, à l’inverse de Chypre (15), de l’Espagne, Malte et la Slovaquie (13) ou encore de la Finlande, l’Autriche et le Portugal (13). • Même si on additionne jours fériés et congés payés, la France comptabilise 36 jours, contre 44 pour l’Espagne et Malte, 38 pour l’Autriche et 37 pour le Luxembourg. • Le temps de travail des Français n’est pas plus faible qu’en Europe. Un salarié français travaille 1491 heures par an en moyenne : c’est plus que les Allemands, les Danois, les Norvégiens, les Suédois, les Autrichiens, les Islandais, les Hollandais ou encore les Luxembourgeois. • Le temps de travail hebdomadaire moyen en France est de 37 heures. Mais il cache de fortes disparités. 1 salarié sur 5 travaille plus de 48 heures par semaine. Pour ces travailleurs, supprimer un jour férié équivaut à supprimer l’une de leurs dernières bouées de sauvetage. |
II) L’offensive macroniste contre les jours fériés : une extorsion du salaire pour les poches du capital
Derrière la justification budgétaire du Gouvernement – « Il faut sauver les finances publiques » – la suppression des jours fériés cache en réalité un autre objectif : diminuer les salaires réels et accroître les profits privés. En supprimant des jours fériés, l’État entend se faire de l’argent sur le dos du travail gratuit des salariés, tout en taxant une une partie du revenu de l’entreprise en contrepartie de ce surcroît d’activité. Or, cette contribution patronale n’est pas fléchée. On ne sait donc même pas où ira le fruit de notre travail gratuit : « Va-t-on travailler gratuitement pour financer les engagements présidentiels en matière de Défense nationale à 5 % du produit intérieur brut, dans une logique farfelue voulant que l’on indexe nos crédits militaires sur le niveau de richesse du pays ? Va-t-on abdiquer le droit au repos pour passer commande auprès du complexe militaro-industriel nord-américain ? » (p. 33).

C’est un retournement de la logique de la Sécurité sociale, explique Hadrien Clouet. Depuis 1946, le développement de la protection sociale reposait sur une hausse continue des cotisations qui augmentait ses recettes. La Sécurité sociale ne s’est jamais appuyée sur la réduction de la rémunération du travail : au contraire, son fonctionnement repose sur la hausse des salaires. Or, aujourd’hui, les macronistes veulent renverser cette logique et lier le destin de la Sécurité sociale au développement du travail gratuit, en imposant l’idée que les comptes de la Sécurité sociale seraient minés par une trop forte rémunération du travail. Ils créent ainsi une opposition factice entre salariés et assurés, alors que le principe de la protection sociale est justement de lier leur sort.
Mais combien vaut cette manœuvre idéologique ? Pas beaucoup, visiblement. L’ancien Premier ministre François Bayrou estime à 4,2 milliards d’euros le gain de la suppression de deux jours fériés. Et encore, « le chiffre a été inventé sur un coin de table », avance Hadrien Clouet, et se fonde sur un calcul très incertain. En réalité, les recettes supplémentaires de la suppression d’un jour férié gravitent plutôt autour d’1,5 milliard d’euros, selon l’OFCE. Donc environ 3 milliards pour deux jours.
À titre de comparaison, la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a coûté 4,5 milliards d’euros, soit 3 jours fériés. La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 5 milliards, soit plus de 3 jours fériés. La mise en place de la flat tax : 4 milliards, soit 2,5 jours fériés. Autrement dit, rétablir l’ISF, la CVAE et l’imposition mobilière nous rapporterait 9 jours fériés ! Par ailleurs, les gains économiques attendus liés au regain d’activité productif sont illusoires : dans un contexte d’austérité sans précédent, la consommation populaire est largement en berne.

Ceux qui vont s’enrichir de cette mesure, ce sont donc les capitalistes. En faisant appel aux fondamentaux marxistes, Hadrien Clouet nous rappelle le principe du salaire : c’est la rémunération versée en échange de la location d’une force de travail pour un temps donné. Ainsi, « lorsque l’on loue sa force de travail plus longtemps, mais à salaire constant, il est évident que le prix de cette force de travail a baissé. ». Or c’est précisément l’objectif de la suppression des jours fériés. Travailler 2 jours de plus sans hausse de salaire, cela revient à perdre environ 1 % de rémunération annuelle, voire davantage pour les salariés disposant d’un accord de branche et qui bénéficiaient d’une majoration pour leur travail en jour férié.
Le gouvernement cherche donc à augmenter le temps de travail par tous les moyens. Sa dernière invention en date : la monétisation de la cinquième semaine de congés payés. Autrement dit, il s’agit d’offrir aux salariés la possibilité d’abandonner leur semaine de congé contre une rémunération supplémentaire. Jours fériés, congés payés, retraite… : l’offensive néolibérale pour rogner sur le temps libre restant est générale.
III) Le temps libéré, ferment d’une société de l’intérêt général
| « Sauver, garantir et augmenter les jours fériés demeure donc un outil fondamental pour donner un sens irréductiblement collectif et autonome à nos existences. » |
La suppression des jours fériés est non seulement antisociale et inutile économiquement, elle est aussi nuisible aux activités solidaires et collectives de notre société. L’extension continue de la sphère marchande étouffe les vertus sociales et politiques du temps libre, explique Hadrien Clouet.
Aujourd’hui, le jour férié n’est plus nécessairement un grand rassemblement national commémoratif. L’usage du temps libre et du divertissement est plus fragmenté, plus divers que dans le passé. Mais les jours fériés continuent de jouer un rôle de « synchronisation collective des temps non lucratifs ». Certes, une fraction non négligeable de salariés continuent de travailler les jours fériés, et il est difficile de savoir exactement combien d’entre eux chôment ces jours fériés. Mais l’enquête Emploi de l’INSEE montrent tout de même qu’en présence d’un jour férié, le temps de travail hebdomadaire général baisse de 31 %. Les jours fériés demeurent une expérience de masse.
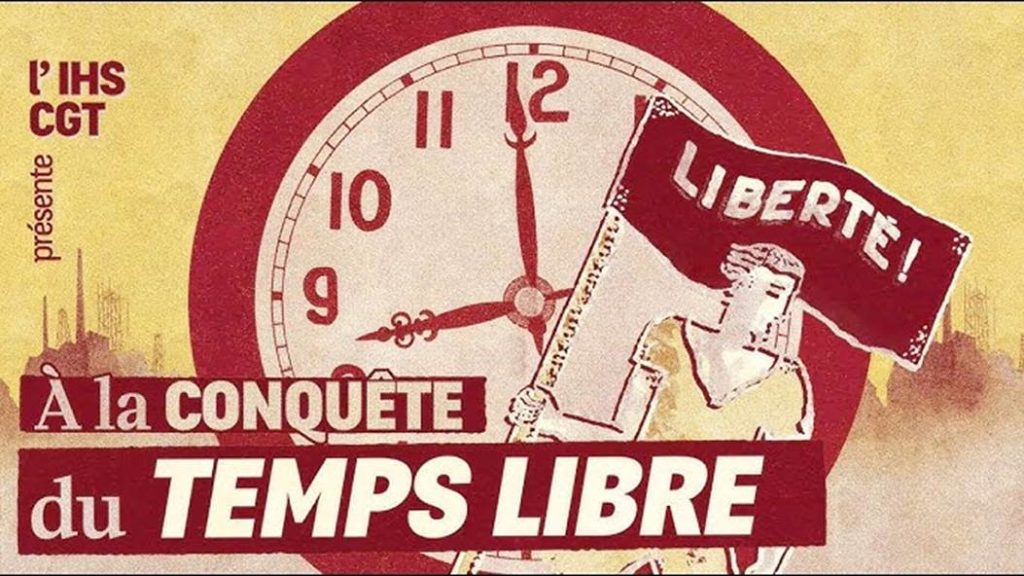
Mais que font réellement les travailleurs et travailleuses lors des jours fériés ? Comment profitent-ils de ce temps extraordinairement extirpé du quotidien marchandisé et à quelles fins ? C’est d’abord un temps où le repos devient possible, lui qui est continuellement réduit car il représente un obstacle à l’accumulation capitaliste à court terme. Le repos du jour férié est un acte informel de résistance explique Hadrien Clouet : un temps qui échappe à la tutelle patronale et aux cadences toujours plus effrénées du travail. Le temps libéré par le jour férié est aussi une occasion de travailler autrement, d’effectuer ce que l’anthropologue Florence Weber appelle le « travail d’à-côté » : bricolage, réparation, entretien…
Mais le temps libre des jours fériés permet plus que cela : il est aussi le temps du collectif, des loisirs partagées et des sociabilités. Pendant les jours fériés, le temps passé entre amis augmente de 20 minutes par rapport au reste du temps ! Ils renforcent les liens sociaux et les relations informelles au sein de la communauté, et notamment l’aide et la solidarité envers les plus vulnérables (rendre visite aux personnes âgées, donner du temps à une association…). Bref, les jours fériés sont souvent le temps de l’organisation collective, sociale, culturelle, politique, en dehors du rythme quotidien si empêchant. Ils sont donc le ferment d’une société de l’intérêt général. Les supprimer au nom de l’équilibre budgétaire, c’est avoir une basse idée de nos existences collectives, affirme Hadrien Clouet.
Il conclut en proposant non seulement de défendre nos onze jours fériés pour toutes les raisons évoquées, mais aussi d’en instaurer de nouveaux. Le propre du puissant est de dicter le temps du dominé, écrit Clouet. Renverser l’ordre des choses, c’est donc reconquérir ce temps à ceux qui le volent tout au long de nos existences. C’est la tâche de gauche de rupture si elle prend le pouvoir, qui pourrait alors instaurer de nouveaux jours fériés d’utilité publique qui symbolisent les conquêtes sociales du peuple et les grands moments de son histoire. Par exemple, le 24 février pour la mémoire de l’abolition de l’esclavage par le République, et le 18 mars, en mémoire de la Commune de Paris.
| « Être révolutionnaire, c’est assumer que la joie et le bonheur sont des objectifs en tant que tels. » |