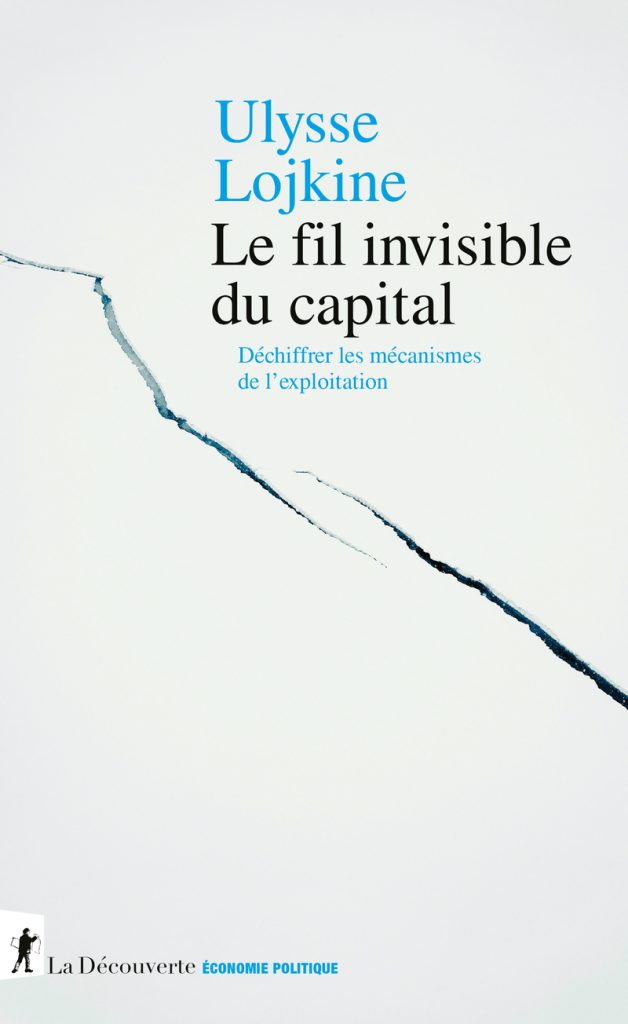| Note de lecture du livre d’Ulysse Lojkine, « Le fil invisible du capital : déchiffrer les mécanismes de l’exploitation », Éditions La Découverte, 2025 |
Ulysse Lojkine est normalien, agrégé de philosophie, doctorant en philosophie et en économie à l’Université de Paris-Nanterre et à l’École d’Économie de Paris, chercheur post-doctorant à Sciences Po Paris. Il a travaillé sur les concepts de pouvoir et d’exploitation dans le monde du travail autour des pensées marxiste et postkeynésienne.
Qui travaille pour qui ? Et qui exploite qui ? C’est à partir de ces deux grandes questions qu’Ulysse Lojkine démarre son important travail d’élaboration théorique sur le capitalisme contemporain. Son point de départ est le suivant : il est désormais bien plus difficile que par le passé de déchiffrer les relations d’exploitation et de domination dans notre économie. Les évolutions du capitalisme – financiarisation, mondialisation et fragmentation des réseaux de production, émergence de nouvelles formes d’emplois… – ont conduit à un brouillage de ces rapports, auparavant cristallisés dans l’affrontement direct entre le travailleur et son employeur.
Partant de ce constat, Lojkine propose de renouveler la théorie de l’exploitation marxiste traditionnelle en se penchant sur l’émergence d’autres dimensions de l’exploitation, en dehors de la sphère salariale. Pour lui, cette multiplication des échelles et des formes d’exploitation capitaliste induit aussi une réévaluation de la nature du capitalisme : l’auteur nous invite alors à le concevoir non pas uniquement sous l’angle de l’exploitation, mais aussi comme un système de coordination économique particulièrement efficace, bien qu’injuste. Dès lors, si l’on souhaite substituer au système capitaliste un mode de production égalitaire, il s’agit non seulement de penser l’abolition de l’exploitation, mais aussi la construction de formes alternatives de coordination des échanges.
Ce livre est une pièce majeure aux débats sur la nature du capitalisme actuel, et, ce faisant, sur la construction d’une stratégie anticapitaliste adaptée à notre temps. L’Institut La Boétie en propose un aperçu à travers cette note de lecture.
I) (Re)définir l’exploitation capitaliste : appropriation du travail et relations de pouvoir
| « Le capitalisme est structurellement un système d’exploitation de certains groupes sociaux par d’autres, au sens d’une appropriation du travail d’autrui combinée à une relation de pouvoir asymétrique. » |
Comptabiliser le surtravail
L’ambition d’Ulysse Lojkine est de mettre en lumière les mécanismes contemporains de l’exploitation capitaliste. Pour cela, il prend comme point de départ la théorie de l’exploitation de Marx, qu’il propose d’amender et de prolonger pour l’adapter à la structure actuelle du capitalisme.
Il reprend à son compte la définition traditionnelle de la théorie marxiste : l’exploitation, c’est l’accaparement du surtravail, c’est-à-dire l’appropriation par les uns du travail fourni par les autres. Or, dans le système capitaliste, ce surtravail est rendu invisible aux yeux des travailleurs : il leur est impossible de savoir quelle partie de leur journée de travail travaillent-ils pour eux-mêmes, et quelle partie consacrent-ils aux profits du patron. Par ailleurs, dans une société marchande de division du travail, le travailleur ne récupère pas directement le fruit de son travail : celui-ci lui est rendu indirectement, par l’intermédiaire de la monnaie – son salaire – par laquelle il pourra acheter des marchandises produites par d’autres pour reproduire son existence. Ainsi, « on ne peut donc mesurer le travail propre qu’en mesurant le travail incorporé aux produits que son revenu permet au travailleur d’acheter ». Chez Marx, cette analyse sert à expliquer le processus de formation de la valeur des marchandises. Lojkine réfute cette explication et propose de garder une approche purement comptable du surtravail. Il formule ainsi son idée centrale : on peut tout à fait construire une mesure de l’exploitation à partir de la théorie de l’exploitation marxiste, tout en laissant de côté la question épineuse de la valeur[1].
Il propose alors de construire ce qu’il appelle une comptabilité en travail, c’est-à-dire une comptabilité des flux de travail au sein de notre économie, qui puisse s’appliquer à l’échelle nationale et internationale. Ce projet ambitieux fait face à plusieurs défis : comment comparer entre elles des réalités de travail très différentes ? Comment mesurer précisément qui s’approprie le travail de qui, dans une économie où les flux de travail sont de plus de plus en plus indirects et complexes ?
Ces questions sont essentielles, puisque la ligne de démarcation entre exploiteurs et exploités dépend précisément de la mesure que l’on retient. Ulysse Lojkine se concentre particulièrement sur deux enjeux décisifs : la place ambivalente des cadres (les salariés à hauts revenus) et les différences de rémunération du travail entre le Nord et le Sud (l’échange international inégal). Pour résoudre cette question de l’hétérogénéité du travail, plusieurs approches ont émergé au sein du marxisme. Parmi elles, deux principales, mais qui amènent des conclusions divergentes : la « réduction par le salaire », qui considère que le salaire reflète le degré de complexité du travail effectué ; et l’approche homogène, qui considère au contraire que toutes les heures de travail doivent être comptées de la même manière.
Si l’on comptabilise le travail selon la première approche, aucune inégalité de salaire n’est due à un rapport d’exploitation : les salariés qui gagnent davantage que la moyenne ne peuvent en aucun cas être catégorisés comme exploiteurs, puisque tous leurs revenus proviennent de leur travail, et non de revenus de la propriété. À l’inverse, si l’on adopte l’approche homogène, tout écart de salaire signale au contraire un transfert net de travail, et donc un rapport d’exploitation. Les cadres peuvent donc être considérés comme des exploiteurs, puisqu’ils s’approprient une part du travail global fourni supérieure à la moyenne.
Dans la figure ci-dessous, la droite en pointillé représente la démarcation de l’exploitation selon l’approche homogène (cas 1), tandis que la droite continue représente la réduction par le salaire (cas 2). Certains groupes conservent la même position dans les deux cas : les capitalistes et le prolétariat. Mais d’autres changent de position selon l’approche : la petite bourgeoisie est considérée comme exploitée dans le cas 1, contre exploiteuse dans le cas 2. Inversement, les cadres sont considérés exploiteurs dans le cas 1, contre exploités dans le cas 2.
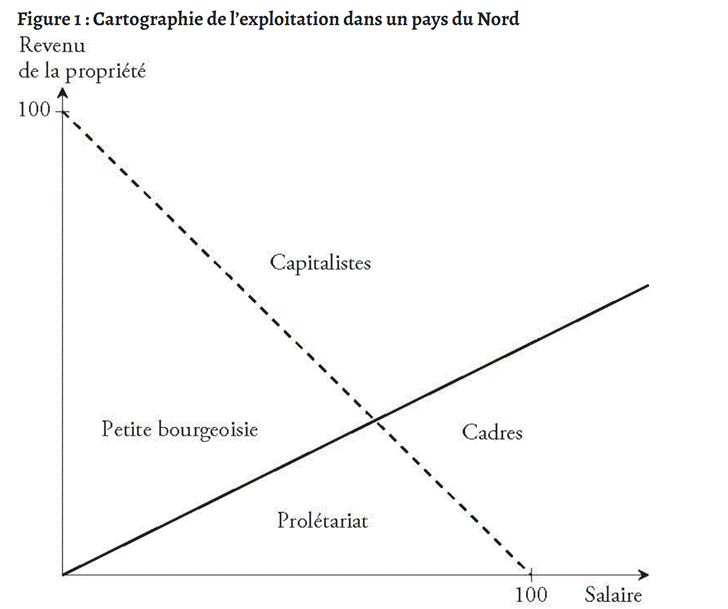
Cette même logique s’applique au cas de l’échange inégal entre le Nord et le Sud. Selon l’approche « au salaire », la ligne d’exploitation ne change pas. Mais si on opte pour l’approche homogène, une grande partie des salariés du Nord passent du côté des exploiteurs, dans la mesure où ils s’approprient une partie du travail des travailleurs du Sud – ils deviennent une sorte d’équivalent des « cadres » à l’échelle mondiale. Seuls les travailleurs pauvres du Nord demeurent dans le prolétariat mondial exploité. « En somme, résume Lojkine, les écarts de revenu entre pays sont tels que, si on considère vraiment qu’une heure de travail du Sud vaut une heure de travail du Nord, on est forcé de conclure que la majorité de la population du Nord s’approprie par le commerce un flux net de travail issu du Sud ».
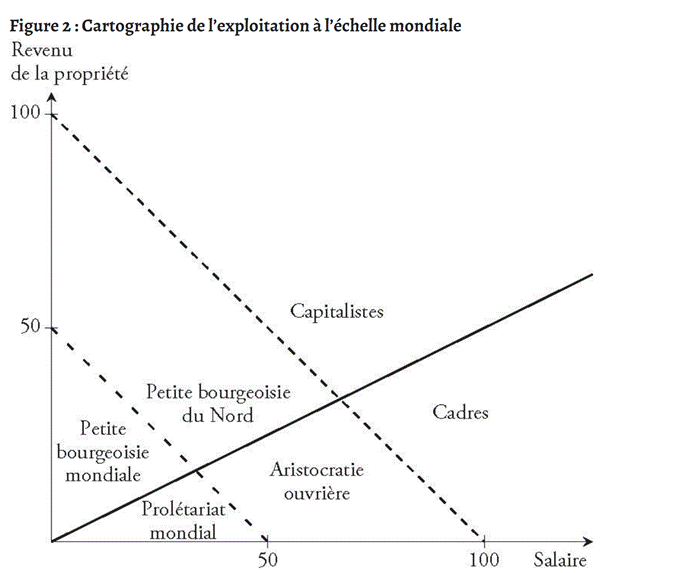
Aux termes de cet exposé, Lojkine n’impose pas de conclusion ferme quant à la meilleure manière de comptabiliser le travail, et donc de définir qui est exploité et qui est exploiteur. Mais son travail montre la capacité de l’approche homogène à rendre compte de certains mécanismes plus discrets de l’exploitation contemporaine, ainsi que ll’ambivalence de certaines positions de classe. Il appelle par ailleurs à réfléchir à la manière d’intégrer dans cette comptabilité des formes de travail non-marchand, en particulier le travail domestique des femmes que l’on ne compte quasiment jamais.
Les relations asymétriques de pouvoir dans le capitalisme
Décrire l’appropriation du travail des uns par les autres ne suffit pas à saisir les ressorts profonds de l’exploitation : on doit aussi comprendre comment cette appropriation est rendue possible, c’est-à-dire pourquoi certains se retrouvent du côté des exploités et d’autres des exploiteurs. Il faut alors se pencher sur les relations de pouvoir qui structurent le mode de production capitaliste et qui, elles aussi, sont invisibilisées par ce dernier. Pour les démasquer, Lojkine propose notamment de faire dialoguer entre elles les conceptions néoclassique et marxiste du pouvoir afin de construire une conception plus étendue de la notion de pouvoir dans l’économie capitaliste.
Pour la plupart des pensées économiques non-marxistes, le capitalisme peut exister sans exploitation. Il ne porte pas fondamentalement en lui des rapports de domination. La théorie libertarienne considère ainsi que les capitalistes n’exercent pas de domination sur les travailleurs car ils n’exercent pas de coercition. L’employeur peut simplement licencier le travailleur, mais il ne peut pas le sanctionner en usant de la violence, en confisquant ses biens ou en l’envoyant en prison, par exemple, contrairement à l’État.
Les théories néoclassiques, dominantes aujourd’hui en économie, expliquent, elles, qu’il n’y a pas de relations de pouvoir dans une économie de marché si celle-ci est suffisamment concurrentielle. Elles considèrent qu’il n’y a qu’une seule forme de pouvoir dans l’économie : celui du monopole – ou, dans le cas du marché de l’emploi, du monopsone –, que la concurrence neutralise totalement. Puisqu’une diversité d’employeurs existe, le travailleur est formellement libre de travailler là où cela lui plaît. Plus il y a d’emplois disponibles, plus il se sentira libre de refuser un travail aux conditions insatisfaisantes. La concurrence permettrait ainsi d’éviter l’arbitraire des employeurs sur les prix et les salaires.
Pour Lojkine, cette conception passe à côté du point central exposé par la théorie marxiste : la propriété privée des moyens de production permet aux capitalistes d’exploiter les travailleurs à leur gré. Ce n’est que parce que les capitalistes détiennent les moyens de production que les travailleurs sont obligés de vendre leur force de travail. Autrement dit, « la subsistance du travailleur est détenue par les possédants comme un otage, et c’est sa force de travail qu’il doit fournir comme rançon ». Marx parle en ce sens de « contrainte silencieuse » au marché : la propriété des moyens de production force les travailleurs à vendre leur force de travail sur le marché de l’emploi. Et c’est cette asymétrie de pouvoir qui fait du rapport salarial « un rapport unilatéral d’autorité et d’obéissance, de pouvoir et subordination ». La propriété privée offre un pouvoir sur le marché, indépendamment de la question de la concurrence.
Toutefois, on peut s’appuyer sur l’intuition néoclassique au sujet du rôle de la concurrence pour enrichir notre compréhension du pouvoir capitaliste, explique Lojkine. Là où les néoclassiques le définissent comme une domination individuelle, et les marxistes comme une domination impersonnelle, il propose de redéfinir le pouvoir comme une variation. Le pouvoir devient alors la capacité d’un agent à faire varier une réalité sociale, en prenant en compte la réaction des autres agents. Autrement dit, la capacité à imposer ses préférences. On y intègre donc le pouvoir formel, bien sûr, mais aussi les formes plus implicites et indirectes de pouvoir qui existent dans le capitalisme. Cette définition permet à la fois de confirmer le pouvoir issu d’une situation de monopole, mais aussi et surtout de montrer l’inégale répartition de ce pouvoir entre les groupes. En prenant l’exemple d’un marché locatif parfaitement concurrentiel, Lojkine démontre facilement comment les groupes les plus riches ont la liberté de choisir les biens qu’ils souhaitent, laissant les moins riches sur le carreau.
Ainsi le pouvoir de marché n’est pas tant déterminé par le degré de concurrence entre les agents, mais bien par la distribution de la richesse. Le capitalisme permet bien la domination structurelle des dominants sur les dominés. En suivant cette conception renouvelée du pouvoir capitaliste, on voit d’ailleurs qu’il ne se limite pas au pouvoir de l’employeur sur le marché de l’emploi, mais qu’il se déploie également ailleurs que dans le rapport salarial et la sphère de la production.
II) L’exploitation au-delà de la relation salariale : sous-traitance, crédit et rente
| « L’appropriation prend une variété de formes imbriquées, dispersées et réticulaires, souvent indirectes et en cascade. » |
Aujourd’hui, l’exploitation capitaliste ne passe pas uniquement par le rapport salarial, mais se déploie aussi dans de nouvelles sphères de l’économie : la sous-traitance, le crédit, et la rente. Selon Lojkine, ces formes d’exploitation ne sont pas dérivées de l’exploitation salariale, comme l’avançait Marx : elles existent de manière autonome, indépendamment de celle-ci. L’exploitation capitaliste n’est plus cantonnée à la seule sphère de la production, mais s’étend aussi à la sphère de la circulation des échanges. Si l’auteur rappelle toutefois la place particulière que continue de jouer le salariat, il permet de poser en de nouveaux termes le rôle de l’endettement, de la finance, ou encore de l’exploitation locative ; ainsi que leurs conséquences politiques.
L’exploitation commerciale par la sous-traitance
L’exploitation par la sous-traitance prend bien sûr une place croissante dans l’économie. Pour autant, cela ne doit pas nous faire oublier qu’elle a toujours existé dans l’Histoire. Déjà au XVIIIe siècle, les « manufactures » organisaient le travail sous une forme ternaire, c’est-à-dire avec trois parties prenantes. Le marchand ou négociant fournissait la matière première à un chef d’atelier, qui s’occupait de faire effectuer le travail par d’autres ouvriers que lui. Ce travail par intermédiaire a été perçu par Marx comme un modèle hybride, en transition vers le salariat traditionnel. Théoriquement, il l’analyse comme un rapport de salariat déguisé. Or, si le salariat s’est imposé comme la relation de travail dominante au XIXe et XXe siècle, la sous-traitance n’a jamais vraiment disparu. Surtout, Lojkine avance qu’elle a fait son grand retour à l’ère du capitalisme néolibéral, ce qui justifie de l’analyser comme une forme autonome d’exploitation.
Ces dernières décennies, la production s’est fragmentée à l’échelle mondiale, et le modèle d’entreprise en réseaux s’est largement développé. Aujourd’hui, « deux entreprises participant au même réseau sont désormais en moyenne séparées de dix chaînons intermédiaires par lesquels transitent les pièces ou les produits semi-finis ». Dans ce contexte, les entreprises elles-mêmes sont prises dans des rapports commerciaux inégaux. À l’échelle internationale, les grandes entreprises donneuses d’ordre du Nord externalisent leur production en faisant appel à des entreprises du Sud, qui embauchent elles-mêmes les travailleurs nécessaires. Cette relation implique des rapports de pouvoir ambivalents.
Pour illustrer ces rapports, Lojkine prend l’exemple d’un atelier de textile au Maroc, sous-traitant de Zara, qui fait travailler ses ouvriers dans un sous-sol. En 2021, 28 d’entre eux y trouvent la mort, suite à des inondations qui engloutirent l’atelier sans laisser aucune possibilité d’évacuation. En remontant la chaîne des responsabilités de cet accident, on met en lumière la position ambivalente de l’employeur intermédiaire : le chef de l’atelier de textile marocain est bien sûr responsable, dans la mesure où il exploite ses ouvriers (il extorque une partie de leur travail) et les fait travailler dans les conditions déplorables qui ont conduit à leur mort. Mais il y a bien un autre responsable : Zara, l’entreprise donneuse d’ordre, qui pousse ses sous-traitants à abaisser au maximum le coût du travail – jusqu’à entasser les ouvriers dans un sous-sol – pour augmenter ses propres profits.
Ces rapports d’exploitations inter-entreprises se jouent aussi à l’intérieur même des pays du Nord. C’est le cas avec les franchises. McDonald’s, Carrefour, Franprix… Toutes ces entreprises fonctionnent par système de franchise, dans lequel l’entreprise au sommet impose à ses franchisés leur fonctionnement, leurs prix, etc. Elles s’approprient ainsi de fait une partie de leur profit.
L’intérim, qui s’est largement développé ces dernières années, renvoie également à ce mode d’exploitation en cascade. Pour Lojkine, ces éléments témoignent de l’existence d’une forme d’exploitation commerciale entre des employeurs dominants et des employeurs intermédiaires : le dominant exerce sur le dominé un contrôle partiel de ses moyens de production et de son procès de travail, entraînant une appropriation partielle de son profit.
Ce phénomène s’observe par exemple à l’échelle de l’économie française. Entre 1990 et 2006, la part du profit (donc le taux d’exploitation) dans la valeur ajoutée totale est restée stable. Mais cette apparente stabilité cache deux dynamiques plus précises : si la part des profits dans chaque entreprise a bien diminué en moyenne à l’échelle nationale, les entreprises dans lesquelles le taux de profit a augmenté ont, elles, vu leur poids accru dans l’économie globale. Il y a eu une réallocation des profits entre les entreprises : autrement dit, un transfert de la valeur, et donc du surtravail de nombreuses petites et moyennes entreprises vers quelques très grandes. Donc un rapport d’exploitation.
L’exploitation financière par le crédit
Les employeurs comme les travailleurs peuvent être pris dans un autre rapport d’exploitation : celui du crédit, qui a gagné en importance à mesure de la financiarisation de notre économie. Lojkine distingue plusieurs strates de cette exploitation financière. La première est bien sûr l’actionnariat. Elle constitue une forme d’exploitation évidente, puisque l’actionnaire reçoit de l’argent (des dividendes) sans avoir fourni aucun travail, mais uniquement parce qu’il détient, via ses actions, les moyens de production.
L’exploitation par le crédit – via le versement d’intérêts – est quant à elle plus indirecte, mais toute aussi centrale. Le créancier ne détient certes pas les moyens de production, mais des fonds. En échange de ce prêt de fonds, il reçoit une somme d’argent. Ce rapport d’exploitation touche les entreprises (les capitalistes) comme les ménages. En effet, le capitalisme contemporain a connu une hausse considérable de l’endettement des entreprises. Non seulement le flux des intérêts est de plus en plus important, mais surtout, l’importance prise par ce rapport de crédit a un impact sur le rapport salarial au sein des entreprises. La pression financière exercée par les banques et les marchés financiers poussent notamment les entreprises à comprimer la masse salariale ou à réduire les salaires pour répondre aux attentes du marché. Le crédit est donc indirectement un instrument de discipline du travail qui permet d’intensifier l’exploitation.
Surtout, on ne contracte pas que pour investir, mais aussi pour assurer sa propre subsistance. Aujourd’hui, les crédits à la consommation, les crédits immobiliers ou encore les crédits étudiants sont structurants dans la vie des classes populaires : « l’exploitation financière a autant de prise sur les travailleurs que l’exploitation salariale », résume Lojkine.
La relation de pouvoir (deuxième pan de l’exploitation) induite par le crédit se cristallise dès la phase de sélection, qui implique, pour celui qui souhaite contracter un crédit, de discipliner sa conduite ; puis la violence peut intervenir tout au long du crédit, à travers, en cas de défaut de paiement, une saisie sur le revenu ou une exclusion du marché.
Ainsi, « si Sisyphe, qui doit jour après jour pousser son rocher […] peut être comparé au salarié contraint jour après jour de suivre d’épuisantes prescriptions pour gagner ses moyens de subsistance, alors le crédit doit plutôt être comparé à l’épée de Damoclès qui ne fait peser aucune contrainte directe mais menace à tout instant de s’abattre sur l’imprudent ».
L’exploitation rentière
Le troisième rapport d’exploitation qu’analyse Lojkine est celui de la rente. Là aussi, il se déploie aussi bien entre les capitalistes qu’en direction des travailleurs. Il s’agit de s’approprier de la valeur, non pas grâce à la détention des moyens de production et donc à l’appropriation du surtravail, mais du simple fait du contrôle opéré sur une ressource ou un actif.
Pour ce qui est des rapports inter-capitalistes, l’exploitation rentière s’articule souvent avec l’exploitation commerciale. Elle s’appuie notamment de plus en plus sur la propriété intellectuelle : c’est le cas pour le rapport de franchise, déjà évoqué précédemment, dans lequel le franchisé paie pour utiliser la marque du franchiseur ; et qui s’accompagne parfois d’une rente foncière de la part du franchiseur, comme par exemple pour McDonald’s. On peut aussi penser aux brevets concernant des innovations technologiques, qui ont explosé ces dernières années notamment dans le domaine du numérique et qui reproduisent la même logique.
En plus d’être un rapport de force entre fractions du capital, la rente est aussi extraite directement sur les travailleurs, et ce de multiples façons. La plus frappante d’entre elles se joue sur le marché immobilier : c’est l’exploitation locative. Ici, comme pour le crédit, le rapport de pouvoir de la rente (en l’occurrence, du propriétaire immobilier) se cristallise en deux moments. En amont, les ménages sont soumis à l’arbitraire du propriétaire pour réussir à trouver un logement à louer. Ensuite, la menace de l’expulsion joue à tout moment aussi un rôle disciplinaire sur le locataire. Cette exploitation rentière, notamment immobilière, est essentielle aujourd’hui : dans tous les pays européens, pour le tiers des ménages les plus modestes, le loyer représente désormais plus d’un tiers du revenu, en nette augmentation par rapport aux années 1990.
Pour Marx, ces formes d’exploitation existent bel et bien, mais elles sont subordonnées à l’exploitation salariale, qui est perçue comme le rapport d’exploitation primordiale. Lojkine reconnaît lui aussi sa centralité (il concerne une immense majorité des travailleurs), mais il insiste sur sa spécificité : contrairement aux autres rapports d’exploitation, le rapport salarial déploie une forme de contrôle direct sur le travailleur ; et permet l’accumulation du capital industriel, donc le développement des forces productives, élément central du capitalisme. Mais il affirme que les autres formes d’exploitation ne lui sont pas subordonnées : elles peuvent exister sans lui, et ont pris une importance considérable dans le capitalisme contemporain.
III) Dépasser le capitalisme : le défi de la coordination
Le capitalisme, un rapport de coordination
| « [Le capitalisme est] un épais réseau de transactions commerciales, salariales et financières reliant à plusieurs échelles, de manière souvent indirecte, des agents individuels ou collectifs dispersés à la surface de la planète et dont les besoins se déterminent mutuellement. » |
Comment le capitalisme, comme système de production et d’exploitation, tient-il ensemble malgré sa dispersion en une multiplicité d’échelles ? Lojkine propose de concevoir le capitalisme non seulement comme un mode d’exploitation, mais aussi comme un système de coordination des activités entre elles. « En même temps qu’elle organise l’exploitation, la structure du capitalisme tient ensemble ceux qui y participent d’une manière relativement cohérente malgré leur dispersion », explique-t-il. Les mêmes institutions capitalistes qui organisent l’exploitation organisent cette coordination : le capitalisme fonctionne grâce à ces deux jambes.
Lojkine examine ainsi le rôle des trois institutions centrales du capitalisme : la propriété privée, le marché, et l’organisation hiérarchique de l’entreprise. Sans laisser de côté les failles et les limites de cette coordination, dont témoignent les nombreuses crises et la persistance du chômage, il souligne le rôle clé que jouent ces institutions dans le fonctionnement de l’économie à l’échelle globale.
La propriété privée, d’abord, permet d’abord une simple coordination négative, au sens où elle empêche le gaspillage des ressources et les conflits d’appropriation. À cette première forme primaire de coordination s’ajoute une coordination positive, celle du marché. Le marché permet en effet de coordonner les échanges entre des individus dispersés au quatre coins du monde, notamment grâce au « système impersonnel de prix ». Plus précisément, le marché des capitaux coordonne en sélectionnant les meilleurs investisseurs potentiels ; tandis que le marché de l’emploi coordonne en jouant un rôle d’appariement entre des travailleurs et des entreprises. Enfin, le capitalisme ne pourrait fonctionner sans une troisième institution coordinatrice : la structure hiérarchique au sein de l’entreprise. Elle prend la forme d’un commandement vertical et d’une distribution des tâches de chacun pour permettre de remplir l’objectif de production de l’entreprise. Lojkine souligne par ailleurs l’existence d’autres institutions de coordination, comme les formes de coordination particulières des entreprises en réseaux, évoquées précédemment. En somme, les formes de coordination du capitalisme sont elles aussi variées, tantôt marchandes et tantôt hiérarchiques, en fonction des spécificités de chaque activité.
Si Marx avait analysé le rôle structurant de la coordination dans le capitalisme, il la considérait toutefois comme secondaire face au rapport de production. C’est ce dernier qui, in fine, (re)conduit l’exploitation. Or, ce rapport de production peut être défini de deux manières dans la théorie marxiste. Au sens restreint, il désigne le rapport de production au sein de l’entreprise, et donc le seul rapport employeur/salarié. Ici, la sphère de production immédiate (le salariat) domine la sphère de la circulation (des échanges). Mais au sens large, il désigne les rappports dans la structure économique général du capitalisme. C’est dans cette deuxième conception du rapport de production que s’insère la thèse de Lojkine. En ce sens, il n’y a pas de séparation entre la sphère de la circulation et la sphère de la production dans l’économie : les deux sont transversales, et l’exploitation se déploie dans l’une comme dans l’autre.
Pour une coordination socialiste : planification, droits sociaux ou algorithmes d’appariement ?
| « Si les rapports d’exploitation actuels sont ancrés dans les institutions de coordination du capitalisme, alors ce sont d’autres institutions de coordination aux propriétés différentes qu’il faudrait mettre en place pour abolir l’exploitation. » |
Dès lors, pour remplacer le système capitaliste qui permet l’exploitation, l’enjeu est d’imaginer des formes alternatives – et au moins aussi efficaces – de coordination pour assurer la tenue de ce nouveau mode de production. L’auteur nous propose de se pencher sur deux institutions alternatives au capitalisme qui se sont développées à grande échelle historiquement : la planification étatique et les droits sociaux. Il en montre l’intérêt pour abolir (ou a minima contenir) l’exploitation, mais aussi les limites en termes de coordination, et propose donc de s’appuyer sur une troisième institution : les algorithmes d’appariement.
La logique de la planification étatique se définit par deux éléments : l’État fixe des objectifs en nature à atteindre en un temps défini ; et il utilise les différents leviers à sa disposition (y compris la coercition si nécessaire) pour les atteindre. L’expérience planificatrice historique la plus intéressante pour nous – sans en faire, loin s’en faut, un modèle – est celle de l’économie soviétique, puisqu’elle a, dans une certaine mesure, aboli la propriété lucrative, transformé radicalement les rapports de production et ainsi amoindri l’exploitation salariale. Sans compter la question fondamentale de l’inégale distribution du pouvoir dans le système soviétique, qui remet en cause l’idée d’une abolition de la domination, c’est aussi le caractère bureaucratique et vertical de la coordination qui pose problème. Lojkine avance ainsi que la planification étatique, dans son modèle traditionnel, ne permet pas de tenir suffisamment compte de la diversité des besoins et des désirs individuels dispersés. Elle est adéquate et même particulièrement efficace pour remplir un objectif collectif précis et situé, tel que la bifurcation écologique, mais insuffisante à l’échelle d’une économie entière.
Les droits sociaux, quant à eux, se sont développés au sein même des économies capitalistes suite aux luttes des travailleurs. On peut les définir comme « un droit qu’un individu ou un collectif peut faire valoir sur la société ou sur d’autres agents privés, et qui prime sur le droit de la propriété privé et des contrats ». Leurs trois piliers – la protection sociale, le droit du travail et les services publics – permettent indéniablement de contenir l’exploitation. Par exemple, au sein de la relation d’emploi, le droit du travail limite directement le droit patronal, tandis que la sécurité sociale et les services publics sortent partiellement du marché l’accès à des besoins essentiels (santé, éducation…). Mais les droits sociaux font face à une limite essentielle : leur logique n’est pas souveraine dans le capitalisme. Ces derniers agissent aujourd’hui comme un correctif, un complément au capitalisme, mais jamais comme un substitut.
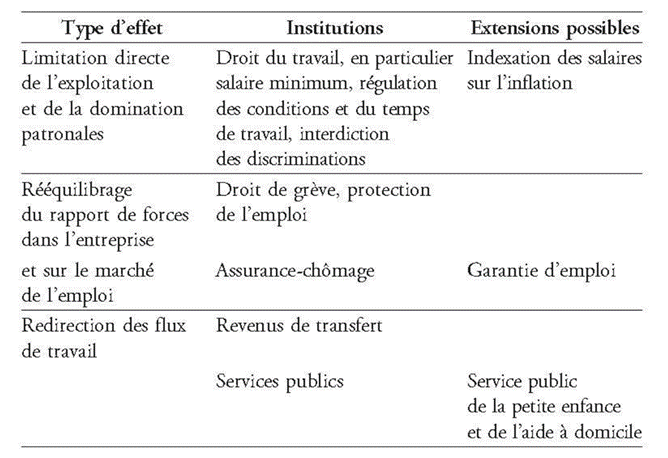
Lojkine résume alors l’enjeu comme suit : « Existe-t-il un système moderne de coordination socialiste à grande échelle qui ne soit ni, comme l’État social, un simple complément au mécanismes capitalistes, ni, comme le socialisme bureaucratique, soumis aux objectifs fixés au niveau de l’État ? ».
Il propose pour cela une piste innovante : s’appuyer sur les algorithmes d’appariement pour coordonner les échanges, qui opèrent des calculs d’optimisation économiques à la place du marché. L’intérêt est d’organiser une coordination par le bas, comme le marché, et non par le haut, comme la planification bureaucratique, mais en s’appuyant sur une décision politique démocratique, et non sur la « main invisible du marché ». Ce type d’algorithmes – algorithmes d’acceptation différée ou algorithmes des cycles d’échange – est déjà utilisé dans de nombreux pays pour diverses activités économiques nécessitant une coordination à très grande échelle : par exemple, pour allouer les greffes de reins entre donneurs et malades.
L’originalité de la proposition est de distinguer le moment de la décision politique – quelles règles souhaitons-nous pour faire fonctionner ces algorithmes ? – et le moment de l‘exécution, du fonctionnement économique. Il ne s’agit pas de s’en remettre aveuglément à des solutions technologiques au détriment de la décision collective, mais de s’appuyer sur des institutions déjà existantes pour mettre en œuvre un projet politique clairement défini, en l’occurrence anticapitaliste. En ce sens, Lojkine avance qu’une forme d’utilisation démocratique de ces algorithmes d’appariement pourrait résoudre le problème de coordination à grande échelle, tout en s’inscrivant dans un mode de production et d’échange socialiste qui abolirait l’exploitation.
Reste bien sûr à la décision démocratique la tâche de penser l’articulation de ces différentes institutions alternatives au capitalisme (planification, droits sociaux et algorithmes d’appariements), et la manière de les mettre en œuvre dans les conditions actuelles.
Conclusion
Que retirer de ce vaste travail d’élaboration théorique exposé dans Le fil invisible du capital ? D’abord, une compréhension plus fine du capitalisme contemporain. La financiarisation, la fragmentation de la production, la multiplicité des formes d’emplois, l’émergence d’un capitalisme rentier ou tributaire… : toutes ces tendances ont largement transformé les mécanismes par lesquels le capitalisme se déploie et se reproduit. Lojkine nous propose non seulement une description précise et essentielle de ces transformations, mais il analyse aussi la manière dont elles redéfinissent le cœur même de capitalisme. L’exploitation devient alors multiple, complexe, toujours plus insaisissable : elle ne se limite pas à la sphère de la production au sens de l’entreprise, mais se déploie également dans toutes les sphères de circulation de la valeur. L’extension du capitalisme à l’ensemble des sphères sociales nécessite pour l’appréhender une extension de la théorie de l’exploitation. De ce fait, la distinction entre les exploiteurs et les exploités se brouille elle aussi, et n’est peut-être plus aussi univoque qu’avant. La structure d’exploitation contemporaine définit une nouvelle multiplicité de positions de classes. Dans le même temps, ce que Lojkine ne dit pas, c’est que la généralisation de l’exploitation capitaliste à d’autres conditions que le salariat produit aussi une homogénéisation de tous ceux qui sont pris d’une manière ou d’une autre dans les rets surplombants des rapports de coordination capitalistes. De ce point de vue, on peut voir des correspondances entre la mise à jour de la théorie de l’exploitation par Lojkine et la théorie de l’ère du peuple .
Cette grille de lecture marxiste actualisée doit aussi nous permettre de poser à nouveaux frais la question de la construction d’un front de lutte anticapitaliste. Autour de quel sujet politique collectif doit-il se former ? Alors que l’ouvrier (ou même le salarié) représentait sans conteste l’acteur révolutionnaire aux siècles passées, la multiplication des rapports d’exploitation et de domination présentée dans l’ouvrage dessine un sujet exploité à construire dans un agrégat social pluriel dans des luttes sûrement plus intersectionnelles qu’avant et prenant en compte la manière dont le capitalisme saisi les individus en dehors du seul rapport salarial.
Enfin, en décrivant le capitalisme comme le couplage d’un système d’exploitation et d’un système de coordination efficace, l’ouvrage met en lumière un enjeu trop souvent éludé : pour renverser le capitalisme, il nous faudra non seulement abolir l’exploitation (ce qui est déjà une lourde tâche), mais aussi inventer des modes de coordination socialiste des échanges suffisamment structurés et efficaces pour garantir la tenue de nouvel ordre.
Le fil invisible du capital ne donne de réponse définitive à la question du dépassement du capitalisme, bien sûr. Mais la description de ses mécanismes, de ses forces et de ses faiblesses permet d’avancer considérablement dans la réflexion et la construction d’une stratégie anticapitaliste pour le 21e siècle.
| Pour aller plus loin : – Simon Verdun, La critique de l’exploitation peut-elle se passer de la théorie marxiste de la valeur ? Sur le livre d’Ulysse Lojkine, Contretemps, Septembre 2025. URL : https://www.contretemps.eu/critique-exploitation-capitaliste-theorie-marxiste-valeur/ – Jacques Bidet, Une ambitieuse alternative au « Capital ». Sur le livre d’Ulysse Lojkine, Contretemps, Octobre 2025. URL : https://www.contretemps.eu/une-ambitieuse-alternative-au-capital-sur-le-livre-dulysse-lojkine/ – Conférence d’Ulysse Lojkine, Hannah Bensussan, Marlène Benquet et Hadrien Clouet aux Amfis, Le capitalisme aujourd’hui : déchiffrer l’exploitation invisible, Août 2025. URL : https://www.youtube.com/watch?v=WjFWJfwmuF0 |